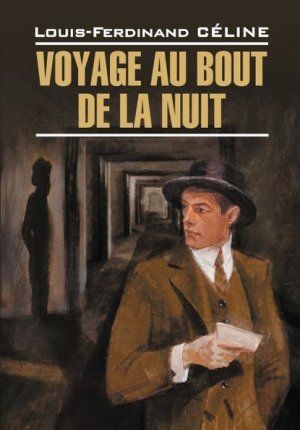
À Elisabeth Craig
Chanson des Gardes Suisses, 1793
- Notre vie est un voyage
- Dans l’hiver et dans la Nuit,
- Nous cherchons notre passage
- Dans le Ciel où rien ne luit.
Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le reste n’est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force.
Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C’est un roman, rien qu’une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais.
Et puis d’abord tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux.
C’est de l’autre côté de la vie.
Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. « Restons pas dehors! qu’il me dit. Rentrons! » Je rentre avec lui. Voilà. « Cette terrasse, qu’il commence, c’est pour les œufs à la coque! Viens par ici! » Alors, on remarque encore qu’il n’y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur; pas de voitures, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n’y a personne dans les rues; c’est lui, même que je m’en souviens, qui m’avait dit à ce propos: « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir; la preuve, c’est que lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus; ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocks. C’est ainsi! Siècle de vitesse! qu’ils disent. Où ça? Grands changements! qu’ils racontent. Comment ça? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits… » Bien fiers alors d’avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeurés là assis, ravis, à regarder les dames du café.
Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s’en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens; et puis, de fil en aiguille, sur le Temps où c’était écrit. « Tiens, voilà un maître journal, le Temps! » qu’il me ta-quine Arthur Ganate, à ce propos. « Y en a pas deux comme lui pour défendre la race française! – Elle en a bien besoin la race française, vu qu’elle n’existe pas! » que j’ai répondu moi pour montrer que j’étais documenté, et du tac au tac.
« Si donc! qu’il y en a une! Et une belle de race! qu’il insistait lui, et même que c’est la plus belle race du monde et bien cocu qui s’en dédit! » Et puis, le voilà parti à m’engueuler. J’ai tenu ferme bien entendu.
« C’est pas vrai! La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis c’est ça les Français.
– Bardamu, qu’il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n’en dis pas de mal!..
– T’as raison, Arthur, pour ça t’as raison! Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils nous valaient bien! Tu peux le dire! Nous ne changeons pas! Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d’opinions, ou bien si tard, que ça n’en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres! Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du Roi Misère. C’est lui qui nous possède! Quand on est pas sages, il serre… On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger… Pour des riens, il vous étrangle… C’est pas une vie…
– Il y a l’amour, Bardamu!
– Arthur, l’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches et j’ai ma dignité moi! que je lui réponds.
– Parlons-en de toi! T’es un anarchiste et puis voilà tout! » Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d’ici, et tout ce qu’il y avait d’avancé dans les opinions.
« Tu l’as dit, bouffi, que je suis anarchiste! Et la preuve la meilleure, c’est que j’ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles: LES AILES EN OR! C’est le titre!.. » Et je lui récite alors:
Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout, le ventre en l’air, prêt aux caresses, c’est lui, c’est notre maître. Embrassons-nous!
« Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j’en suis, moi, pour l’ordre établi et je n’aime pas la politique. Et d’ailleurs le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. » Voilà ce qu’il m’a répondu.
Justement la guerre approchait de nous deux sans qu’on s’en soye rendu compte et je n’avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m’avait fatigué. Et puis, j’étais ému aussi parce que le garçon m’avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout.
« C’est vrai, t’as raison en somme, que j’ai convenu, conciliant, mais enfin on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire!.. Assis sur des clous même à tirer tout nous autres! Et qu’est-ce qu’on en a? Rien! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille! qu’ils disent. C’est ça encore qu’est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des rouspignolles, et puis voilà! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s’en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça: “Bandes de charognes, c’est la guerre! qu’ils font. On va les aborder, les saligauds qui sont sur la patrie n° 2 et on va leur faire sauter la caisse! Allez! Allez! Y a de tout ce qu’il faut à bord! Tous en chœur! Gueulez voir d’abord un bon coup et que ça tremble: Vive la Patrie n° I! Qu’on vous entende de loin! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus! Nom de Dieu! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c’est fait bien plus vite encore qu’ici!”
– C’est tout à fait comme ça! » que m’approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre.
Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard, le colonel! Moi, je ne fis qu’un bond d’enthousiasme.
« J’ vais voir si c’est ainsi! que je crie à Arthur, et me voici parti à m’engager, et au pas de course encore.
– T’es rien c… Ferdinand! » qu’il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l’effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait.
Ça m’a un peu froissé qu’il prenne la chose ainsi, mais ça m’a pas arrêté. J’étais au pas. « J’y suis, j’y reste! » que je me dis.
« On verra bien, eh navet! » que j’ai même encore eu le temps de lui crier avant qu’on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s’est fait exactement ainsi.
Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu’il y en avait encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes! Et puis il s’est mis à y en avoir moins des patriotes… La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins et puis plus du tout d’encouragements, plus un seul, sur la route.
Nous n’étions donc plus rien qu’entre nous? Les uns derrière les autres? La musique s’est arrêtée. « En résumé, que je me suis dit alors, quand j’ai vu comment ça tournait, c’est plus drôle! C’est tout à recommencer! » J’allais m’en aller. Mais trop tard! Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des rats.
Une fois qu’on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu’on était là-dessus, remis à pied. Peut‐être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était parti avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu’au milieu de la route. Car c’est là précisément qu’on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres.
Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu’on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous, mais c’était deux Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d’heure.
Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils savaient, mais moi, vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J’avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à l’école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J’avais parlé leur langue. C’était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups; on allait toucher ensemble les filles après l’école dans les bois d’alentour, où on tirait aussi à l’arbalète et au pistolet qu’on achetait même quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d’abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence.
La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer.
Il s’était donc passé dans ces gens-là quelque chose d’extraordinaire? Que je ne ressentais, moi, pas du tout. J’avais pas dû m’en apercevoir…
Mes sentiments toujours n’avaient pas changé à leur égard. J’avais comme envie malgré tout d’essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore j’avais envie de m’en aller, énormément, absolument, tellement tout cela m’apparaissait soudain comme l’effet d’une formidable erreur.
« Dans une histoire pareille, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à foutre le camp », que je me disais, après tout…
Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud d’été.
Jamais je ne m’étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie.
Je n’avais que vingt ans d’âge à ce moment‐là. Fermes désertes au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l’autre bout du canton, et qu’ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu’ils possédaient, leur campagne, les charrettes, brancards en l’air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu’on se trouve bien tranquilles à faire ce qu’on voudrait pendant leur absence. Ça avait l’air gentil de leur part. « Tout de même, s’ils n’étaient pas ailleurs! – que je me disais – s’il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduits de cette ignoble façon! Aussi mal! On aurait pas osé devant eux! Mais, il n’y avait plus personne pour nous surveiller! Plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. »
Je me pensais aussi (derrière un arbre) que j’aurais bien voulu le voir ici moi, le Déroulède dont on m’avait tant parlé, m’expliquer comment qu’il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon.
Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre décidément, n’était pas terminée! Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante! Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s’il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement.
Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir, je l’ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus remuer.
Le colonel, c’était donc un monstre! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un chien, il n’imaginait pas son trépas! Je conçus en même temps qu’il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait combien? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment… Pourquoi s’arrêteraient‐ils? Jamais je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses.
Serais‐je donc le seul lâche sur la terre? pensais‐je. Et avec quel effroi!.. Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux! Nous étions jolis! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique.
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs et c’était arrivé.
Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu’il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles, il n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette abomination? On ne lui disait donc pas d’en haut qu’il y avait méprise? Abominable erreur? Maldonne? Qu’on s’était trompé? Que c’était des manœuvres pour rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats! Mais non! « Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie! » Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de la liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là! Mais on n’avait pas le temps de fraterniser non plus.
Donc pas d’erreur? Ce qu’on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n’était pas défendu! Cela faisait partie des choses qu’on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C’était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre!.. Rien à dire. Je venais de découvrir d’un coup la guerre tout entière. J’étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l’étais à ce moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On venait d’allumer la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça brûlait! Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n’était pas près de s’éteindre le charbon! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu’il semblait être et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d’en face lui passerait entre les deux épaules.
Il y a bien des façons d’être condamné à mort. Ah! combien n’aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d’être ici, moi crétin! Pour avoir, par exemple, quand c’était si facile, prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien! De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c’est des mots.
Si seulement j’avais encore eu le temps, mais je ne l’avais plus! Il n’y avait plus rien à voler! Comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas! Ne passent jamais! J’en connaissais une toute prête, au soleil, au chaud! Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien, je passais souvent par là, autrefois. Comme on change! J’étais un enfant alors, elle me faisait peur la prison. C’est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu’ils disent, à ce qu’ils pensent. C’est des hommes et d’eux seulement qu’il faut avoir peur, toujours.
Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent épuisés, enfin, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, de tous les fous? Jusqu’au dernier? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d’arrêter la guerre! Au moins dans ce coin-là où j’étais.
Le colonel déambulait à deux pas. J’allais lui parler. Jamais je ne l’avais fait. C’était le moment d’oser. Là où nous en étions il n’y avait presque plus rien à perdre. « Qu’est-ce que vous voulez? » me demanderait-il, j’imaginais, très surpris bien sûr par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerais alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu’il en pensait, lui. Le tout c’est qu’on s’explique dans la vie. À deux on y arrive mieux que tout seul.
J’allais faire cette démarche décisive quand, à l’instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied (comme on disait alors) avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l’autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d’un tombeau et qu’il en avait tout mal au cœur. Il n’aimait donc pas les balles ce fantôme lui non plus? Les prévoyait-il comme moi?
« Qu’est-ce que c’est? » l’arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier.
De le voir ainsi cet ignoble cavalier dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d’émotion, ça le courrouçait fort notre colonel. Il n’aimait pas cela du tout la peur. C’était évident. Et puis ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d’attaque, un régiment qui s’élançait dans la guerre. Il avait l’air de la saluer lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant.
Sous ce regard d’opprobre, le messager vacillant se remit au « garde-à-vous », les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu’il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s’il voulait nous parler ou bien s’il pleurait.
Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d’instrument. C’est à la mitrailleuse qu’ils poursuivaient à présent leurs sottises; ils en craquaient comme de gros paquets d’allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes.
L’homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d’articulé.
« Le maréchal des logis Barousse vient d’être tué, mon colonel, qu’il dit tout d’un trait.
– Et alors?
– Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel!
– Et alors?
– Il a été éclaté par un obus!
– Et alors, nom de Dieu!
– Et voilà! Mon colonel…
– C’est tout?
– Oui, c’est tout, mon colonel.
– Et le pain? » demanda le colonel.
Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu’il a eu le temps de dire tout juste: « Et le pain? » Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu’il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais bien que c’était fini, que j’étais devenu du feu et du bruit moi-même.
Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu’un vous les secouait de par-derrière. Ils avaient l’air de me quitter et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l’odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière.
Tout de suite après ça, j’ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d’éclater comme l’autre nous l’avait appris. C’était une bonne nouvelle. Tant mieux! que je pensais tout de suite ainsi: « C’est une bien grande charogne en moins dans le régiment! » Il avait voulu me faire passer au Conseil pour une boîte de conserve. « Chacun sa guerre! » que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l’air de servir à quelque chose la guerre! J’en connaissais bien encore trois ou quatre dans le régiment, de sacrés ordures que j’aurais aidés bien volontiers à trouver un obus comme Barousse.
Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi il était mort. Je ne le vis plus, tout d’abord. C’est qu’il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l’explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s’embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c’était arrivé. Tant pis pour lui! S’il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé.
Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble.
Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène.
J’ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d’avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J’en chantonnais même un brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu’on a les jambes un peu drôles. « Un seul obus! C’est vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus », que je me disais. « Ah! dis donc! que je me répétais tout le temps. Ah! dis donc!.. »
Il n’y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j’avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J’avais hâte d’arriver au campement pour savoir s’il y en avait d’autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire faire prisonnier!.. Çà et là des morceaux de fumée âcre s’accrochaient aux mottes. « Ils sont peut-être tous morts à l’heure actuelle? que je me demandais. Puisqu’ils ne veulent rien comprendre à rien, c’est ça qui serait avantageux et pratique qu’ils soient tous tués très vite… Comme ça on en finirait tout de suite… On rentrerait chez soi… On repasserait peut-être place Clichy en triomphe… Un ou deux seulement qui survivraient… Dans mon désir… Des gars gentils et bien balancés, derrière le général, tous les autres seraient morts comme le colon… Comme Barousse… comme Vanaille… (une autre vache)… etc. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l’Arc de Triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie! On est les héros! qu’on dirait au moment de la note… Des défenseurs de la Patrie! Et ça suffirait!.. On payerait avec des petits drapeaux français!.. La caissière refuserait même l’argent des héros et même elle vous en donnerait, avec des baisers quand on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. »
Je m’aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C’était à recommencer.
Il se remit à pleuvoir, les champs des Flandres bavaient l’eau sale. Encore pendant longtemps je n’ai rencontré personne, rien que le vent et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais d’où, une balle, comme ça, à travers le soleil et l’air me cherchait, guillerette, entêtée à me tuer, dans cette solitude, moi. Pourquoi? Jamais plus, même si je vivais encore cent ans, je ne me promènerais à la campagne. C’était juré.
En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu’elle avait eu lieu cette cérémonie, au revers d’une colline; le colonel avec sa grosse voix avait harangué le régiment: « Haut les cœurs! qu’il avait dit… Haut les cœurs! et vive la France! » Quand on a pas d’imagination, mourir c’est peu de chose, quand on en a, mourir c’est trop. Voilà mon avis. Jamais je n’avais compris tant de choses à la fois.
Le colonel n’avait jamais eu d’imagination lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l’imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort, tardive… Dans vingt ans… Trente ans… Peut-être davantage, à celle qu’on me voulait de suite, à bouffer de la boue des Flandres, à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu’aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d’avoir une opinion sur sa propre mort. Mais alors où aller? Droit devant moi? Le dos à l’ennemi. Si les gendarmes ainsi, m’avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m’aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d’école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes, partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l’estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m’aurait fusillé: douze balles, plus une. Alors?
Et je repensais encore au colonel, brave comme il était cet homme-là, avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches, on l’aurait montré se promenant comme je l’avais vu moi, sous les balles et les obus, dans un music-hall, c’était un spectacle à remplir lA’lhambra d’alors, il aurait éclipsé Fragson, dans l’époque dont je vous parle une formidable vedette, cependant. Voilà ce que je pensais moi. Bas les cœurs! que je pensais moi.
Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j’aperçus enfin nos soldats devant un hameau de fermes. C’était un avant-poste à nous. Celui d’un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, qu’on m’annonça. Tous vivants! Et moi qui possédais la grande nouvelle: « Le colonel est mort! » que je leur criai, dès que je fus assez près du poste. « C’est pas les colonels qui manquent! » que me répondit le brigadier Pistil, du tac au tac, qu’était justement de garde lui aussi et même de corvée.
« Et en attendant qu’on le remplace le colonel, va donc, eh carotte, toujours à la distribution de bidoche avec Empouille et Kerdoncuff et puis, prenez deux sacs chacun, c’est derrière l’église que ça se passe… Qu’on voit là-bas… Et puis vous faites pas refiler encore rien que les os comme hier, et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l’escouade avant la nuit, salopards! »
On a repris la route tous les trois donc.
« Je leur raconterai plus rien à l’avenir! » que je me disais, vexé. Je voyais bien que c’était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu’un drame comme j’en avais vu un, c’était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareils! qu’il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que huit jours plus tôt on en aurait mis sûrement quatre colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d’un colonel comme c’était arrivé. Des abrutis.
C’était donc dans une prairie d’août qu’on distribuait toute la viande pour le régiment, – ombrée de cerisiers et brûlée déjà par la fin d’été. Sur des sacs et des toiles de tentes largement étendues et sur l’herbe même, il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaïe, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d’alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l’arbre, et sur lequel s’escrimaient encore en jurant les quatre bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d’abattis. On s’engueulait ferme entre escouades à propos de graisses, et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux.
Et puis du sang encore et partout, à travers l’herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir.
« C’est toi eh vendu! qui l’as étouffé hier l’aloyau!.. »
J’ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différend alimentaire, tout en m’appuyant contre un arbre et j’ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu’un peu, jusqu’à l’évanouissement.
On m’a bien ramené jusqu’au cantonnement sur une civière, mais non sans profiter de l’occasion pour me barboter mes deux sacs en toile cachou.
Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.
Tout arrive et ce fut à mon tour de devenir brigadier vers la fin de ce même mois d’août. On m’envoyait souvent avec cinq hommes, en liaison, aux ordres du général des Entrayes. Ce chef était petit de taille, silencieux, et ne paraissait à première vue ni cruel, ni héroïque. Mais il fallait se méfier… Il semblait préférer par-dessus tout ses bonnes aises. Il y pensait même sans arrêt à ses aises et bien que nous fussions occupés à battre en retraite depuis plus d’un mois, il engueulait tout le monde quand même si son ordonnance ne lui trouvait pas dès l’arrivée à l’étape, dans chaque nouveau cantonnement, un lit bien propre et une cuisine aménagée à la moderne.
Au chef d’État-major, avec ses quatre galons, ce souci de confort donnait bien du boulot. Les exigences ménagères du général des Entrayes l’agaçaient. Surtout que lui, jaune, gastritique au possible et constipé, n’était nullement porté sur la nourriture. Il lui fallait quand même manger ses œufs à la coque à la table du général et recevoir en cette occasion ses doléances. On est militaire ou on ne l’est pas. Toutefois, je n’arrivais pas à le plaindre parce que c’était un bien grand saligaud comme officier. Faut en juger. Quand nous avions donc traîné jusqu’au soir de chemins en collines et de luzernes en carottes, on finissait tout de même par s’arrêter pour que notre général puisse coucher quelque part. On lui cherchait, et on lui trouvait un village calme, bien à l’abri, où les troupes ne campaient pas encore et s’il y en avait déjà dans le village des troupes, elles décampaient en vitesse, on les foutait à la porte, tout simplement; à la belle étoile, même si elles avaient déjà formé les faisceaux.
Le village c’était réservé rien que pour l’État-major, ses chevaux, ses cantines, ses valises, et aussi pour ce saligaud de commandant. Il s’appelait Pinçon ce salaud-là, le commandant Pinçon. J’espère qu’à l’heure actuelle il est bien crevé (et pas d’une mort pépère). Mais à ce moment-là, dont je parle, il était encore salement vivant le Pinçon. Il nous réunissait chaque soir les hommes de la liaison et puis alors il nous engueulait un bon coup pour nous remettre dans la ligne et pour essayer de réveiller nos ardeurs. Il nous envoyait à tous les diables, nous qui avions traîné toute la journée derrière le général. Pied à terre! À cheval! Repied à terre! Comme ça à lui porter ses ordres, de-ci, de‐là. On aurait aussi bien fait de nous noyer quand c’était fini. C’eût été plus pratique pour tout le monde.
« Allez-vous-en tous! Allez rejoindre vos régiments! Et vivement! qu’il gueulait.
– Où qu’il est le régiment, mon commandant? qu’on demandait nous…
– Il est à Barbagny.
– Où que c’est Barbagny?
– C’est par là! »
Par là, où il montrait, il n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une nuit énorme qui bouffait la route à deux pas de nous et même qu’il n’en sortait du noir qu’un petit bout de route grand comme la langue.
Allez donc le chercher son Barbagny dans la fin d’un monde! Il aurait fallu qu’on sacrifiât pour le retrouver son Barbagny au moins un escadron tout entier! Et encore un escadron de braves! Et moi qui n’étais point brave et qui ne voyais pas du tout pour-quoi je l’aurais été brave, j’avais évidemment encore moins envie que personne de retrouver son Barbagny, dont il nous parlait d’ailleurs lui-même absolument au hasard. C’était comme si on avait essayé en m’engueulant très fort de me donner l’envie d’aller me suicider. Ces choses-là on les a ou on ne les a pas.
De toute cette obscurité si épaisse qu’il vous semblait qu’on ne reverrait plus son bras dès qu’on l’étendait un peu plus loin que l’épaule, je ne savais qu’une chose, mais cela alors tout à fait certainement, c’est qu’elle contenait des volontés homicides énormes et sans nombre.
Cette gueule d’État-major n’avait de cesse dès le soir revenu de nous expédier au trépas et ça le prenait souvent dès le coucher du soleil. On luttait un peu avec lui à coups d’inertie, on s’obstinait à ne pas le comprendre, on s’accrochait au cantonnement pépère tant bien que mal, tant qu’on pouvait, mais enfin quand on ne voyait plus les arbres, à la fin, il fallait consentir tout de même à s’en aller mourir un peu; le dîner du général était prêt.
Tout se passait alors à partir de ce moment-là, selon les hasards. Tantôt on le trouvait et tantôt on ne le trouvait pas le régiment et son Barbagny. C’était surtout par erreur qu’on les retrouvait parce que les sentinelles de l’escadron de garde tiraient sur nous en arrivant. On se faisait reconnaître ainsi forcément et on achevait presque toujours la nuit en corvées de toutes natures, à porter beaucoup de ballots d’avoine et des seaux d’eau en masse, à se faire engueuler jusqu’à en être étourdi en plus du sommeil.
Au matin on repartait, groupe de la liaison, tous les cinq pour le quartier du général des Entrayes, pour continuer la guerre.
Mais la plupart du temps on ne le trouvait pas le régiment et on attendait seulement le jour en cerclant autour des villages sur les chemins inconnus, à la lisière des hameaux évacués, et les taillis sournois, on évitait tout ça autant qu’on le pouvait à cause des patrouilles allemandes. Il fallait bien être quelque part cependant en attendant le matin, quelque part dans la nuit. On ne pouvait pas éviter tout. Depuis ce temps-là, je sais ce que doivent éprouver les lapins en garenne.
Ça vient drôlement la pitié. Si on avait dit au commandant Pinçon qu’il n’était qu’un sale assassin lâche, on lui aurait fait un plaisir énorme, celui de nous faire fusiller, séance tenante, par le capitaine de gendarmerie, qui ne le quittait jamais d’une semelle et qui, lui, ne pensait précisément qu’à cela. C’est pas aux Allemands qu’il en voulait, le capitaine de gendarmerie.
Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu’avec l’espérance de moins en moins raisonnable d’en revenir et celle-là seulement et aussi que si on en revenait qu’on n’oublierait jamais, absolument jamais, qu’on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux la gueule ouverte autour des bateaux d’ordures et de viandes pourries qu’on va leur déverser au large, à La Havane.
La grande défaite, en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu’à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière.
Je l’aurais bien donné aux requins à bouffer moi, le commandant Pinçon, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre; et puis mon cheval aussi en même temps pour qu’il ne souffre plus, parce qu’il n’en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu’il avait mal, rien que deux plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes deux mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu’aux jarrets. Il fallait cependant trotter là-dessus, un, deux… Il s’en tortillait de trotter. Mais les chevaux c’est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu’au grand air. Dans les granges, à cause de l’odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort, qu’on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu’il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi on aurait dit qu’on grimpait sur un âne. C’était plus commode ainsi, faut l’avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu’on supportait en aciers sur la tête et sur les épaules.
Le général des Entrayes, dans la maison réservée, attendait son dîner. Sa table était mise, la lampe à sa place.
« Foutez-moi tous le camp, nom de Dieu, nous sommait une fois de plus le Pinçon, en nous balançant sa lanterne à hauteur du nez. On va se mettre à table! Je ne vous le répéterai plus! Vont-ils s’en aller ces charognes! » qu’il hurlait même. Il en reprenait, de rage, à nous envoyer crever ainsi, ce diaphane, quelques couleurs aux joues.
Quelquefois le cuisinier du général nous repassait avant qu’on parte un petit morceau, il en avait de trop à bouffer le général, puisqu’il touchait d’après le règlement quarante rations pour lui tout seul! Il n’était plus jeune cet homme-là. Il devait même être tout près de la retraite. Il pliait aussi des genoux en marchant. Il devait se teindre les moustaches.
Ses artères, aux tempes, cela se voyait bien à la lampe, quand on s’en allait, dessinaient des méandres comme la Seine à la sortie de Paris. Ses filles étaient grandes, disait‐on, pas mariées, et comme lui, pas riches. C’était peut-être à cause de ces souvenirs-là qu’il avait tant l’air vétillard et grognon, comme un vieux chien qu’on aurait dérangé dans ses habitudes et qui essaye de retrouver son panier à coussin partout où on veut bien lui ouvrir la porte.
Il aimait les beaux jardins et les rosiers, il n’en ratait pas une, de roseraie, partout où nous passions. Personne comme les généraux pour aimer les rosiers. C’est connu.
Tout de même on se mettait en route. Le boulot c’était pour les faire passer au trot les canards. Ils avaient peur de bouger à cause des plaies d’abord et puis ils avaient peur de nous et de la nuit aussi, ils avaient peur de tout, quoi! Nous aussi! Dix fois on s’en retournait pour lui redemander la route au commandant. Dix fois qu’il nous traitait de fainéants et de tire-au-cul dégueulasses. À coups d’éperons enfin on franchissait le dernier poste de garde, on leur passait le mot aux plantons et puis on plongeait d’un coup dans la sale aventure, dans les ténèbres de ces pays à personne.
À force de déambuler d’un bord de l’ombre à l’autre, on finissait par s’y reconnaître un petit peu, qu’on croyait du moins… Dès qu’un nuage semblait plus clair qu’un autre on se disait qu’on avait vu quelque chose… Mais devant soi, il n’y avait de sûr que l’écho allant et venant, l’écho du bruit que faisaient les chevaux en trottant, un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu’on en veut pas. Ils avaient l’air de trotter jusqu’au ciel, d’appeler tout ce qu’il y avait sur la terre les chevaux, pour nous faire massacrer. On aurait pu faire ça d’ailleurs d’une seule main, avec une carabine, il suffisait de l’appuyer en nous attendant, le long d’un arbre. Je me disais toujours que la première lumière qu’on verrait ce serait celle du coup de fusil de la fin.
Depuis quatre semaines qu’elle durait, la guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux, que j’en avais perdu, à force de fatigue, un peu de ma peur en route. La torture d’être tracassés jour et nuit par ces gens, les gradés, les petits surtout, plus abrutis, plus mesquins et plus haineux encore que d’habitude, ça finit par faire hésiter les plus entêtés, à vivre encore.
Ah! l’envie de s’en aller! Pour dormir! D’abord! Et s’il n’y a plus vraiment moyen de partir pour dormir alors l’envie de vivre s’en va toute seule. Tant qu’on y resterait en vie faudrait avoir l’air de chercher le régiment.
Pour que dans le cerveau d’un couillon la pensée fasse un tour, il faut qu’il lui arrive beaucoup de choses et des bien cruelles. Celui qui m’avait fait penser pour la première fois de ma vie, vraiment penser, des idées pratiques et bien à moi, c’était bien sûrement le commandant Pinçon, cette gueule de torture. Je pensais donc à lui aussi fortement que je pouvais, tout en brinquebalant, garni, croulant sous les armures, accessoire figurant dans cette incroyable affaire internationale, où je m’étais embarqué d’enthousiasme… Je l’avoue.
Chaque mètre d’ombre devant nous était une promesse nouvelle d’en finir et de crever, mais de quelle façon? Il n’y avait guère d’imprévu dans cette histoire que l’uniforme de l’exécutant. Serait-ce un d’ici? Ou bien un d’en face?
Je ne lui avais rien fait, moi, à ce Pinçon! À lui, pas plus d’ailleurs qu’aux Allemands!.. Avec sa tête de pêche pourrie, ses quatre galons qui lui scintillaient partout de sa tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au 1/1000, donc? Je me demandais quelle rage d’envoyer crever les autres le possédait celui-là? Les autres qui n’avaient pas de carte.
Nous quatre cavaliers sur la route nous faisions autant de bruit qu’un demi-régiment. On devait nous entendre venir à quatre heures de là ou bien c’est qu’on voulait pas nous entendre. Cela demeurait possible… Peut-être qu’ils avaient peur de nous les Allemands? Qui sait?
Un mois de sommeil sur chaque paupière voilà ce que nous portions et autant derrière la tête, en plus de ces kilos de ferraille.
Ils s’exprimaient mal mes cavaliers d’escorte. Ils parlaient à peine pour tout dire. C’étaient des garçons venus du fond de la Bretagne pour le service et tout ce qu’ils savaient ne venait pas de l’école, mais du régiment. Ce soir-là, j’avais essayé de m’entretenir un peu du village de Barbagny avec celui qui était à côté de moi et qui s’appelait Kersuzon.
« Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c’est les Ardennes ici tu sais… Tu ne vois rien toi loin devant nous? Moi, je vois rien du tout…
– C’est tout noir comme un cul », qu’il m’a répondu Kersuzon. Ça suffisait…
« Dis donc, t’as pas entendu parler de Barbagny toi dans la journée? Par où que c’était? que je lui ai demandé encore.
– Non. »
Et voilà.
On ne l’a jamais trouvé le Barbagny. On a tourné sur nous-mêmes seulement jusqu’au matin, jusqu’à un autre village, où nous attendait l’homme aux jumelles. Son général prenait le petit café sous la tonnelle devant la maison du Maire quand nous arrivâmes.
« Ah! comme c’est beau la jeunesse, Pinçon! » qu’il lui a fait remarquer très haut à son chef d’État-major en nous voyant passer, le vieux. Ceci dit, il se leva et partit faire un pipi et puis encore un tour les mains derrière le dos, voûté. Il était très fatigué ce matin‐là, m’a soufflé l’ordonnance, il avait mal dormi le général, quelque chose qui le tracassait dans la vessie, qu’on racontait.
Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit, ça finissait par me distraire comme un tic. Il m’a répété ça encore deux ou trois fois à propos du noir et du cul et puis il est mort, tué qu’il a été, quelque temps plus tard, en sortant d’un village, je m’en souviens bien, un village qu’on avait pris pour un autre, par des Français qui nous avaient pris pour des autres.
C’est même quelques jours après la mort de Kersuzon qu’on a réfléchi et qu’on a trouvé un petit moyen, dont on était bien content, pour ne plus se perdre dans la nuit.
Donc, on nous foutait à la porte du cantonnement. Bon. Alors on disait plus rien. On ne rouspétait plus. « Allez-vous-en! qu’il faisait, comme d’habitude, la gueule en cire.
– Bien mon commandant! »
Et nous voilà dès lors partis du côté du canon et sans se faire prier tous les cinq. On aurait dit qu’on allait aux cerises. C’était bien vallonné de ce côté-là. C’était la Meuse, avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin pas encore mûr et l’automne, et des villages en bois bien séchés par trois mois d’été, donc qui brûlaient facilement.
On avait remarqué ça nous autres, une nuit qu’on savait plus du tout où aller. Un village brûlait toujours du côté du canon. On en approchait pas beaucoup, pas de trop, on le regardait seulement d’assez loin le village, en spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres par exemple. Et tous les soirs ensuite vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l’horizon, ça se répétait, on en était entourés, comme par un très grand cercle d’une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages.
On voyait tout y passer dans les flammes, les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière.
Ça se remarque bien comment que ça brûle un village, même à vingt kilomètres. C’était gai. Un petit hameau de rien du tout qu’on apercevait même pas pendant la journée, au fond d’une moche petite campagne, eh bien, on a pas idée la nuit, quand il brûle, de l’effet qu’il peut faire! On dirait Notre‐Dame! Ça dure bien toute une nuit à brûler un village, même un petit, à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu’un bouton, puis plus rien.
Ça fume et alors c’est le matin.
Les chevaux qu’on laissait tout sellés, dans les champs à côté de nous, ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l’herbe, sauf un, qui prenait la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder la nuit passe bien mieux, c’est plus rien à endurer, c’est plus de la solitude.
Malheureux qu’ils n’ont pas duré les villages… Au bout d’un mois, dans ce canton-là, il n’y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au canon. Elles n’ont pas existé huit jours les forêts. Ça fait encore des beaux feux les forêts, mais ça dure à peine.
Après ce temps-là, les convois d’artillerie prirent toutes les routes dans un sens et les civils qui se sauvaient, dans l’autre.
En somme, on ne pouvait plus, nous, ni aller, ni revenir; fallait rester où on était.
On faisait queue pour aller crever. Le général même ne trouvait plus de campements sans soldats. Nous finîmes par coucher tous en pleins champs, général ou pas. Ceux qui avaient encore un peu de cœur l’ont perdu. C’est à partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, par escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre à lui, la profonde, la vraie de vraie.
Après un repos, on est remontés à cheval, quelques semaines plus tard, et on est repartis vers le nord. Le froid lui aussi vint avec nous. Le canon ne nous quittait plus. Cependant, on ne se rencontrait guère avec les Allemands que par hasard, tantôt un hussard ou un groupe de tirailleurs, par-ci, par-là, en jaune et vert, des jolies couleurs. On semblait les chercher, mais on s’en allait plus loin dès qu’on les apercevait. À chaque rencontre, deux ou trois cavaliers y restaient, tantôt à eux, tantôt à nous. Et leurs chevaux libérés, étriers fous et clinquants, galopaient à vide et dévalaient vers nous de très loin avec leurs selles à troussequins bizarres, et leurs cuirs frais comme ceux des portefeuilles du jour de l’an. C’est nos chevaux qu’ils venaient rejoindre, amis tout de suite. Bien de la chance! C’est pas nous qu’on aurait pu en faire autant!
Un matin en rentrant de reconnaissance, le lieutenant de Sainte‐Engence invitait les autres officiers à constater qu’il ne leur racontait pas des blagues. « J’en ai sabré deux! » assurait-il à la ronde, et montrait en même temps son sabre où, c’était vrai, le sang caillé comblait la petite rainure, faite exprès pour ça.
« Il a été épatant! Bravo, Sainte-Engence!.. Si vous l’aviez vu, messieurs! Quel assaut! » l’appuyait le capitaine Ortolan.
C’était dans l’escadron d’Ortolan que ça venait de se passer.
« Je n’ai rien perdu de l’affaire! Je n’en étais pas loin! Un coup de pointe au cou en avant et à droite!.. Toc! Le premier tombe!.. Une autre pointe en pleine poitrine!.. À gauche! Traversez! Une véritable parade de concours, messieurs!.. Encore bravo, Sainte-Engence! Deux lanciers! À un kilomètre d’ici! Les deux gaillards y sont encore! En pleins labours! La guerre est finie pour eux, hein, Sainte-Engence?.. Quel coup double! Ils ont dû se vider comme des lapins! »
Le lieutenant de Sainte-Engence, dont le cheval avait longuement galopé, accueillait les hommages et compliments des camarades avec modestie. À présent qu’Ortolan s’était porté garant de l’exploit, il était rassuré et il prenait du large, il ramenait sa jument au sec en la faisant tourner lentement en cercle autour de l’escadron rassemblé comme s’il se fût agi des suites d’une épreuve de haies.
« Nous devrions envoyer là-bas tout de suite une autre reconnaissance et du même côté! Tout de suite! s’affairait le capitaine Ortolan décidément excité. Ces deux bougres ont dû venir se perdre par ici, mais il doit y en avoir encore d’autres derrière… Tenez, vous, brigadier Bardamu, allez-y donc avec vos quatre hommes! »
C’est à moi qu’il s’adressait le capitaine.
« Et quand ils vous tireront dessus, eh bien tâchez de les repérer et venez me dire tout de suite où ils sont! Ce doit être des Brandebourgeois!.. »
Ceux de l’active racontaient qu’au quartier, en temps de paix, il n’apparaissait presque jamais le capitaine Ortolan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d’autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne qu’on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles, dès qu’il mettait pied à terre, il chancelait d’abord et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d’une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyés prendre du feu à la bouche des canons d’en face. Il collaborait avec la mort. On aurait pu jurer qu’elle avait un contrat avec le capitaine Ortolan.
La première partie de sa vie (je me renseignai) s’était passée dans les concours hippiques à s’y casser les côtes, quelques fois l’an. Ses jambes, à force de les briser aussi et de ne plus les faire servir à la marche, en avaient perdu leurs mollets. Il n’avançait plus Ortolan qu’à pas nerveux et pointus comme sur des triques. Au sol, dans la houppelande démesurée, voûté sous la pluie, on l’aurait pris pour le fantôme arrière d’un cheval de course.
Notons qu’au début de la monstrueuse entreprise, c’est-à-dire au mois d’août, jusqu’en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de routes, des coins de bois demeuraient favorables aux condamnés… On pouvait s’y laisser approcher par l’illusion d’être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain, jusqu’au bout, sans être trop lancinés par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d’octobre ce fut bien fini ces petites accalmies, la grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d’obus et de balles. Bientôt on serait en plein orage et ce qu’on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi et on ne pourrait plus voir qu’elle: sa propre mort.
La nuit, dont on avait eu si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l’attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n’y avait plus que cette différence qui comptait.
C’est difficile d’arriver à l’essentiel, même en ce qui concerne la guerre, la fantaisie résiste longtemps.
Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l’eau.
On dénichait dans la nuit çà et là des quarts d’heure qui ressemblaient assez à l’adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s’accomplissaient tant d’autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix…
Mais bientôt les nuits, elles aussi, à leur tour, furent traquées sans merci. Il fallut presque toujours la nuit faire encore travailler sa fatigue, souffrir un petit supplément, rien que pour manger, pour trouver le petit rabiot de sommeil dans le noir. Elle arrivait aux lignes d’avant-garde la nourriture, honteusement rampante et lourde, en longs cortèges boiteux de carrioles précaires, gonflées de viande, de prisonniers, de blessés, d’avoine, de riz et de gendarmes et de pinard aussi, en bonbonnes le pinard, qui rappellent si bien la gaudriole, cahotantes et pansues.
À pied, les traînards derrière la forge et le pain et des prisonniers à nous, des leurs aussi, en menottes, condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l’étrier des gendarmes, certains à fusiller demain, pas plus tristes que les autres. Ils mangeaient aussi ceux‐là, leur ration de ce thon si difficile à digérer (ils n’en auraient pas le temps) en attendant que le convoi reparte, sur le rebord de la route – et le même dernier pain avec un civil enchaîné à eux, qu’on disait être un espion, et qui n’en savait rien. Nous non plus.
La torture du régiment continuait alors sous la forme nocturne, à tâtons dans les ruelles bossues du village sans lumière et sans visage, à plier sous des sacs plus lourds que des hommes, d’une grange inconnue vers l’autre, engueulés, menacés, de l’une à l’autre, hagards, sans l’espoir décidément de finir autrement que dans la menace, le purin et le dégoût d’avoir été torturés, dupés jusqu’au sang par une horde de fous vicieux devenus incapables soudain d’autre chose, autant qu’ils étaient, que de tuer et d’être étripés sans savoir pourquoi.
Vautrés à terre entre deux fumiers, à coups de gueule, à coups de bottes, on se trouvait bientôt relevés par la gradaille et relancés encore un coup vers d’autres chargements du convoi, encore.
Le village en suintait de nourriture et d’escouades dans la nuit bouffie de graisse, de pommes, d’avoine, de sucre, qu’il fallait coltiner et bazarder en route, au hasard des escouades. Il amenait de tout le convoi, sauf la fuite.
Lasse, la corvée s’abattait autour de la carriole et survenait le fourrier alors avec son fanal au-dessus de ces larves. Ce singe à deux mentons qui devait dans n’importe quel chaos découvrir des abreuvoirs. Aux chevaux de boire! Mais j’en ai vu moi, quatre des hommes, derrière compris, roupiller dedans la pleine eau, évanouis de sommeil, jusqu’au cou.
Après l’abreuvoir il fallait encore la retrouver la ferme et la ruelle par où on était venus, et où on croyait bien l’avoir laissée l’escouade. Si on ne retrouvait rien, on était quittes pour s’écrouler une fois de plus le long d’un mur, pendant une seule heure, s’il en restait encore une à roupiller. Dans ce métier d’être tué, faut pas être difficile, faut faire comme si la vie continuait, c’est ça le plus dur, ce mensonge.
Et ils repartaient vers l’arrière les fourgons. Fuyant l’aube, le convoi reprenait sa route, en crissant de toutes ses roues tordues, il s’en allait avec mon vœu qu’il serait surpris, mis en pièces, brûlé enfin au cours de cette journée même, comme on voit dans les gravures militaires, pillé le convoi, à jamais, avec tout son équipage de gorilles gendarmes, de fers à chevaux et de rengagés à lanternes et tout ce qu’il contenait de corvées et de lentilles encore et d’autres farines, qu’on ne pouvait jamais faire cuire, et qu’on ne le reverrait plus jamais. Car crever pour crever de fatigue ou d’autre chose, la plus douloureuse façon est encore d’y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec.
Le jour où on les aurait ainsi bousillés jusqu’aux essieux ces salauds-là, au moins nous foutraient-ils la paix, pensais-je, et même si ça ne serait rien que pendant une nuit tout entière, on pourrait dormir au moins une fois tout entier corps et âme.
Ce ravitaillement, un cauchemar en surcroît, petit monstre tracassier sur le gros de la guerre. Brutes devant, à côté et derrière. Ils en avaient mis partout. Condamnés à mort différés on ne sortait plus de l’envie de roupiller énorme, et tout devenait souffrance en plus d’elle, le temps et l’effort de bouffer. Un bout de ruisseau, un pan de mur par là qu’on croyait avoir reconnus… On s’aidait des odeurs pour retrouver la ferme de l’escouade, redevenus chiens dans la nuit de guerre des villages abandonnés. Ce qui guide encore le mieux, c’est l’odeur de la merde.
Le juteux du ravitaillement, gardien des haines du régiment, pour l’instant le maître du monde. Celui qui parle de l’avenir est un coquin, c’est l’actuel qui compte. Invoquer sa postérité, c’est faire un discours aux asticots. Dans la nuit du village de guerre, l’adjudant gardait les animaux humains pour les grands abattoirs qui venaient d’ouvrir. Il est le roi l’adjudant! Le Roi de la Mort! Adjudant Cretelle! Parfaitement! On ne fait pas plus puissant. Il n’y a d’aussi puissant que lui qu’un adjudant des autres, en face.
Rien ne restait du village, de vivant, que des chats effrayés. Les mobiliers bien cassés d’abord, passaient à faire du feu pour la cuistance, chaises, fauteuils, buffets, du plus léger au plus lourd. Et tout ce qui pouvait se mettre sur le dos, ils l’emmenaient avec eux, mes camarades. Des peignes, des petites lampes, des tasses, des petites choses futiles, et même des couronnes de mariées, tout y passait. Comme si on avait encore eu à vivre pour des années. Ils volaient pour se distraire, pour avoir l’air d’en avoir encore pour longtemps. Des envies de toujours.
Le canon pour eux c’était rien que du bruit. C’est à cause de ça que les guerres peuvent durer. Même ceux qui la font, en train de la faire, ne l’imaginent pas. La balle dans le ventre, ils auraient continué à ramasser de vieilles sandales sur la route, qui pouvaient « encore servir ». Ainsi le mouton, sur le flanc, dans le pré, agonise et broute encore. La plupart des gens ne meurent qu’au dernier moment; d’autres commencent et s’y prennent vingt ans d’avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre.
Je n’étais point très sage pour ma part, mais devenu assez pratique cependant pour être lâche définitivement. Sans doute donnais-je à cause de cette résolution l’impression d’un grand calme. Toujours est-il que j’inspirais tel que j’étais une paradoxale confiance à notre capitaine, Ortolan lui‐même, qui résolut pour cette nuit‐là de me confier une mission délicate. Il s’agissait, m’expliqua‐t‐il, en confidence, de me rendre au trot avant le jour à Noirceur-sur-la-Lys, ville de tisserands, située à quatorze kilomètres du village où nous étions campés. Je devais m’assurer dans la place même, de la présence de l’ennemi. À ce sujet, depuis le matin, les envoyés n’arrivaient qu’à se contredire. Le général des Entrayes en était impatient. À l’occasion de cette reconnaissance, on me permit de choisir un cheval parmi les moins purulents du peloton. Depuis longtemps, je n’avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en voyage. Mais la délivrance était fictive.
Dès que j’eus pris la route, à cause de la fatigue, je parvins mal à m’imaginer, quoi que je fis, mon propre meurtre, avec assez de précision et de détails. J’avançais d’arbre en arbre, dans mon bruit de ferraille. Mon beau sabre à lui seul, pour le potin, valait un piano. Peut-être étais-je à plaindre, mais en tout cas sûrement, j’étais grotesque.
À quoi pensait donc le général des Entrayes en m’expédiant ainsi dans ce silence, tout vêtu de cymbales? Pas à moi bien assurément.
Les Aztèques éventraient couramment, qu’on raconte, dans leurs temples du soleil, quatre-vingt mille croyants par semaine, les offrant ainsi au Dieu des nuages, afin qu’il leur envoie la pluie. C’est des choses qu’on a du mal à croire avant d’aller en guerre. Mais quand on y est, tout s’explique, et les Aztèques et leur mépris du corps d’autrui, c’est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des Entrayes, plus haut nommé, devenu par l’effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant.
Il ne me restait qu’un tout petit peu d’espoir, celui d’être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil. Un fil dans la nuit, car les circonstances ne se prêtaient pas du tout aux politesses préliminaires. Un coup de fusil vous arrive plus vite qu’un coup de chapeau dans ces moments-là. D’ailleurs, que trouverais-je à lui dire à ce militaire hostile par principe, et venu expressément pour m’assassiner de l’autre bout de l’Europe?.. S’il hésitait une seconde (qui me suffirait) que lui dirais‐je?.. Que serait‐il d’abord en réalité? Quelque employé de magasin? Un rengagé professionnel? Un fossoyeur peut-être? Dans le civil? Un cuisinier?.. Les chevaux ont bien de la chance eux, car s’ils subissent aussi la guerre, comme nous, on ne leur demande pas d’y souscrire, d’avoir l’air d’y croire. Malheureux mais libres chevaux! L’enthousiasme hélas! c’est rien que pour nous, ce putain!
Je discernais très bien la route à ce moment et puis posés sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence, en blocs pâles. Serait‐ce ici la fin de tout? Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu’ils m’auraient fait mon affaire? Avant d’en finir? Et dans quel fossé? Le long duquel de ces murs? Ils m’achèveraient peut-être? D’un coup de couteau? Ils arrachaient parfois les mains, les yeux et le reste… On racontait bien des choses à ce propos et des pas drôles! Qui sait?.. Un pas du cheval… Encore un autre… suffiraient? Ces bêtes trottent chacune comme deux hommes en souliers de fer collés ensemble, avec un drôle de pas de gymnastique tout désuni.
Mon cœur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des côtes, agité, blotti, stupide.
Quand on se jette d’un trait du haut de la Tour Eiffel on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l’espace.
Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois, pas entièrement. Au centre d’une place, un minuscule jet d’eau glougloutait pour moi tout seul.
J’avais tout, pour moi tout seul, ce soir-là. J’étais propriétaire enfin, de la lune, du village, d’une peur énorme. J’allais me remettre au trot. Noirceur-sur-la-Lys ça devait être encore à une heure de route au moins, quand j’aperçus une lueur bien voilée au-dessus d’une porte. Je me dirigeai tout droit vers cette lueur et c’est ainsi que je me suis découvert une sorte d’audace, déserteuse il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l’avais bien vue. Je cognai. J’insistai, je cognai encore, j’interpellai très haut, mi en allemand, mi en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre.
La porte finit par s’entrouvrir, un battant.
« Qui êtes‐vous? » fit une voix. J’étais sauvé.
« Je suis un dragon…
– Un Français? » La femme qui parlait, je pouvais l’apercevoir.
« Oui, un Français…
– C’est qu’il en est passé ici tantôt des dragons allemands… Ils parlaient français aussi ceux-là…
– Oui, mais moi, je suis français pour de bon…
– Ah!.. »
Elle avait l’air d’en douter.
« Où sont-ils à présent? demandai-je.
– Ils sont repartis vers Noirceur sur les huit heures… » Et elle me montrait le nord avec le doigt.
Une jeune fille, un châle, un tablier blanc, sortaient aussi de l’ombre à présent, jusqu’au pas de la porte…
« Qu’est-ce qu’ils vous ont fait? que je lui ai demandé, les Allemands?
– Ils ont brûlé une maison près de la mairie et puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre… Comme il jouait sur le pont Rouge en les regardant passer… Tenez! qu’elle me montra… Il est là… »
Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j’avais surpris la lueur. Et j’aperçus – c’était vrai – au fond, le petit cadavre couché sur un matelas, habillé en costume marin; et le cou et la tête livides autant que la lueur même de la bougie, dépassaient d’un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés l’enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis, ils se mirent à gémir encore tous ensemble. Mais j’avais bien soif.
« Vous n’avez pas une bouteille de vin à me vendre? que je demandai.
– Faut vous adresser à la mère… Elle sait peut-être s’il y en a encore… Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt… »
Et alors, elles se mirent à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas.
« Y en a plus! qu’elle revint m’annoncer, la fille, les Allemands ont tout pris… Pourtant on leur en avait donné de nous-mêmes et beaucoup…
– Ah oui, alors, qu’ils en ont bu! que remarqua la mère, qui s’était arrêtée de pleurer, du coup. Ils aiment ça…
– Et plus de cent bouteilles, sûrement, ajouta le père, toujours à genoux lui…
– Y en a plus une seule alors? insistai-je, espérant encore, tellement j’avais grand-soif, et surtout de vin blanc, bien amer, celui qui réveille un peu. J’ veux bien payer…
– Y en a plus que du très bon. Y vaut cinq francs la bouteille… consentit alors la mère.
– C’est bien! » Et j’ai sorti mes cinq francs de ma poche, une grosse pièce.
« Va en chercher une! » lui commanda-t-elle tout doucement à la sœur.
La sœur prit la bougie et remonta un litre de la cachette un instant plus tard.
J’étais servi, je n’avais plus qu’à m’en aller.
« Ils vont revenir? demandai-je, inquiet à nouveau.
– Peut‐être, firent‐ils ensemble, mais alors ils brûleront tout… Ils l’ont promis en partant…
– Je vais aller voir ça.
– Vous êtes bien brave… C’est par là! » que m’indiquait le père, dans la direction de Noirceur-sur-la-Lys… Même il sortit sur la chaussée pour me regarder m’en aller. La fille et la mère demeurèrent craintives auprès du petit cadavre, en veillée.
« Reviens! qu’elles lui faisaient de l’intérieur. Rentre donc Joseph, t’as rien à faire sur la route, toi…
– Vous êtes bien brave », me dit-il encore le père, et il me serra la main.
Je repris, au trot, la route du Nord.
« Leur dites pas que nous sommes encore là au moins! » La fille était ressortie pour me crier cela.
« Ils le verront bien, demain, répondis-je, si vous êtes là! » J’étais pas content d’avoir donné mes cent sous. Il y avait ces cent sous entre nous. Ça suffit pour haïr, cent sous, et désirer qu’ils en crèvent tous. Pas d’amour à perdre dans ce monde, tant qu’il y aura cent sous.
« Demain! » répétaient-ils, eux, douteux…
Demain, pour eux aussi, c’était loin, ça n’avait pas beaucoup de sens un demain comme ça. Il s’agissait de vivre une heure de plus au fond pour nous tous, et une seule heure dans un monde où tout s’est rétréci au meurtre c’est déjà un phénomène.
Ce ne fut plus bien long. Je trottais d’arbre en arbre et m’attendais à être interpellé ou fusillé d’un moment à l’autre. Et puis rien.
Il devait être sur les deux heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le faîte d’une petite colline, au pas. De là j’ai aperçu tout d’un coup en contrebas des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés, et puis, au premier plan, une gare tout éclairée avec ses wagons, son buffet, d’où ne montait cependant aucun bruit… Rien. Des rues, des avenues, des réverbères, et encore d’autres parallèles de lumières, des quartiers entiers, et puis le reste autour, plus que du noir, du vide, avide autour de la ville, tout étendue elle, étalée devant moi, comme si on l’avait perdue la ville, tout allumée et répandue au beau milieu de la nuit. J’ai mis pied à terre et je me suis assis sur un petit tertre pour regarder ça pendant un bon moment.
Cela ne m’apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans Noirceur, mais comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d’habitude, s’ils étaient entrés et s’ils n’y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c’est sans doute qu’ils avaient des idées et des projets pas ordinaires.
Pas de canon non plus, c’était louche.
Mon cheval voulait se coucher lui aussi. Il tirait sur sa bride et cela me fit retourner. Quand je regardai à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé dans l’aspect du tertre devant moi, pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j’appelle. « Hé là! qui va là?.. » Ce changement dans la disposition de l’ombre avait eu lieu à quelques pas… Ce devait être quelqu’un…
« Gueule pas si fort! que répondit une voix d’homme lourde et enrouée, une voix qui avait l’air bien française.
– T’es à la traîne aussi toi? » qu’il me demande de même. À présent, je pouvais le voir. Un fantassin c’était, avec sa visière bien cassée « à la classe ». Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment-là, sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des cibles au tir autrefois dans les fêtes, les soldats.
Nous nous rapprochions. J’avais mon revolver à la main. J’aurais tiré sans savoir pourquoi, un peu plus.
« Écoute, qu’il me demande, tu les as vus, toi?
– Non, mais je viens par ici pour les voir.
– T’es du 145e dragons?
– Oui, et toi?
– Moi, je suis un réserviste…
– Ah! » que je fis. Ça m’étonnait, un réserviste. Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. On avait toujours été avec des hommes de l’active nous. Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. À cause de cela, je ne pouvais m’empêcher d’avoir un peu confiance en lui. C’était un petit quelque chose.
« J’en ai assez moi, qu’il répétait, je vais aller me faire paumer par les Boches… »
Il cachait rien.
« Comment que tu vas faire? »
Ça m’intéressait soudain, plus que tout, son projet, comment qu’il allait s’y prendre lui pour réussir à se faire paumer?
« J’ sais pas encore…
– Comment que t’as fait toujours pour te débiner?.. C’est pas facile de se faire paumer!
– J’ m’en fous, j’irai me donner.
– T’as donc peur?
– J’ai peur et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis, j’ m’en fous des Allemands moi, ils m’ont rien fait…
– Tais-toi, que je lui dis, ils sont peut-être à nous écouter… » J’avais comme envie d’être poli avec les Allemands. J’aurais bien voulu qu’il m’explique celui-là pendant qu’il y était, ce réserviste, pourquoi j avais pas de courage non plus moi, pour faire la guerre, comme tous les autres… Mais il n’expliquait rien, il répétait seulement qu’il en avait marre.
Il me raconta alors la débandade de son régiment, la veille, au petit jour, à cause des chasseurs à pied de chez nous, qui par erreur avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On les avait pas attendus à ce moment-là. Ils étaient arrivés trop tôt de trois heures sur l’heure prévue. Alors les chasseurs, fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l’air, on me l’avait joué.
« Moi, tu parles, si j’en ai profité! qu’il ajoutait. “Robinson, que je me suis dit! – C’est mon nom Robinson!.. Robinson Léon! – C’est maintenant ou jamais qu’il faut que tu les mettes”, que je me suis dit!.. Pas vrai? J’ai donc pris par le long d’un petit bois et puis là, figure‐toi, que j’ai rencontré notre capitaine… Il était appuyé à un arbre, bien amoché le piston!.. En train de crever qu’il était… Il se tenait la culotte à deux mains, à cracher… Il saignait de partout en roulant des yeux… Y avait personne avec lui. Il avait son compte… “Maman! maman!” qu’il pleurnichait tout en crevant et en pissant du sang aussi…
« “Finis ça! que je lui dis. Maman! Elle t’emmerde!”… Comme ça, dis donc, en passant!.. Sur le coin de la gueule!.. Tu parles si ça a dû le faire jouir la vache!.. Hein, vieux!.. C’est pas souvent, hein, qu’on peut lui dire ce qu’on pense, au capitaine… Faut en profiter. C’est rare!.. Et pour foutre le camp plus vite, j’ai laissé tomber le barda et puis les armes aussi… Dans une mare à canards qui était là à côté… Figure-toi que moi, comme tu me vois, j’ai envie de tuer personne, j’ai pas appris… J’aimais déjà pas les histoires de bagarre, déjà en temps de paix… Je m’en allais… Alors tu te rends compte?.. Dans le civil, j’ai essayé d’aller en usine régulièrement… J’étais même un peu graveur, mais j’aimais pas ça, à cause des disputes, j’aimais mieux vendre les journaux du soir et dans un quartier tranquille où j’étais connu, autour de la Banque de France… Place des Victoires si tu veux savoir… Rue des Petits-Champs… C’était mon lot… J’ dépassais jamais la rue du Louvre et le Palais-Royal d’un côté, tu vois d’ici… Je faisais le matin des commissions pour les commerçants… Une livraison l’après-midi de temps en temps, je bricolais quoi… Un peu manœuvre… Mais je veux pas d’armes moi!.. Si les Allemands te voient avec des armes, hein? T’es bon! Tandis que quand t’es en fantaisie, comme moi maintenant… Rien dans les mains… Rien dans les poches… Ils sentent qu’ils auront moins de mal à te faire prisonnier, tu comprends? Ils savent à qui ils ont affaire… Si on pouvait arriver à poil aux Allemands, c’est ça qui vaudrait encore mieux… Comme un cheval! Alors ils pourraient pas savoir de quelle armée qu’on est?..
– C’est vrai ça! »
Je me rendais compte que l’âge c’est quelque chose pour les idées. Ça rend pratique.
« C’est là qu’ils sont, hein? » Nous fixions et nous estimions ensemble nos chances et cherchions notre avenir comme aux cartes dans le grand plan lumineux que nous offrait la ville en silence.
« On y va? »
Il s’agissait de passer la ligne du chemin de fer d’abord. S’il y avait des sentinelles, on serait visés. Peut-être pas. Fallait voir. Passer au-dessus ou en dessous par le tunnel.
« Faut nous dépêcher, qu’a ajouté ce Robinson… C’est la nuit qu’il faut faire ça, le jour, il y a plus d’amis, tout le monde travaille pour la galerie, le jour, tu vois, même à la guerre c’est la foire… Tu prends ton canard avec toi? »
J’emmenai le canard. Prudence pour filer plus vite si on était mal accueillis. Nous parvînmes au passage à niveau, levés ses grands bras rouge et blanc. J’en avais jamais vu non plus des barrières de cette forme-là. Y en avait pas des comme ça aux environs de Paris.
« Tu crois qu’ils sont déjà entrés dans la ville, toi?
– C’est sûr! qu’il a dit… Avance toujours!.. »
On était à présent forcés d’être aussi braves que des braves, à cause du cheval qui avançait tranquillement derrière nous, comme s’il nous poussait avec son bruit, on n’entendait que lui. Toc! et toc! avec ses fers. Il cognait en plein dans l’écho, comme si de rien n’était.
Ce Robinson comptait donc sur la nuit pour nous sortir de là?.. On allait au pas tous les deux au milieu de la rue vide, sans ruse du tout, au pas cadencé encore, comme à l’exercice.
Il avait raison, Robinson, le jour était impitoyable, de la terre au ciel. Tels que nous allions sur la chaussée, on devait avoir l’air bien inoffensifs tous les deux toujours, bien naïfs même, comme si l’on rentrait de permission. « T’as entendu dire que le Ier hussards a été fait prisonnier tout entier?.. dans Lille?.. Ils sont entrés comme ça, qu’on a dit, ils savaient pas, hein! le colonel devant… Dans une rue principale mon ami! Ça s’est refermé… Par-devant… Par-derrière… Des Allemands partout!.. Aux fenêtres!.. Partout… Ça y était… Comme des rats qu’ils étaient faits!.. Comme des rats! Tu parles d’un filon!..
– Ah! les vaches!..
– Ah dis donc! Ah dis donc!.. » On n’en revenait pas nous autres de cette admirable capture, si nette, si définitive… On en bavait. Les boutiques portaient toutes leurs volets clos, les pavillons d’habitation aussi, avec leur petit jardin par-devant, tout ça bien propre. Mais après la Poste on a vu que l’un de ces pavillons, un peu plus blanc que les autres, brillait de toutes ses lumières à toutes les fenêtres, au premier comme à l’entresol. On a été sonner à la porte. Notre cheval toujours derrière nous. Un homme épais et barbu nous ouvrit. « Je suis le Maire de Noirceur – qu’il a annoncé tout de suite, sans qu’on lui demande – et j’attends les Allemands! » Et il est sorti au clair de lune pour nous reconnaître le Maire. Quand il s’aperçut que nous n’étions pas des Allemands nous, mais encore bien des Français, il ne fut plus si solennel, cordial seulement. Et puis gêné aussi. Évidemment, il ne nous attendait plus, nous venions un peu en travers des dispositions qu’il avait dû prendre, des résolutions arrêtées. Les Allemands devaient entrer à Noirceur cette nuit-là, il était prévenu et il avait tout réglé avec la Préfecture, leur colonel ici, leur ambulance là-bas, etc. Et s’ils entraient à présent? Nous étant là? Ça ferait sûrement des histoires! Ça créerait sûrement des complications… Cela il ne nous le dit pas nettement, mais on voyait bien qu’il y pensait.
Alors il se mit à nous parler de l’intérêt général, dans la nuit, là, dans le silence où nous étions perdus. Rien que de l’intérêt général… Des biens matériels de la communauté… Du patrimoine artistique de Noirceur, confié à sa charge, charge sacrée, s’il en était une… De l’église du XVe siècle notamment… S’ils allaient la brûler l’église du XVe ? Comme celle de Condé-sur-Yser à côté! Hein?.. Par simple mauvaise humeur… Par dépit de nous trouver là nous… Il nous fit ressentir toute la responsabilité que nous encourions… Inconscients jeunes soldats que nous étions!.. Les Allemands n’aimaient pas les villes louches où rôdaient encore des militaires ennemis. C’était bien connu.
Pendant qu’il nous parlait ainsi à mi-voix, sa femme et ses deux filles, grosses et appétissantes blondes, l’approuvaient fort, de-ci, de-là, d’un mot… On nous rejetait, en somme. Entre nous, flottaient les valeurs sentimentales et archéologiques, soudain fort vives, puisqu’il n’y avait plus personne à Noirceur dans la nuit pour les contester… Patriotiques, morales, poussées par des mots, fantômes qu’il essayait de rattraper, le Maire, mais qui s’estompaient aussitôt vaincus par notre peur et notre égoïsme à nous et aussi par la vérité pure et simple.
Il s’épuisait en de touchants efforts, le Maire de Noirceur, ardent à nous persuader que notre Devoir était bien de foutre le camp tout de suite à tous, les diables, moins brutal certes mais tout aussi décidé dans son genre que notre commandant Pinçon.
De certain, il n’y avait à opposer décidément à tous ces puissants que notre petit désir, à nous deux, de ne pas mourir et de ne pas brûler. C’était peu, surtout que ces choses-là ne peuvent pas se déclarer pendant la guerre. Nous retournâmes donc vers d’autres rues vides. Décidément tous les gens que j’avais rencontrés pendant cette nuit-là m’avaient montré leur âme.
« C’est bien ma chance! qu’il remarqua Robinson comme on s’en allait. Tu vois. si seulement t’avais été un Allemand toi, comme t’es un bon gars aussi, tu m’aurais fait prisonnier et ça aurait été une bonne chose de faite… On a du mal à se débarrasser de soi-même en guerre!
– Et toi, que je lui ai dit, si t’avais été un Allemand, tu m’aurais pas fait prisonnier aussi? T’aurais peut-être alors eu leur médaille militaire! Elle doit s’appeler d’un drôle de mot en allemand leur médaille militaire, hein? »
Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prisonniers, nous finîmes par aller nous asseoir sur un banc dans un petit square et on a mangé alors la boîte de thon que Robinson Léon promenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. Très au loin, on entendait du canon à présent, mais vraiment très loin. S’ils avaient pu rester chacun de leur côté, les ennemis, et nous laisser là tranquilles!
Après ça, c’est un quai qu’on a suivi; et le long des péniches à moitié déchargées, dans l’eau, à longs jets, on a uriné. On emmenait toujours le cheval à la bride, derrière nous, comme un très gros chien, mais près du Pont, dans la maison du Pasteur, à une seule pièce, sur un matelas aussi, était étendu encore un mort, tout seul, un Français, commandant de chasseurs à cheval qui ressemblait d’ailleurs un peu à ce Robinson, comme tête.
« Tu parles qu’il est vilain! que me fit remarquer Robinson. Moi j’aime pas les morts…
– Le plus curieux, que je lui répondis, c’est qu’il te ressemble un peu. Il a un long nez comme le tien et toi t’es pas beaucoup moins jeune que lui…
– Ce que tu vois, c’est par la fatigue, forcément qu’on se ressemble un peu tous, mais si tu m’avais vu avant… Quand je faisais de la bicyclette tous les dimanches!.. J’étais beau gosse! J’avais des mollets, mon vieux! Du sport, tu sais! Et ça développe les cuisses aussi… »
On est ressortis, l’allumette qu’on avait prise pour le regarder s’était éteinte.
« Tu vois, c’est trop tard, tu vois!.. »
Une longue raie grise et verte soulignait déjà au loin la crête du coteau, à la limite de la ville, dans la nuit; le Jour! Un de plus! Un de moins! Il faudrait essayer de passer à travers celui-là encore comme à travers les autres, devenus des espèces de cerceaux de plus en plus étroits, les jours, et tout remplis avec des trajectoires et des éclats de mitraille.
« Tu reviendras pas par ici toi, dis, la nuit prochaine? qu’il demanda en me quittant.
– Il n’y a pas de nuit prochaine, mon vieux!.. Tu te prends donc pour un général!
– J’ pense plus à rien, moi, qu’il a fait, pour finir… À rien, t’entends!.. J’ pense qu’à pas crever… Ça suffit… J’ me dis qu’un jour de gagné, c’est toujours un jour de plus!
– T’as raison… Au revoir, vieux, et bonne chance!..
– Bonne chance à toi aussi! Peut-être qu’on se reverra! »
On est retournés chacun dans la guerre. Et puis il s’est passé des choses et encore des choses, qu’il est pas facile de raconter à présent, à cause que ceux d’aujourd’hui ne les comprendraient déjà plus.
Pour être bien vus et considérés, il a fallu se dépêcher dare-dare de devenir bien copains avec les civils parce qu’eux, à l’arrière, ils devenaient à mesure que la guerre avançait, de plus en plus vicieux. Tout de suite j’ai compris ça en rentrant à Paris et aussi que leurs femmes avaient le feu au derrière, et les vieux des gueules grandes comme ça, et les mains partout, aux culs, aux poches.
On héritait des combattants à l’arrière, on avait vite appris la gloire et les bonnes façons de la supporter courageusement et sans douleur.
Les mères, tantôt infirmières, tantôt martyres, ne quittaient plus leurs longs voiles sombres, non plus que le petit diplôme que le Ministre leur faisait remettre à temps par l’employé de la Mairie. En somme, les choses s’organisaient.
Pendant des funérailles soignées on est bien tristes aussi, mais on pense quand même à l’héritage, aux vacances prochaines, à la veuve qui est mignonne, et qui a du tempérament, dit-on, et à vivre encore, soi-même, par contraste, bien longtemps, à ne crever jamais peut-être… Qui sait?
Quand on suit ainsi l’enterrement, tous les gens vous envoient des grands coups de chapeau. Ça fait plaisir. C’est le moment alors de bien se tenir, d’avoir l’air convenable, de ne pas rigoler tout haut, de se réjouir seulement en dedans. C’est permis. Tout est permis en dedans.
Dans le temps de la guerre, au lieu de danser à l’entresol, on dansait dans la cave. Les combattants le toléraient et mieux encore, ils aimaient ça. Ils en demandaient dès qu’ils arrivaient et personne ne trouvait ces façons louches. Y a que la bravoure au fond qui est louche. Être brave avec son corps? Demandez alors à l’asticot aussi d’être brave, il est rose et pâle et mou, tout comme nous.
Pour ma part, je n’avais plus à me plaindre. J’étais même en train de m’affranchir par la médaille militaire que j’avais gagnée, la blessure et tout. En convalescence, on me l’avait apportée la médaille, à l’hôpital même. Et le même jour, je m’en fus au théâtre, la montrer aux civils pendant les entractes. Grand effet. C’était les premières médailles qu’on voyait dans Paris. Une affaire!
C’est même à cette occasion, qu’au foyer de l’Opéra-Comique, j’ai rencontré la petite Lola d’Amérique et c’est à cause d’elle que je me suis tout à fait dessalé.
Il existe comme ça certaines dates qui comptent parmi tant de mois où on aurait très bien pu se passer de vivre. Ce jour de la médaille à l’Opéra-Comique fut dans la mienne, décisif.
À cause d’elle, de Lola, je suis devenu tout curieux des États-Unis, à cause des questions que je lui posais tout de suite et auxquelles elle ne répondait qu’à peine. Quand on est lancé de la sorte dans les voyages, on revient quand on peut et comme on peut…
Au moment dont je parle, tout le monde à Paris voulait posséder son petit uniforme. Il n’y avait guère que les neutres et les espions qui n’en avaient pas, et ceux-là c’était presque les mêmes. Lola avait le sien d’uniforme officiel et un vrai bien mignon, rehaussé de petites croix rouges partout, sur les manches, sur son menu bonnet de police, coquinement posé de travers toujours sur ses cheveux ondulés. Elle était venue nous aider à sauver la France, confiait‐elle au Directeur de l’hôtel, dans la mesure de ses faibles forces, mais avec tout son cœur! Nous nous comprîmes tout de suite, mais pas complètement toutefois, parce que les élans du cœur m’étaient devenus tout à fait désagréables. Je préférais ceux du corps, tout simplement. Il faut s’en méfier énormément du cœur, on me l’avait appris et comment! à la guerre. Et je n’étais pas près de l’oublier.
Le cœur de Lola était tendre, faible et enthousiaste. Le corps était gentil, très aimable, et il fallut bien que je la prisse dans son ensemble comme elle était. C’était une gentille fille après tout Lola, seulement, il y avait la guerre entre nous, cette foutue énorme rage qui poussait la moitié des humains, aimants ou non, à envoyer l’autre moitié vers l’abattoir. Alors ça gênait dans les relations, forcément, une manie comme celle-là. Pour moi qui tirais sur ma convalescence tant que je pouvais et qui ne tenais pas du tout à reprendre mon tour au cimetière ardent des batailles, le ridicule de notre massacre m’apparaissait, clinquant, à chaque pas que je faisais dans la ville. Une roublardise immense s’étalait partout.
Cependant j’avais peu de chances d’y échapper, je n’avais aucune des relations indispensables pour s’en tirer. Je ne connaissais que des pauvres, c’est-à-dire des gens dont la mort n’intéresse personne. Quant à Lola, il ne fallait pas compter sur elle pour m’embusquer. Infirmière comme elle était, on ne pouvait rêver, sauf Ortolan peut-être, d’un être plus combatif que cette enfant charmante. Avant d’avoir traversé la fricassée boueuse des héroïsmes, son petit air Jeanne d’Arc m’aurait peut-être excité, converti, mais à présent, depuis mon enrôlement de la place Clichy, j’étais devenu devant tout héroïsme verbal ou réel, phobiquement rébarbatif. J’étais guéri, bien guéri.
Pour la commodité des dames du Corps expéditionnaire américain, le groupe des infirmières dont Lola faisait partie logeait à l’hôtel Paritz et pour lui rendre, à elle particulièrement, les choses encore plus aimables, il lui fut confié (elle avait des relations) dans l’hôtel même, la Direction d’un service spécial, celui des beignets aux pommes pour les hôpitaux de Paris. Il s’en distribuait ainsi chaque matin des milliers de douzaines. Lola remplissait cette fonction bénigne avec un certain petit zèle qui devait d’ailleurs un peu plus tard tourner tout à fait mal.
Lola, il faut le dire, n’avait jamais confectionné de beignets de sa vie. Elle embaucha donc un certain nombre de cuisinières mercenaires, et les beignets furent, après quelques essais, prêts à être livrés ponctuellement juteux, dorés et sucrés à ravir. Lola n’avait plus en somme qu’à les goûter avant qu’on les expédiât dans les divers services hospitaliers. Chaque matin Lola se levait dès dix heures et descendait, ayant pris son bain, vers les cuisines situées profondément auprès des caves. Cela, chaque matin, je le dis, et seulement vêtue d’un kimono japonais noir et jaune qu’un ami de San Francisco lui avait offert la veille de son départ.
Tout marchait parfaitement en somme et nous étions bien en train de gagner la guerre, quand certain beau jour, à l’heure du déjeuner, je la trouvai bouleversée, se refusant à toucher un seul plat du repas. L’appréhension d’un malheur arrivé, d’une maladie soudaine me gagna. Je la suppliai de se fier à mon affection vigilante.
D’avoir goûté ponctuellement les beignets pendant tout un mois, Lola avait grossi de deux bonnes livres! Son petit ceinturon témoignait d’ailleurs, par un cran, du désastre. Vinrent les larmes. Essayant de la consoler, de mon mieux, nous parcourûmes, sous le coup de l’émotion, en taxi, plusieurs pharmaciens, très diversement situés. Par hasard, implacables, toutes les balances confirmèrent que les deux livres étaient bel et bien acquises, indéniables. Je suggérai alors qu’elle abandonne son service à une collègue qui, elle, au contraire, recherchait des « avantages ». Lola ne voulut rien entendre de ce compromis qu’elle considérait comme une honte et une véritable petite désertion dans son genre. C’est même à cette occasion qu’elle m’apprit que son arrière-grand-oncle avait fait, lui aussi, partie de l’équipage à tout jamais glorieux du Mayflower débarqué à Boston en 1677, et qu’en considération d’une pareille mémoire, elle ne pouvait songer à se dérober, elle, au devoir des beignets, modeste certes, mais sacré quand même.
Toujours est-il que de ce jour, elle ne goûtait plus les beignets que du bout des dents, qu’elle possédait d’ailleurs toutes bien rangées et mignonnes. Cette angoisse de grossir était arrivée à lui gâter tout plaisir. Elle dépérit. Elle eut en peu de temps aussi peur des beignets que moi des obus. Le plus souvent à présent, nous allions nous promener par hygiène de long en large, à cause des beignets, sur les quais, sur les boulevards, mais nous n’entrions plus au Napolitain, à cause des glaces qui font, elles aussi, engraisser les dames.
Jamais je n’avais rien rêvé d’aussi confortablement habitable que sa chambre, toute bleu pâle, avec une salle de bains à côté. Des photos de ses amis, partout, des dédicaces, peu de femmes, beaucoup d’hommes, de beaux garçons, bruns et frisés, son genre, elle me parlait de la couleur de leurs yeux, et puis de ces dédicaces tendres, solennelles, et toutes, définitives. Au début, pour la politesse, ça me gênait, au milieu de toutes ces effigies, et puis on s’habitue.
Dès que je cessais de l’embrasser, elle y revenait, je n’y coupais pas, sur les sujets de la guerre ou des beignets. La France tenait de la place dans nos conversations. Pour Lola, la France demeurait une espèce d’entité chevaleresque, aux contours peu définis dans l’espace et le temps, mais en ce moment dangereusement blessée et à cause de cela même très excitante. Moi, quand on me parlait de la France, je pensais irrésistiblement à mes tripes, alors forcément, j’étais beaucoup plus réservé pour ce qui concernait l’enthousiasme. Chacun sa terreur. Cependant, comme elle était complaisante au sexe, je l’écoutais sans jamais la contredire. Mais question d’âme, je ne la contentais guère. C’est tout vibrant, tout rayonnant qu’elle m’aurait voulu et moi, de mon côté, je ne concevais pas du tout pourquoi j’aurais été dans cet état-là, sublime, je voyais au contraire mille raisons, toutes irréfutables, pour demeurer d’humeur exactement contraire.
Lola, après tout, ne faisait que divaguer de bonheur et d’optimisme, comme tous les gens qui sont du bon côté de la vie, celui des privilèges, de la santé, de la sécurité et qui en ont encore pour longtemps à vivre.
Elle me tracassait avec les choses de l’âme, elle en avait plein la bouche. L’âme, c’est la vanité et le plaisir du corps tant qu’il est bien portant, mais c’est aussi l’envie d’en sortir du corps dès qu’il est malade ou que les choses tournent mal. On prend des deux poses celle qui vous sert le plus agréablement dans le moment et voilà tout! Tant qu’on peut choisir entre les deux, ça va. Mais moi, je ne pouvais plus choisir, mon jeu était fait! J’étais dans la vérité jusqu’au trognon, et même que ma propre mort me suivait pour ainsi dire pas à pas. J’avais bien du mal à penser à autre chose qu’à mon destin d’assassiné en sursis, que tout le monde d’ailleurs trouvait pour moi tout à fait normal.
Cette espèce d’agonie différée, lucide, bien portante, pendant laquelle il est impossible de comprendre autre chose que des vérités absolues, il faut l’avoir endurée pour savoir à jamais ce qu’on dit.
Ma conclusion c’était que les Allemands pouvaient arriver ici, massacrer, saccager, incendier tout, l’hôtel, les beignets, Lola, les Tuileries, les Ministres, leurs petits amis, la Coupole, le Louvre, les Grands Magasins, fondre sur la ville, y foutre le tonnerre de Dieu, le feu de l’enfer, dans cette foire pourrie à laquelle on ne pouvait vraiment plus rien ajouter de plus sordide, et que moi, je n’avais cependant vraiment rien à perdre, rien, et tout à gagner.
On ne perd pas grand-chose quand brûle la maison du propriétaire. Il en viendra toujours un autre, si ce n’est pas toujours le même, Allemand ou Français, ou Anglais ou Chinois, pour présenter, n’est-ce pas, sa quittance à l’occasion… En marks ou francs? Du moment qu’il faut payer…
En somme, il était salement mauvais, le moral. Si je lui avais dit ce que je pensais de la guerre, à Lola, elle m’aurait pris pour un monstre tout simplement, et chassé des dernières douceurs de son intimité. Je m’en gardais donc bien, de lui faire ces aveux. J’éprouvais, d’autre part, quelques difficultés et rivalités encore. Certains officiers essayaient de me la souffler, Lola. Leur concurrence était redoutable, armés qu’ils étaient eux, des séductions de leur Légion d’honneur. Or, on se mit à en parler beaucoup de cette fameuse Légion d’honneur dans les journaux américains. Je crois même qu’à deux ou trois reprises où je fus cocu, nos relations eussent été très menacées, si au même moment cette frivole ne m’avait découvert soudain une utilité supérieure, celle qui consistait à goûter chaque matin les beignets à sa place.
Cette spécialisation de la dernière minute me sauva. De ma part, elle accepta le remplacement. N’étais-je pas moi aussi un valeureux combattant, donc digne de cette fonction de confiance! Dès lors, nous ne fûmes plus seulement amants mais associés. Ainsi débutèrent les temps modernes.
Son corps était pour moi une joie qui n’en finissait pas. Je n’en avais jamais assez de le parcourir ce corps américain. J’étais à vrai dire un sacré cochon. Je le demeurai.
Je me formai même à cette conviction bien agréable et renforçatrice qu’un pays apte à produire des corps aussi audacieux dans leur grâce et d’une envolée spirituelle aussi tentante devait offrir bien d’autres révélations capitales au sens biologique il s’entend.
Je décidai, à force de peloter Lola, d’entreprendre tôt ou tard le voyage aux États-Unis, comme un véritable pèlerinage et cela dès que possible. Je n’eus en effet de cesse et de repos (à travers une vie pourtant implacablement contraire et tracassée) avant d’avoir mené à bien cette profonde aventure, mystiquement anatomique.
Je reçus ainsi tout près du derrière de Lola le message d’un nouveau monde. Elle n’avait pas qu’un corps Lola, entendons-nous, elle était ornée aussi d’une tête menue, mignonne et un peu cruelle à cause des yeux bleu grisaille qui lui remontaient d’un tantinet vers les angles, tels ceux des chats sauvages.
Rien que la regarder en face, me faisait venir l’eau à la bouche comme par un petit goût de vin sec, de silex. Des yeux durs en résumé, et point animés par cette gentille vivacité commerciale, orientalo-fragonarde qu’ont presque tous les yeux de par ici.
Nous nous retrouvions le plus souvent dans un café d’à côté. Les blessés de plus en plus nombreux clopinaient à travers les rues, souvent débraillés. À leur bénéfice il s’organisait des quêtes, « Journées » pour ceux-ci, pour ceux-là, et surtout pour les organisateurs des « Journées ». Mentir, baiser, mourir. Il venait d’être défendu d’entreprendre autre chose. On mentait avec rage au-delà de l’imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l’absurde, dans les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture. Tout le monde s’y était mis. C’est à qui mentirait plus énormément que l’autre. Bientôt, il n’y eut plus de vérité dans la ville.
Le peu qu’on y trouvait en 1914, on en était honteux à présent. Tout ce qu’on touchait était truqué, le sucre, les avions, les sandales, les confitures, les photos; tout ce qu’on lisait, avalait, suçait, admirait, proclamait, réfutait, défendait, tout cela n’était que fantômes haineux, truquages et mascarades. Les traîtres eux-mêmes étaient faux. Le délire de mentir et de croire s’attrape comme la gale. La petite Lola ne connaissait du français que quelques phrases mais elles étaient patriotiques: « On les aura!.. », « Madelon, viens!.. » C’était à pleurer.
Elle se penchait ainsi sur notre mort avec entêtement, impudeur, comme toutes les femmes d’ailleurs, dès que la mode d’être courageuse pour les autres est venue.
Et moi qui précisément me découvrais tant de goût pour toutes les choses qui m’éloignaient de la guerre! Je lui demandai à plusieurs reprises des renseignements sur son Amérique à Lola, mais elle ne me répondait alors que par des commentaires tout à fait vagues, prétentieux et manifestement incertains, tendant à faire sur mon esprit une brillante impression.
Mais, je me méfiais des impressions à présent. On m’avait possédé une fois à l’impression, on ne m’aurait plus au boniment. Personne.
Je croyais à son corps, je ne croyais pas à son esprit. Je la considérais comme une charmante embusquée, la Lola, à l’envers de la guerre, à l’envers de la vie.
Elle traversait mon angoisse avec la mentalité du Petit Journal: Pompon, Fanfare, ma Lorraine et gants blancs… En attendant je lui faisais des politesses de plus en plus fréquentes, parce que je lui avais assuré que ça la ferait maigrir. Mais elle comptait plutôt sur nos longues promenades pour y parvenir. Je les détestais, quant à moi, les longues promenades. Mais elle insistait.
Nous fréquentions ainsi très sportivement le Bois de Boulogne, pendant quelques heures, chaque après-midi, le « Tour des Lacs ».
La nature est une chose effrayante et même quand elle est fermement domestiquée, comme au Bois, elle donne encore une sorte d’angoisse aux véritables citadins. Ils se livrent alors assez facilement aux confidences. Rien ne vaut le Bois de Boulogne, tout humide, grillagé, graisseux et pelé qu’il est, pour faire affluer les souvenirs, incoercibles, chez les gens des villes en promenade entre les arbres. Lola n’échappait pas à cette mélancolique et confidente inquiétude. Elle me raconta mille choses à peu près sincères, en nous promenant ainsi, sur sa vie de New York, sur ses petites amies de là-bas.
Je n’arrivais pas à démêler tout à fait le vraisemblable, dans cette trame compliquée de dollars, de fiançailles, de divorces, d’achats de robes et de bijoux dont son existence me paraissait comblée.
Nous allâmes ce jour‐là vers le champ de courses. On rencontrait encore dans ces parages des fiacres nombreux et des enfants sur des ânes, et d’autres enfants à faire de la poussière et des autos bondées de permissionnaires qui n’arrêtaient pas de chercher en vitesse des femmes vacantes par les petites allées, entre deux trains, soulevant plus de poussière encore, pressés d’aller dîner et de faire l’amour, agités et visqueux, aux aguets, tracassés par l’heure implacable et le désir de vie. Ils en transpiraient de passion et de chaleur aussi.
Le Bois était moins bien tenu qu’à l’habitude, négligé, administrativement en suspens.
« Cet endroit devait être bien joli avant la guerre?.. remarquait Lola. Élégant?.. Racontez-moi, Ferdinand!.. Les courses ici?.. Était-ce comme chez nous à New York?.. »
À vrai dire, je n’y étais jamais allé, moi, aux courses avant la guerre, mais j’inventais instantanément pour la distraire cent détails colorés sur ce sujet, à l’aide des récits qu’on m’en avait faits, à droite et à gauche. Les robes… Les élégantes… Les coupés étincelants… Le départ… Les trompes allègres et volontaires… Le saut de la rivière… Le Président de la République… La fièvre ondulante des enjeux, etc.
Elle lui plut si fort ma description idéale que ce récit nous rapprocha. À partir de ce moment, elle crut avoir découvert Lola que nous avions au moins un goût en commun, chez moi bien dissimulé, celui des solennités mondaines. Elle m’en embrassa même spontanément d’émotion, ce qui lui arrivait rarement, je dois le dire. Et puis la mélancolie des choses à la mode révolues la touchait. Chacun pleure à sa façon le temps qui passe. Lola c’était par les modes mortes qu’elle s’apercevait de la fuite des années.
« Ferdinand, demanda-t-elle, croyez-vous qu’il y en aura encore des courses dans ce champ-là?
– Quand la guerre sera finie, sans doute, Lola…
– Cela n’est pas certain, n’est-ce pas?..
– Non, pas certain… »
Cette possibilité qu’il n’y eût plus jamais de courses à Longchamp la déconcertait. La tristesse du monde saisit les êtres comme elle peut, mais à les saisir elle semble parvenir presque toujours.
« Supposez qu’elle dure encore longtemps la guerre, Ferdinand, des années par exemple… Alors il sera trop tard pour moi… Pour revenir ici… Me comprenez-vous Ferdinand?.. J’aime tant, vous savez, les jolis endroits comme ceux-ci… Bien mondains… Bien élégants… Il sera trop tard… Pour toujours trop tard… Peut-être… Je serai vieille alors, Ferdinand. Quand elles reprendront les réunions… Je serai vieille déjà… Vous verrez Ferdinand, il sera trop tard… Je sens qu’il sera trop tard… »
Et la voilà retournée dans sa désolation, comme pour les deux livres. Je lui donnai pour la rassurer toutes les espérances auxquelles je pouvais penser… Qu’elle n’avait en somme que vingt et trois années… Que la guerre allait passer bien vite… Que les beaux jours reviendraient… Comme avant, plus beaux qu’avant. Pour elle au moins… Mignonne comme elle était… Le temps perdu! Elle le rattraperait sans dommage!.. Les nommages… Les admirations, ne lui manqueraient pas de sitôt… Elle fit semblant de ne plus avoir de peine pour me faire plaisir.
« Il faut marcher encore? demandait-elle.
– Pour maigrir?
– Ah! c’est vrai, j’oubliais cela… »
Nous quittâmes Longchamp, les enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Les permissionnaires pourchassaient encore le Bonheur, mais hors des futaies à présent, traqué qu’il devait être, le Bonheur, entre les terrasses de la Porte Maillot.
Nous longions les berges vers Saint-Cloud, voilées du halo dansant des brumes qui montent de l’automne. Près du pont, quelques péniches touchaient du nez les arches, durement enfoncées dans l’eau par le charbon jusqu’au plat-bord.
L’immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Ces arbres ont la douce ampleur et la force des grands rêves. Seulement des arbres, je m’en méfiais aussi depuis que j’étais passé par leurs embuscades. Un mort derrière chaque arbre. La grande allée montait entre deux rangées roses vers les fontaines. À côté du kiosque la vieille dame aux sodas semblait lentement rassembler toutes les ombres du soir autour de sa jupe. Plus loin dans les chemins de côté flottaient les grands cubes et rectangles tendus de toiles sombres, les baraques d’une fête que la guerre avait surprise là, et comblée soudain de silence.
« C’est voilà un an qu’ils sont partis déjà! nous rappelait la vieille aux sodas. À présent, il n’y passe pas deux personnes par jour ici… J’y viens encore moi par l’habitude… On voyait tant de monde par ici!.. »
Elle n’avait rien compris la vieille au reste de ce qui s’était passé, rien que cela. Lola voulut que nous passions auprès de ces tentes vides, une drôle d’envie triste qu’elle avait.
Nous en comptâmes une vingtaine, des longues garnies de glaces, des petites, bien plus nombreuses, des confiseries foraines, des loteries, un petit théâtre même, tout traversé de courants d’air; entre chaque arbre il y en avait, partout, des baraques, l’une d’elles, vers la grande allée, n’avait même plus ses rideaux, éventée comme un vieux mystère.
Elles penchaient déjà vers les feuilles et la boue les tentes. Nous nous arrêtâmes auprès de la dernière, celle qui s’inclinait plus que les autres et tanguait sur ses poteaux, dans le vent, comme un bateau, voiles folles, prêt à rompre sa dernière corde. Elle vacillait, sa toile du milieu secouait dans le vent montant, secouait vers le ciel, au-dessus du toit. Au fronton de la baraque on lisait son vieux nom en vert et rouge; c’était la baraque d’un tir: Le Stand des Nations qu’il s’appelait.
Plus personne pour le garder non plus. Il tirait peut-être avec les autres le propriétaire à présent, avec les clients.
Comme les petites cibles dans la boutique en avaient reçu des balles! Toutes criblées de petits points blancs! Une noce pour la rigolade que ça représentait: au premier rang, en zinc, la mariée avec ses fleurs, le cousin, le militaire, le promis, avec une grosse gueule rouge, et puis au deuxième rang des invités encore, qu’on avait dû tuer bien des fois quand elle marchait encore la fête.
« Je suis sûre que vous devez bien tirer, vous Ferdinand? Si c’était la fête encore, je ferais un match avec vous!.. N’est-ce pas que vous tirez bien Ferdinand?
– Non, je ne tire pas très bien… »
Au dernier rang derrière la noce, un autre rang peinturluré, la Mairie avec son drapeau. On devait tirer dans la Mairie aussi quand ça fonctionnait, dans les fenêtres qui s’ouvraient alors d’un coup sec de sonnette, sur le petit drapeau en zinc même on tirait. Et puis sur le régiment qui défilait, en pente, à côté, comme le mien, place Clichy, celui-ci entre les pipes et les petits ballons, sur tout ça on avait tiré tant qu’on avait pu, à présent sur moi on tirait, hier, demain.
« Sur moi aussi qu’on tire Lola! que je ne pus m’empêcher de lui crier.
– Venez! fit‐elle alors… Vous dites des bêtises, Ferdinand, et nous allons attraper froid. »
Nous descendîmes vers Saint-Cloud par la grande allée, la Royale, en évitant la boue, elle me tenait par la main, la sienne était toute petite, mais je ne pouvais plus penser à autre chose qu’à la noce en zinc du Stand de là-haut qu’on avait laissée dans l’ombre de l’allée. J’oubliais même de l’embrasser Lola, c’était plus fort que moi. Je me sentais tout bizarre. C’est même à partir de ce moment‐là, je crois, que ma tête est devenue si difficile à tranquilliser avec ses idées dedans.
Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud, il faisait tout à fait sombre.
« Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval? Vous aimez bien Duval, vous… Cela vous changerait les idées… On y rencontre toujours beaucoup de monde… À moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre? » Elle était bien prévenante, en somme, ce soir-là.
Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à table que l’endroit me parut insensé. Tous ces gens assis en rangs autour de nous me donnaient l’impression d’attendre eux aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu’ils bouffaient.
« Allez-vous-en tous! que je les ai prévenus. Foutez le camp! on va tirer! Vous tuer! Nous tuer tous! »
On m’a ramené à l’hôtel de Lola, en vitesse. Je voyais partout la même chose. Tous les gens qui défilaient dans les couloirs du Paritz semblaient aller se faire tirer et les employés derrière la grande Caisse, eux aussi, tout juste faits pour ça, et le type d’en bas même, du Paritz, avec son uniforme bleu comme le ciel et doré comme le soleil, le concierge qu’on l’appelait, et puis des militaires, des officiers déambulants, des généraux, moins beaux que lui bien sûr, mais en uniforme quand même, partout un tir immense, dont on ne sortirait pas, ni les uns ni les autres. Ce n’était plus une rigolade.
« On va tirer! que je leur criais moi, du plus fort que je pouvais, au milieu du grand salon. On va tirer! Foutez donc le camp tous!.. » Et puis par la fenêtre que j’ai crié ça aussi. Ça me tenait. Un vrai scandale. « Pauvre soldat! » qu’on disait. Le concierge m’a emmené au bar bien doucement, par l’amabilité. Il m’a fait boire et j’ai bien bu, et puis enfin les gendarmes sont venus me chercher, plus brutalement eux. Dans le Stand des Nations il y en avait aussi des gendarmes. Je les avais vus. Lola m’embrassa et les aida à m’emmener avec leurs menottes.
Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu’ils ont expliqué à l’hôpital, par la peur. C’était possible. La meilleure des choses à faire, n’est-ce pas, quand on est dans ce monde, c’est d’en sortir? Fou ou pas, peur ou pas.
Ça a fait des histoires. Les uns ont dit: « Ce garçon-là, c’est un anarchiste, on va donc le fusiller, c’est le moment, et tout de suite, y a pas à hésiter, faut pas lanterner, puisque c’est la guerre!.. » Mais il y en avait d’autres, plus patients, qui voulaient que je soye seulement syphilitique et bien sincèrement fol et qu’on m’enferme en conséquence jusqu’à la paix, ou tout au moins pendant des mois, parce qu’eux les pas fous, qui avaient toute leur raison, qu’ils disaient, ils voulaient me soigner pendant qu’eux seulement ils feraient la guerre. Ça prouve que pour qu’on vous croye raisonnable, rien de tel que de posséder un sacré culot. Quand on a un bon culot, ça suffit, presque tout alors vous est permis, absolument tout, on a la majorité pour soi et c’est la majorité qui décrète de ce qui est fou et ce qui ne l’est pas.
Cependant mon diagnostic demeurait très douteux. Il fut donc décidé par les autorités de me mettre en observation pendant un temps. Ma petite amie Lola eut la permission de me rendre quelques visites, et ma mère aussi. C’était tout.
Nous étions hébergés nous, les blessés troubles, dans un lycée d’Issy-les-Moulineaux, organisé bien exprès pour recevoir et traquer doucement ou fortement aux aveux, selon les cas, ces soldats dans mon genre dont l’idéal patriotique était simplement compromis ou tout à fait malade. On ne nous traitait pas absolument mal, mais on se sentait tout le temps, tout de même, guetté par un personnel d’infirmiers silencieux et dotés d’énormes oreilles.
Après quelque temps de soumission à cette surveillance on sortait discrètement pour s’en aller, soit vers l’asile d’aliénés, soit au front, soit encore assez souvent au poteau.
Parmi les copains rassemblés dans ces locaux louches, je me demandais toujours lequel était en train, parlant bas au réfectoire, de devenir un fantôme.
Près de la grille, à l’entrée, dans son petit pavillon, demeurait la concierge, celle qui nous vendait des sucres d’orge et des oranges et ce qu’il fallait en même temps pour se recoudre des boutons. Elle nous vendait encore en plus, du plaisir. Pour les sous‐officiers, c’était dix francs le plaisir. Tout le monde pouvait en avoir. Seulement en se méfiant des confidences qu’on lui faisait trop aisément dans ces moments-là. Elles pouvaient coûter cher ces expansions. Ce qu’on lui confiait, elle le répétait au médecin-chef, scrupuleusement, et ça vous passait au dossier pour le Conseil de guerre. Il semblait bien prouvé qu’elle avait ainsi fait fusiller, à coups de confidences, un brigadier de Spahis qui n’avait pas vingt ans, plus un réserviste du Génie qui avait avalé des clous pour se donner mal à l’estomac et puis encore un autre hystérique, celui qui lui avait raconté comment il préparait ses crises de paralysie au front… Moi, pour me tâter, elle me proposa certain soir le livret d’un père de famille de six enfants, qu’était mort qu’elle disait, et que ça pouvait me servir, à cause des affectations de l’arrière. En somme, c’était une vicieuse. Au lit par exemple, c’était une superbe affaire et on y revenait et elle nous donnait bien de la joie. Pour une garce c’en était une vraie. Faut ça d’ailleurs pour faire bien jouir. Dans cette cuisine-là, celle du derrière, la coquinerie, après tout, c’est comme le poivre dans une bonne sauce, c’est indispensable et ça lie.
Les bâtiments du lycée s’ouvraient sur une très ample terrasse, dorée l’été, au milieu des arbres, et d’où se découvrait magnifiquement Paris, en sorte de glorieuse perspective. C’était là que le jeudi nos visiteurs nous attendaient et Lola parmi eux, venant m’apporter ponctuellement gâteaux, conseils et cigarettes.
Nos médecins nous les voyions chaque matin. Ils nous interrogeaient avec bienveillance, mais on ne savait jamais ce qu’ils pensaient au juste. Ils promenaient autour de nous, dans des mines toujours affables, notre condamnation à mort.
Beaucoup de malades parmi ceux qui étaient là en observation, parvenaient, plus émotifs que les autres, dans cette ambiance doucereuse, à un état de telle exaspération qu’ils se levaient la nuit au lieu de dormir, arpentaient le dortoir de long en large, protestaient tout haut contre leur propre angoisse, crispés entre l’espérance et le désespoir, comme sur un pan traître de montagne. Ils peinaient des jours et des jours ainsi et puis un soir ils se laissaient choir d’un coup tout en bas et allaient tout avouer de leur affaire au médecin‐chef. On ne les revoyait plus ceux-là, jamais. Moi non plus, je n’étais pas tranquille. Mais quand on est faible ce qui donne de la force, c’est de dépouiller les hommes qu’on redoute le plus, du moindre prestige qu’on a encore tendance à leur prêter. Il faut s’apprendre à les considérer tels qu’ils sont, pires qu’ils sont c’est-à-dire, à tous les points de vue. Ça dégage, ça vous affranchit et vous défend au‐delà de tout ce qu’on peut imaginer. Ça vous donne un autre vous-même. On est deux.
Leurs actions, dès lors, ne vous ont plus ce sale attrait mystique qui vous affaiblit et vous fait perdre du temps et leur comédie ne vous est alors nullement plus agréable et plus utile à votre progrès intime que celle du plus bas cochon.
À côté de moi, voisin de lit, couchait un caporal, engagé volontaire aussi. Professeur avant le mois d’août dans un lycée de Touraine, où il enseignait, m’apprit-il, l’histoire et la géographie. Au bout de quelques mois de guerre, il s’était révélé voleur ce professeur, comme pas un. On ne pouvait plus l’empêcher de dérober au convoi de son régiment des conserves, dans les four-gons de l’Intendance, aux réserves de la Compagnie, et partout ailleurs où il en trouvait.
Avec nous autres il avait donc échoué là, vague en instance de Conseil de guerre. Cependant, comme sa famille s’acharnait à prouver que les obus l’avaient stupéfié, démoralisé, l’instruction différait son jugement de mois en mois. Il ne me parlait pas beaucoup. Il passait des heures à se peigner la barbe, mais quand il me parlait, c’était presque toujours de la même chose, du moyen qu’il avait découvert pour ne plus faire d’enfants à sa femme. Était-il fou vraiment? Quand le moment du monde à l’envers est venu et que c’est être fou que de demander pourquoi on vous assassine, il devient évident qu’on passe pour fou à peu de frais. Encore faut-il que ça prenne, mais quand il s’agit d’éviter le grand écartelage il se fait dans certains cerveaux de magnifiques efforts d’imagination.
Tout ce qui est intéressant se passe dans l’ombre, décidément. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes.
Princhard, il s’appelait, ce professeur. Que pouvait-il bien avoir décidé, lui, pour sauver ses carotides, ses poumons et ses nerfs optiques? Voici la question essentielle, celle qu’il aurait fallu nous poser entre nous hommes pour demeurer strictement humains et pratiques. Mais nous étions loin de là, titubants dans un idéal d’absurdités, gardés par les poncifs belliqueux et insanes, rats enfumés déjà, nous tentions, en folie, de sortir du bateau de feu, mais n’avions aucun plan d’ensemble, aucune confiance les uns dans les autres. Ahuris par la guerre, nous étions devenus fous dans un autre genre: la peur. L’envers et l’endroit de la guerre.
Il me marquait quand même, à travers ce commun délire, une certaine sympathie, ce Princhard, tout en se méfiant de moi, bien sûr.
Où nous nous trouvions, à l’enseigne où tous nous étions logés, il ne pouvait exister ni amitié, ni confiance. Chacun laissait seulement entendre ce qu’il croyait être favorable à sa peau, puisque tout ou presque allait être répété par les mouchards à l’affût.
De temps en temps, l’un d’entre nous disparaissait, c’est que son affaire était constituée, qu’elle se terminerait au Conseil de guerre, à Biribi ou au front et pour les mieux servis à l’Asile de Clamart.
D’autres guerriers douteux arrivaient encore, toujours, de toutes les armes, des très jeunes et des presque vieux, avec la frousse ou bien crâneurs, leurs femmes et leurs parents leur rendaient visite, leurs petits aussi, yeux écarquillés, le jeudi.
Tout ce monde pleurait d’abondance, dans le parloir, sur le soir surtout. L’impuissance du monde dans la guerre venait pleurer là, quand les femmes et les petits s’en allaient, par le couloir blafard de gaz, visites finies, en traînant les pieds. Un grand troupeau de pleurnicheurs ils formaient, rien que ça, dégoûtants.
Pour Lola, venir me voir dans cette sorte de prison, c’était encore une aventure. Nous deux, nous ne pleurions pas. Nous n’avions nulle part, nous, où prendre des larmes.
« Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? me demande-t-elle un jeudi.
– Je le suis! avouai-je.
– Alors, ils vont vous soigner ici?
– On ne soigne pas la peur, Lola.
– Vous avez donc peur tant que ça?
– Et plus que ça encore, Lola, si peur, voyez-vous, que si je meurs de ma mort à moi, plus tard, je ne veux surtout pas qu’on me brûle! Je voudrais qu’on me laisse en terre, pourrir au cimetière, tranquillement, là, prêt à revivre peut-être… Sait-on jamais! Tandis que si on me brûlait en cendres, Lola, comprenez‐vous, ça serait fini, bien fini… Un squelette, malgré tout, ça ressemble encore un peu à un homme… C’est toujours plus prêt à revivre que des cendres… Des cendres c’est fini!.. Qu’en dites-vous?.. Alors, n’est-ce pas, la guerre…
– Oh! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand! Vous êtes répugnant comme un rat…
– Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans… Je ne la déplore pas moi… Je ne me résigne pas moi… Je ne pleurniche pas dessus moi… Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions et moi tout seul, c’est eux qui ont tort, Lola, et c’est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux: je ne veux plus mourir.
– Mais c’est impossible de refuser la guerre, Ferdinand! Il n’y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur Patrie est en danger…
– Alors vivent les fous et les lâches! Ou plutôt survivent les fous et les lâches! Vous souvenez‐vous d’un seul nom par exemple, Lola, d’un de ces soldats tués pendant la guerre de Cent Ans?.. Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms?.. Non, n’est-ce pas?.. Vous n’avez jamais cherché? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin… Voyez donc bien qu’ils sont morts pour rien, Lola! Pour absolument rien du tout, ces crétins! Je vous l’affirme! La preuve est faite! Il n’y a que la vie qui compte. Dans dix mille ans d’ici, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu’elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée… À peine si une douzaine d’érudits se chamailleront encore par-ci, par-là, à son occasion et à propos des dates des principales hécatombes dont elle fut illustrée… C’est tout ce que les hommes ont réussi jusqu’ici à trouver de mémorable au sujet les uns des autres à quelques siècles, à quelques années et même à quelques heures de distance… Je ne crois pas à l’avenir, Lola… »
Lorsqu’elle découvrit à quel point j’étais devenu fanfaron de mon honteux état, elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde… Méprisable elle me jugea, définitivement.
Elle résolut de me quitter sur-le-champ. C’en était trop. En la reconduisant jusqu’au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m’embrassa pas.
Décidément, il lui était impossible d’admettre qu’un condamné à mort n’ait pas en même temps reçu la vocation. Quand je lui demandai des nouvelles de nos crêpes, elle ne me répondit pas non plus.
En rentrant à la chambrée je trouvai Princhard devant la fenêtre essayant des lunettes contre la lumière du gaz au milieu d’un cercle de soldats. C’est une idée qui lui était venue, nous expliqua-t-il, au bord de la mer, en vacances, et puisque c’était l’été à présent, il entendait les porter pendant la journée, dans le parc. Il était immense ce parc et fort bien surveillé d’ailleurs par des escouades d’infirmiers alertes. Le lendemain donc Princhard insista pour que je l’accompagne jusqu’à la terrasse pour essayer les belles lunettes. L’après-midi rutilait splendide sur Princhard, défendu par ses verres opaques; je remarquai qu’il avait le nez presque transparent aux narines et qu’il respirait avec précipitation.
« Mon ami, me confia‐t‐il, le temps passe et ne travaille pas pour moi… Ma conscience est inaccessible aux remords, je suis libéré, Dieu merci! de ces timidités… Ce ne sont pas les crimes qui se comptent en ce monde… Il y a longtemps qu’on y a renoncé… Ce sont les gaffes… Et je crois en avoir commis une… Tout à fait irrémédiable…
– En volant les conserves?
– Oui, j’avais cru cela malin, imaginez! Pour me faire soustraire à la bataille et de cette façon, honteux, mais vivant encore, pour revenir en la paix comme on revient, exténué, à la surface de la mer après un long plongeon… J’ai bien failli réussir… Mais la guerre dure décidément trop longtemps… On ne conçoit plus à mesure qu’elle s’allonge d’individus suffisamment dégoûtants pour dégoûter la Patrie… Elle s’est mise à accepter tous les sacrifices, d’où qu’ils viennent, toutes les viandes la Patrie… Elle est devenue infiniment indulgente dans le choix de ses martyrs la Patrie! Actuellement il n’y a plus de soldats indignes de porter les armes et surtout de mourir sous les armes et par les armes… On va faire, dernière nouvelle, un héros avec moi!.. Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse, pour qu’on se mette à pardonner le vol d’une boîte de conserve! que dis-je? à l’oublier! Certes, nous avons l’habitude d’admirer tous les jours d’immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l’opulence et dont l’existence se démontre cependant dès qu’on l’examine d’un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé, mais ces gens-là jouissent de gloire, d’honneurs et de puissance, leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu’aussi loin qu’on se reporte dans l’histoire – et vous savez que je suis payé pour la connaître – tout nous démontre qu’un larcin véniel, et surtout d’aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur immanquablement l’opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d’abord parce que l’auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté. Le vol du pauvre devient une malicieuse reprise individuelle, me comprenez-vous?.. Où irions-nous? Aussi la répression des menus larcins s’exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les climats, avec une rigueur extrême, comme moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout comme une recommandation sévère à tous les malheureux d’avoir à se tenir à leur place et dans leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indéfiniment de misère et de faim… Jusqu’ici cependant, il restait aux petits voleurs un avantage dans la République, celui d’être privés de l’honneur de porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va changer, j’irai reprendre dès demain, moi voleur, ma place aux armées… Tels sont les ordres… En haut lieu, on a décidé de passer l’éponge sur ce qu’ils appellent “mon moment d’égarement et ceci, notez-le bien, en considération de ce qu’on intitule aussi “l’honneur de ma famille”. Quelle mansuétude! Je-vous le demande camarade, est-ce donc ma famille qui va s’en aller servir de passoire et de tri aux balles françaises et allemandes mélangées?.. Ce sera bien moi tout seul, n’est-ce pas? Et quand je serai mort, est-ce l’honneur de ma famille qui me fera ressusciter?.. Tenez, je la vois d’ici, ma famille, les choses de la guerre passées… Comme tout passe… Joyeusement alors gambadante ma famille sur les gazons de l’été revenu, je la vois d’ici par les beaux dimanches… Cependant qu’à trois pieds dessous, moi papa, ruisselant d’asticots et bien plus infect qu’un kilo d’étrons de 14 juillet pourrira fantastiquement de toute sa viande déçue… Engraisser les sillons du laboureur anonyme c’est le véritable avenir du véritable soldat! Ah! camarade! Ce monde n’est je vous l’assure qu’une immense entreprise à se foutre du monde! Vous êtes jeune. Que ces minutes sagaces vous comptent pour des années! Écoutez-moi bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre Société: “L’attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux…” Je vous le dis, petits bonshommes, couillons de la vie, battus, rançonnés, transpirants de toujours, je vous préviens, quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c’est qu’ils vont vous tourner en saucissons de bataille… C’est le signe… Il est infaillible. C’est par l’affection que ça commence. Louis XIV lui au moins, qu’on se souvienne, s’en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, du même. Il s’en barbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce temps-là, certes, les pauvres n’ont jamais bien vécu, mais on ne mettait pas à les étriper l’entêtement et l’acharnement qu’on trouve à nos tyrans d’aujourd’hui. Il n’y a de repos, vous dis-je, pour les petits, que dans le mépris des grands qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme… Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple… Lui qui ne connaissait que le catéchisme! Ils se sont mis, proclamèrent-ils, à l’éduquer… Ah! ils en avaient des vérités à lui révéler! et des belles! Et des pas fatiguées! Qui brillaient! Qu’on en restait tout ébloui! C’est ça! qu’il a commencé par dire, le bon peuple, c’est bien ça! C’est tout à fait ça! Mourons tous pour ça! Il ne demande jamais qu’à mourir le peuple! Il est ainsi. “Vive Diderot!” qu’ils ont gueulé et puis “Bravo Voltaire!” En voilà au moins des philosophes! Et vive aussi Carnot qui organise si bien les victoires! Et vive tout le monde! Voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l’ignorance et le fétichisme le bon peuple! Ils lui montrent eux les routes de la Liberté! Ils l’émancipent! Ça n’a pas traîné! Que tout le monde d’abord sache lire les journaux! C’est le salut! Nom de Dieu! Et en vitesse! Plus d’illettrés! Il en faut plus! Rien que des soldats citoyens! Qui votent! Qui lisent! Et qui se battent! Et qui marchent! Et qui envoient des baisers! À ce régime‐là, bientôt il fut fin mûr le bon peuple. Alors n’est-ce pas l’enthousiasme d’être libéré il faut bien que ça serve à quelque chose? Danton n’était pas éloquent pour les prunes. Par quelques coups de gueule si bien sentis, qu’on les entend encore, il vous l’a mobilisé en un tour de main le bon peuple! Et ce fut le premier départ des premiers bataillons d’émancipés frénétiques! Des premiers couillons voteurs et drapeautiques qu’emmena le Dumouriez se faire trouer dans les Flandres! Pour lui-même Dumouriez, venu trop tard à ce petit jeu idéaliste, entièrement inédit, préférant somme toute le pognon, il déserta. Ce fut notre dernier mercenaire… Le soldat gratuit ça c’était du nouveau… Tellement nouveau que Goethe, tout Goethe qu’il était, arrivant à Valmy en reçut plein la vue. Devant ces cohortes loqueteuses et passionnées qui venaient se faire étripailler spontanément par le roi de Prusse pour la défense de l’inédite fiction patriotique, Goethe eut le sentiment qu’il avait encore bien des choses à apprendre. “De ce jour, clama‐t‐il, magnifiquement, selon les habitudes de son génie, commence une époque nouvelle!” Tu parles! Par la suite, comme le système était excellent, on se mit à fabriquer des héros en série, et qui coûtèrent de moins en moins cher, à cause du perfectionnement du système. Tout le monde s’en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléon, Barrès aussi bien que la cavalière Eisa. La religion drapeautique remplaça promptement la céleste, vieux nuage déjà dégonflé par la Réforme et condensé depuis longtemps en tirelires épiscopales. Autrefois, la mode fanatique, c’était “Vive Jésus! Au bûcher les hérétiques!”, mais rares et volontaires après tout les hérétiques… Tandis que désormais, où nous voici, c’est par hordes immenses que les cris: “Au poteau les salsifis sans fibres! Les citrons sans jus! Les innocents lecteurs! Par millions face à droite!” provoquent les vocations. Les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les Pacifiques puants, qu’on s’en empare et qu’on les écartèle! Et les trucide aussi de treize façons et bien fadées! Qu’on leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d’abord, les yeux des orbites, et les années de leur sale vie baveuse! Qu’on les fasse par légions et légions encore, crever, tourner en mirlitons, saigner, fumer dans les acides, et tout ça pour que la Patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce! Et s’il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n’ont qu’à aller s’enterrer tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière, sous l’épitaphe infamante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d’ombre du monument adjudicataire et communal élevé pour les morts convenables dans l’allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l’écho du Ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le Préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner… »
Mais du fond du jardin, on l’appela Princhard. Le médecin‐chef le faisait demander d’urgence par son infirmier de service.
« J’y vais », qu’il a répondu Princhard, et n’eut que le temps juste de me passer le brouillon du discours qu’il venait ainsi d’essayer sur moi. Un truc de cabotin.
Lui, Princhard, je ne le revis jamais. Il avait le vice des intellectuels, il était futile. Il savait trop de choses ce garçon-là et ces choses l’embrouillaient. Il avait besoin de tas de trucs pour s’exciter, se décider.
C’est loin déjà de nous le soir où il est parti, quand j’y pense. Je m’en souviens bien quand même. Ces maisons du faubourg qui limitaient notre parc se détachaient encore une fois, bien nettes, comme font toutes les choses avant que le soir les prenne. Les arbres grandissaient dans l’ombre et montaient au ciel rejoindre la nuit.
Je n’ai jamais rien fait pour avoir de ses nouvelles, pour savoir s’il était vraiment « disparu » ce Princhard, comme on l’a répété. Mais c’est mieux qu’il soit disparu.
Déjà notre paix hargneuse faisait dans la guerre même ses semences.
On pouvait deviner ce qu’elle serait, cette hystérique rien qu’à la voir s’agiter déjà dans la taverne de l’Olympia. En bas dans la longue cave-dancing louchante aux cent glaces, elle trépignait dans la poussière et le grand désespoir en musique négro-judéo-saxonne. Britanniques et Noirs mêlés. Levantins et Russes, on en trouvait partout, fumants, braillants, mélancoliques et militaires, tout du long des sofas cramoisis. Ces uniformes dont on commence à ne plus se souvenir qu’avec bien de la peine furent les semences de l’aujourd’hui, cette chose qui pousse encore et qui ne sera tout à fait devenue fumier qu’un peu plus tard, à la longue.
Bien entraînés au désir par quelques heures à l’Olympia chaque semaine, nous allions en groupe faire une visite ensuite à notre lingère-gantière-libraire Mme Herote, dans l’Impasse des Beresinas, derrière les Folies-Bergère, à présent disparue, où les petits chiens venaient avec leurs petites filles, en laisse, faire leurs besoins.
Nous y venions nous, chercher notre bonheur à tâtons, que le monde entier menaçait avec rage. On en était honteux de cette envie-là, mais il fallait bien s’y mettre tout de même! C’est plus difficile de renoncer à l’amour qu’à la vie. On passe son temps à tuer ou à adorer en ce monde et cela tout ensemble. « Je te hais! Je t’adore! » On se défend, on s’entretient, on repasse sa vie au bipède du siècle suivant, avec frénésie, à tout prix, comme si c’était formidablement agréable de se continuer, comme si ça allait nous rendre, au bout du compte, éternels. Envie de s’embrasser malgré tout, comme on se gratte.
J’allais mieux mentalement, mais ma situation militaire demeurait assez indécise. On me permettait de sortir en ville de temps en temps. Notre lingère s’appelait donc Mme Herote. Son front était bas et si borné qu’on en demeurait, devant elle, mal à l’aise au début, mais ses lèvres si bien souriantes par contre, et si charnues qu’on ne savait plus comment s’y prendre ensuite pour lui échapper. À l’abri d’une volubilité formidable, d’un tempérament inoubliable, elle abritait une série d’intentions simples, rapaces, pieusement commerciales.
Fortune elle se mit à faire en quelques mois, grâce aux alliés et à son ventre surtout. On l’avait débarrassée de ses ovaires il faut le dire, opérée de salpingite l’année précédente. Cette castration libératrice fit sa fortune. Il y a de ces blennorragies féminines qui se démontrent providentielles. Une femme qui passe son temps à redouter les grossesses n’est qu’une espèce d’impotente et n’ira jamais bien loin dans la réussite.
Les vieux et les jeunes gens aussi croient, je le croyais, qu’on trouvait moyen de faire facilement l’amour et pour pas cher dans l’arrière-boutique de certaines librairies-lingeries. Cela était encore exact, il y a quelque vingt ans, mais depuis, bien des choses ne se font plus, celles-là surtout parmi les plus agréables. Le puritanisme anglo-saxon nous dessèche chaque mois davantage, il a déjà réduit à peu près à rien la gaudriole impromptue des arrière-boutiques. Tout tourne au mariage et à la correction.
Mme Herote sut mettre à bon profit les dernières licences qu’on avait encore de baiser debout et pas cher. Un commissaire-priseur désœuvré passa devant son magasin certain dimanche, il y entra, il y est toujours. Gaga, il l’était un peu, il le demeura, sans plus. Leur bonheur ne fit aucun bruit. À l’ombre des journaux délirants d’appels aux sacrifices ultimes et patriotiques, la vie, strictement mesurée, farcie de prévoyance, continuait et bien plus astucieuse même que jamais. Tels sont l’envers et l’endroit, comme la lumière et l’ombre, de la même médaille.
Le commissaire de Mme Herote plaçait en Hollande des fonds pour ses amis, les mieux renseignés, et pour Mme Herote à son tour, dès qu’ils furent devenus confidents. Les cravates, les soutiens-gorge, les presque chemises comme elle en vendait, retenaient clients et clientes et surtout les incitaient à revenir souvent.
Grand nombre de rencontres étrangères et nationales eurent lieu à l’ombre rosée de ces brise-bise parmi les phrases incessantes de la patronne dont toute la personne substantielle, bavarde et parfumée jusqu’à l’évanouissement aurait pu rendre grivois le plus ranci des hépatiques. Dans ces mélanges, loin de perdre l’esprit, elle retrouvait son compte Mme Herote, en argent d’abord, parce qu’elle prélevait sa dîme sur les ventes en sentiments, ensuite parce qu’il se faisait beaucoup d’amour autour d’elle. Unissant les couples et les désunissant avec une joie au moins égale, à coups de ragots, d’insinuations, de trahisons.
Elle imaginait du bonheur et du drame sans désemparer. Elle entretenait la vie des passions. Son commerce n’en marchait que mieux.
Proust, mi-revenant lui-même, s’est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l’infinie, la diluante futilité des rites et démarches qui s’entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désirs, partouzards indécis attendant leur Watteau toujours, chercheurs sans entrain d’improbables Cythères. Mais Mme Herote, populaire et substantielle d’origine, tenait solidement à la terre par de rudes appétits, bêtes et précis.
Si les gens sont si méchants, c’est peut-être seulement parce qu’ils souffrent, mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir de celui où ils deviennent un peu meilleurs. La belle réussite matérielle et passionnelle de Mme Herote n’avait pas encore eu le temps d’adoucir ses dispositions conquérantes.
Elle n’était pas plus haineuse que la plupart des petites commerçantes d’alentour, mais elle se donnait beaucoup de peine à vous démontrer le contraire, alors on se souvient de son cas. Sa boutique n’était pas qu’un lieu de rendez-vous, c’était encore une sorte d’entrée furtive dans un monde de richesse et de luxe où je n’avais jamais malgré tout mon désir, jusqu’alors pénétré et d’où je fus d’ailleurs éliminé promptement et péniblement à la suite d’une furtive incursion, la première et la seule.
Les gens riches à Paris demeurent ensemble, leurs quartiers, en bloc, forment une tranche de gâteau urbain dont la pointe vient toucher au Louvre, cependant que le rebord arrondi s’arrête aux arbres entre le Pont d’Auteuil et la Porte des Ternes. Voilà. C’est le bon morceau de la ville. Tout le reste n’est que peine et fumier.
Quand on passe du côté de chez les riches on ne remarque pas d’abord de grandes différences avec les autres quartiers, si ce n’est que les rues y sont un peu plus propres et c’est tout. Pour aller faire une excursion dans l’intérieur même de ces gens, de ces choses, il faut se fier au hasard ou à l’intimité.
Par la boutique de Mme Herote on y pouvait pénétrer un peu avant dans cette réserve à cause des Argentins qui descendaient des quartiers privilégiés pour se fournir chez elle en caleçons et chemises et taquiner aussi son joli choix d’amies ambitieuses, théâtreuses et musiciennes, bien faites, que Mme Herote attirait à dessein.
À l’une d’elles, moi qui n’avais rien à offrir que ma jeunesse, comme on dit, je me mis cependant à tenir beaucoup trop. La petite Musyne on l’appelait dans ce milieu.
Au passage des Beresinas, tout le monde se connaissait de boutique en boutique, comme dans une véritable petite province, depuis des années coincée entre deux rues de Paris, c’est-à-dire qu’on s’y épiait et s’y calomniait humainement jusqu’au délire.
Pour ce qui est de la matérielle, avant la guerre, on y discutait entre commerçants une vie picoreuse et désespérément économe. C’était entre autres épreuves miséreuses le chagrin chronique de ces boutiquiers, d’être forcés dans leur pénombre de recourir au gaz dès quatre heures du soir venues, à cause des étalages. Mais il se ménageait ainsi, en retrait, par contre, une ambiance propice aux propositions délicates.
Beaucoup de boutiques étaient malgré tout en train de péricliter à cause de la guerre, tandis que celle de Mme Herote, à force de jeunes Argentins, d’officiers à pécule et des conseils de l’ami commissaire, prenait un essor que tout le monde, aux environs, commentait, on peut l’imaginer, en termes abominables.
Notons par exemple qu’à cette même époque, le célèbre pâtissier du numéro 112 perdit soudain ses belles clientes par l’effet de la mobilisation. Les habituelles goûteuses à longs gants forcées tant on avait réquisitionné de chevaux d’aller à pied ne revinrent plus. Elles ne devaient plus jamais revenir. Quant à Sambanet, le relieur de musique, il se défendit mal lui, soudain, contre l’envie qui l’avait toujours possédé de sodomiser quelque soldat. Une telle audace d’un soir, mal venue, lui fit un tort irréparable auprès de certains patriotes qui l’accusèrent d’emblée d’espionnage. Il dut fermer ses rayons.
Par contre Mlle Hermance, au numéro 26, dont la spécialité était jusqu’à ce jour l’article de caoutchouc avouable ou non, se serait très bien débrouillée, grâce aux circonstances, si elle n’avait éprouvé précisément toutes les difficultés du monde à s’approvisionner en « préservatifs » qu’elle recevait d’Allemagne.
Seule Mme Herote, en somme, au seuil de la nouvelle époque de la lingerie fine et démocratique entra facilement dans la prospérité.
On s’écrivait nombre de lettres anonymes entre boutiques, et des salées. Mme Herote préférait, quant à elle, et pour sa distraction, en adresser à de hauts personnages; en ceci même elle manifestait de la forte ambition qui constituait le fond même de son tempérament. Au Président du Conseil, par exemple elle en envoyait, rien que pour l’assurer qu’il était cocu, et au Maréchal Pétain, en anglais, à l’aide du dictionnaire, pour le faire enrager. La lettre anonyme? Douche sur les plumes! Mme Herote en recevait chaque jour un petit paquet pour son compte de ces lettres non signées et qui ne sentaient pas bon, je vous l’assure. Elle en demeurait pensive, éberluée pendant dix minutes environ, mais elle se reconstituait tout aussitôt son équilibre, n’importe comment, avec n’importe quoi, mais toujours, et solidement encore car il n’y avait dans sa vie intérieure aucune place pour le doute et encore moins pour la vérité.
Parmi ses clientes et protégées, nombre de petites artistes lui arrivaient avec plus de dettes que de robes. Toutes, Mme Herote les conseillait et elles s’en trouvaient bien, Musyne entre autres qui me semblait à moi la plus mignonne de toutes. Un véritable petit ange musicien, une amour de violoniste, une amour bien dessalée par exemple, elle me le prouva. Implacable dans son désir de réussir sur la terre, et pas au ciel, elle se débrouillait au moment où je la connus, dans un petit acte, tout ce qu’il y avait de mignon, très parisien et bien oublié, aux Variétés.
Elle apparaissait avec son violon dans une manière de prologue impromptu, versifié, mélodieux. Un genre adorable et compliqué.
Avec ce sentiment que je lui vouai mon temps devint frénétique et se passait en bondissements de l’hôpital à la sortie de son théâtre. Je n’étais d’ailleurs presque jamais seul à l’attendre. Des militaires terrestres la ravissaient à tour de bras, des aviateurs aussi et bien plus facilement encore, mais le pompon séducteur revenait sans conteste aux Argentins. Leur commerce de viandes froides à ceux‐là, prenait grâce à la pullulation des contingents nouveaux, les proportions d’une force de la nature. La petite Musyne en a bien profité de ces jours mercantiles. Elle a bien fait, les Argentins n’existent plus.
Je ne comprenais pas. J’étais cocu avec tout et tout le monde, avec les femmes, l’argent et les idées. Cocu et pas content. À l’heure qu’il est, il m’arrive encore de la rencontrer Musyne, par hasard, tous les deux ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu’on a connus très bien. C’est le délai qu’il nous faut, deux années, pour nous rendre compte, d’un seul coup d’œil, intrompable alors, comme l’instinct, des laideurs dont un visage, même en son temps délicieux, s’est chargé.
On demeure comme hésitant un instant devant, et puis on finit par l’accepter tel qu’il est devenu le visage avec cette disharmonie croissante, ignoble, de toute la figure. Il le faut bien dire oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par deux ans. Accepter le temps, ce tableau de nous. On peut dire alors qu’on s’est reconnus tout à fait (comme un billet étranger qu’on hésite à prendre à première vue) qu’on ne s’était pas trompés de chemin, qu’on avait bien suivi la vraie route, sans s’être concertés, l’immanquable route pendant deux années de plus, la route de la pourriture. Et voilà tout.
Musyne, quand elle me rencontrait ainsi, fortuitement, tellement je l’épouvantais avec ma grosse tête, semblait vouloir me fuir absolument, m’éviter, se détourner, n’importe quoi… Je lui sentais mauvais, c’était évident, de tout un passé, mais moi qui sais son âge, depuis trop d’années, elle a beau faire, elle ne peut absolument plus m’échapper. Elle reste là l’air gêné devant mon existence, comme devant un monstre. Elle, si délicate, se croit tenue de me poser des questions balourdes, imbéciles, comme en poserait une bonne prise en faute. Les femmes ont des natures de domestiques. Mais elle imagine peut-être seulement cette répulsion, plus qu’elle ne l’éprouve; c’est l’espèce de consolation qui me demeure. Je lui suggère peut-être seulement que je suis immonde. Je suis peut-être un artiste dans ce genre-là. Après tout, pourquoi n’y aurait-il pas autant d’art possible dans la laideur que dans la beauté? C’est un genre à cultiver, voilà tout.
J’ai cru longtemps qu’elle était sotte la petite Musyne, mais ce n’était qu’une opinion de vaniteux éconduit. Vous savez, avant la guerre, on était tous encore bien plus ignorants et plus fats qu’aujourd’hui. On ne savait presque rien des choses du monde en général, enfin des inconscients… Les petits types dans mon genre prenaient encore bien plus facilement qu’aujourd’hui des vessies pour des lanternes. D’être amoureux de Musyne si mignonne je pensais que ça allait me douer de toutes les puissances, et d’abord et surtout du courage qui me manquait, tout ça parce qu’elle était si jolie et si joliment musicienne ma petite amie! L’amour c’est comme l’alcool, plus on est impuissant et soûl et plus on se croit fort et malin, et sûr de ses droits.
Mme Herote, cousine de nombreux héros décédés, ne sortait plus de son impasse qu’en grand deuil; encore, n’allait-elle en ville que rarement, son commissaire ami se montrant assez jaloux. Nous nous réunissions dans la salle à manger de l’arrière-boutique, qui, la prospérité venue, prit bel et bien les allures d’un petit salon. On y venait converser, s’y distraire, gentiment, convenablement sous le gaz. Petite Musyne, au piano, nous ravissait de classiques, rien que des classiques, à cause des convenances de ces temps douloureux. Nous demeurions là, des après-midi, coude à coude, le commissaire au milieu, à bercer ensemble nos secrets, nos craintes, et nos espoirs.
La servante de Mme Herote, récemment engagée, tenait beaucoup à savoir quand les uns allaient se décider enfin à se marier avec les autres. Dans sa campagne on ne concevait pas l’union libre. Tous ces Argentins, ces officiers, ces clients fureteurs lui causaient une inquiétude presque animale.
Musyne se trouvait de plus en plus souvent accaparée par les clients sud‐américains. Je finis de cette façon par connaître à fond toutes les cuisines et domestiques de ces messieurs, à force d’aller attendre mon aimée à l’office. Les valets de chambre de ces messieurs me prenaient d’ailleurs pour le maquereau. Et puis, tout le monde finit par me prendre pour un maquereau, y compris Musyne elle-même, en même temps je crois que tous les habitués de la boutique de Mme Herote. Je n’y pouvais rien. D’ailleurs, il faut bien que cela arrive tôt ou tard, qu’on vous classe.
J’obtins de l’autorité militaire une autre convalescence de deux mois de durée et on parla même de me réformer. Avec Musyne nous décidâmes d’aller loger ensemble à Billancourt. C’était pour me semer en réalité ce subterfuge parce qu’elle profita que nous demeurions loin, pour rentrer de plus en plus rarement à la maison. Toujours elle trouvait de nouveaux prétextes pour rester dans Paris.
Les nuits de Billancourt étaient douces, animées parfois par ces puériles alarmes d’avions et de zeppelins, grâce auxquelles les citadins trouvaient moyen d’éprouver des frissons justificatifs. En attendant mon amante, j’allais me promener, nuit tombée, jusqu’au pont de Grenelle, là où l’ombre monte du fleuve jusqu’au tablier du métro, avec ses lampadaires en chapelets, tendu en plein noir, avec sa ferraille énorme aussi qui va foncer en tonnerre en plein flanc des gros immeubles du quai de Passy.
Il existe certains coins comme ça dans les villes, si stupidement laids qu’on y est presque toujours seul.
Musyne finit par ne plus rentrer à notre espèce de foyer qu’une fois par semaine. Elle accompagnait de plus en plus fréquemment des chanteuses chez les Argentins. Elle aurait pu jouer et gagner sa vie dans les cinémas, où ç’aurait été bien plus facile pour moi d’aller la chercher, mais les Argentins étaient gais et bien payants, tandis que les cinémas étaient tristes et payaient peu. C’est toute la vie ces préférences.
Pour comble de mon infortune survint le Théâtre aux Armées. Elle se créa instantanément, Musyne, cent relations militaires au Ministère et de plus en plus fréquemment elle partit alors distraire au front nos petits soldats et cela durant des semaines entières. Elle y détaillait, aux armées, la sonate et l’adagio devant les parterres d’État-major, bien placés pour lui voir les jambes. Les soldats parqués en gradins à l’arrière des chefs ne jouissaient eux que des échos mélodieux. Elle passait forcément ensuite des nuits très compliquées dans les hôtels de la zone des Armées. Un jour elle m’en revint toute guillerette des Armées et munie d’un brevet d’héroïsme, signé par l’un de nos grands généraux, s’il vous plaît. Ce diplôme fut à l’origine de sa définitive réussite.
Dans la colonie argentine, elle sut se rendre du coup extrêmement populaire. On la fêta. On en raffola de ma Musyne, violoniste de guerre si mignonne! Si fraîche et bouclée et puis héroïne par-dessus le marché. Ces Argentins avaient la reconnaissance du ventre, ils vouaient à nos grands chefs une de ces admirations qui n’était pas dans une musette, et quand elle leur revint ma Musyne, avec son document authentique, sa jolie frimousse, ses petits doigts agiles et glorieux, ils se mirent à l’aimer à qui mieux mieux, aux enchères pour ainsi dire. La poésie héroïque possède sans résistance ceux qui ne vont pas à la guerre et mieux encore ceux que la guerre est en train d’enrichir énormément. C’est régulier.
Ah! l’héroïsme mutin, c’est à défaillir je vous le dis! Les armateurs de Rio offraient leurs noms et leurs actions à la mignonne qui féminisait si joliment à leur usage la vaillance française et guerrière. Musyne avait su se créer, il faut l’avouer, un petit répertoire très coquet d’incidents de guerre et qui, tel un chapeau mutin, lui allait à ravir. Elle m’étonnait souvent moi-même par son tact et je dus m’avouer, à l’entendre, que je n’étais en fait de bobards qu’un grossier simulateur à ses côtés. Elle possédait le don de mettre ses trouvailles dans un certain lointain dramatique où tout devenait et demeurait précieux et pénétrant. Nous demeurions nous combattants, en fait de fariboles, je m’en rendais soudain compte, grossièrement temporaires et précis. Elle travaillait dans l’éternel ma belle. Il faut croire Claude Lorrain, les premiers plans d’un tableau sont toujours répugnants et l’art exige qu’on situe l’intérêt de l’œuvre dans les lointains, dans l’insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes. La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie, notre indispensable et suprême espérance. Nous attendons auprès d’elle, qu’elle nous conserve notre menteuse raison d’être, mais tout en attendant elle peut, dans l’exercice de cette magique fonction gagner très largement sa vie. Musyne n’y manquait pas, d’instinct.
On trouvait ses Argentins du côté des Ternes, et puis surtout aux limites du Bois, en petits hôtels particuliers, bien clos, brillants, où par ces temps d’hiver il régnait une chaleur si agréable qu’en y pénétrant de la rue, le cours de vos pensées devenait optimiste soudain, malgré vous.
Dans mon désespoir tremblotant, j’avais entrepris, pour comble de gaffe, d’aller le plus souvent possible, je l’ai dit, attendre ma compagne à l’office. Je patientais, parfois jusqu’au matin, j’avais sommeil, mais la jalousie me tenait quand même bien réveillé, le vin blanc aussi, que les domestiques me servaient largement. Les maîtres argentins, eux, je les voyais fort rarement, j’entendais leurs chansons et leur espagnol fracasseur et le piano qui n’arrêtait pas, mais joué le plus souvent par d’autres mains que par celles de Musyne. Que faisait-elle donc pendant ce temps-là, cette garce, avec ses mains?
Quand nous nous retrouvions au matin devant la porte elle faisait la grimace en me revoyant. J’étais encore naturel comme un animal en ce temps‐là, je ne voulais pas la lâcher ma jolie et c’est tout, comme un os.
On perd la plus grande partie de sa jeunesse à coups de maladresses. Il était évident qu’elle allait m’abandonner mon aimée tout à fait et bientôt. Je n’avais pas encore appris qu’il existe deux humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m’a fallu, comme à tant d’autres, vingt années et la guerre, pour apprendre à me tenir dans ma catégorie, à demander le prix des choses et des êtres avant d’y toucher, et surtout avant d’y tenir.
Me réchauffant donc à l’office avec mes compagnons domestiques, je ne comprenais pas qu’au-dessus de ma tête dansaient les dieux argentins, ils auraient pu être allemands, français, chinois, cela n’avait guère d’importance, mais des Dieux, des riches, voilà ce qu’il fallait comprendre. Eux en haut avec Musyne, moi en dessous, avec rien. Musyne songeait sérieusement à son avenir; alors elle préférait le faire avec un Dieu. Moi aussi bien sûr j’y songeais à mon avenir, mais dans une sorte de délire, parce que j’avais tout le temps, en sourdine, la crainte d’être tué dans la guerre et la peur aussi de crever de faim dans la paix. J’étais en sursis de mort et amoureux. Ce n’était pas qu’un cauchemar. Pas bien loin de nous, à moins de cent kilomètres, des millions d’hommes, braves, bien armés, bien instruits, m’attendaient pour me faire mon affaire et des Français aussi qui m’attendaient pour en finir avec ma peau, si je ne voulais pas la faire mettre en lambeaux saignants par ceux d’en face.
Il existe pour le pauvre en ce monde deux grandes manières de crever, soit par l’indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. S’ils se mettent à penser à vous, c’est à votre torture qu’ils songent aussitôt les autres, et rien qu’à ça. On ne les intéresse que saignants, les salauds! Princhard à cet égard avait eu bien raison. Dans l’imminence de l’abattoir, on ne spécule plus beaucoup sur les choses de son avenir, on ne pense guère qu’à aimer pendant les jours qui vous restent puisque c’est le seul moyen d’oublier son corps un peu, qu’on va vous écorcher bientôt du haut en bas.
Comme elle me fuyait Musyne, je me prenais pour un idéaliste, c’est ainsi qu’on appelle ses propres petits instincts habillés en grands mots. Ma permission touchait à son terme. Les journaux battaient le rappel de tous les combattants possibles, et bien entendu avant tout, de ceux qui n’avaient pas de relations. Il était officiel qu’on ne devait plus penser qu’à gagner la guerre.
Musyne désirait fort aussi, comme Lola, que je retourne au front dare-dare et que j’y reste et comme j’avais l’air de tarder à m’y rendre, elle se décida à brusquer les choses, ce qui pourtant n’était pas dans sa manière.
Tel soir, où par exception nous rentrions ensemble, à Billancourt, voici que passent les pompiers trompetteurs et tous les gens de notre maison se précipitent à la cave en l’honneur de je ne sais quel zeppelin.
Ces paniques menues pendant lesquelles tout un quartier en pyjama, derrière la bougie, disparaissait en gloussant dans les profondeurs pour échapper à un péril presque entièrement imaginaire mesuraient l’angoissante futilité de ces êtres tantôt poules effrayées, tantôt moutons fats et consentants. De semblables et monstrueuses inconsistances sont bien faites pour dégoûter à tout jamais le plus patient, le plus tenace des sociophiles.
Dès le premier coup de clairon d’alerte Musyne oubliait qu’on venait de lui découvrir bien de l’héroïsme au Théâtre des Armées. Elle insistait pour que je me précipite avec elle au fond des souterrains, dans le métro, dans les égouts, n’importe où, mais à l’abri et dans les ultimes profondeurs et surtout tout de suite! À les voir tous dévaler ainsi, gros et petits, les locataires, frivoles ou majestueux, quatre à quatre, vers le trou sauveur, cela finit même à moi, par me pourvoir d’indifférence. Lâche ou courageux, cela ne veut pas dire grand-chose. Lapin ici, héros là-bas, c’est le même homme, il ne pense pas plus ici que là-bas. Tout ce qui n’est pas gagner de l’argent le dépasse décidément infiniment. Tout ce qui est vie ou mort lui échappe. Même sa propre mort, il la spécule mal et de travers. Il ne comprend que l’argent et le théâtre.
Musyne pleurnichait devant ma résistance. D’autres locataires nous pressaient de les accompagner, je finis par me laisser convaincre. Il fut émis quant au choix de la cave une série de propositions différentes. La cave du boucher finit par emporter la majorité des adhésions, on prétendait qu’elle était située plus profondément que n’importe quelle autre de l’immeuble. Dès le seuil il vous parvenait des bouffées d’une odeur âcre et de moi bien connue, qui me fut à l’instant absolument insupportable.
« Tu vas descendre là-dedans Musyne, avec la viande pendante aux crochets? lui demandai-je.
– Pourquoi pas? me répondit-elle, bien étonnée.
– Eh bien moi, dis-je, j’ai des souvenirs, et je préfère remonter là-haut…
– Tu t’en vas alors?
– Tu viendras me retrouver, dès que ce sera fini!
– Mais ça peut durer longtemps…
– J’aime mieux t’attendre là-haut, que je dis. Je n’aime pas la viande, et ce sera bientôt terminé. »
Pendant l’alerte, protégés dans leurs réduits, les locataires échangeaient des politesses guillerettes. Certaines dames en peignoir, dernières venues, se pressaient avec élégance et mesure vers cette voûte odorante dont le boucher et la bouchère leur faisaient les honneurs, tout en s’excusant, à cause du froid artificiel indispensable à la bonne conservation de la marchandise.
Musyne disparut avec les autres. Je l’ai attendue, chez nous, en haut, une nuit, tout un jour, un an… Elle n’est jamais revenue me trouver.
Je devins pour ma part à partir de cette époque de plus en plus difficile à contenter et je n’avais plus que deux idées en tête: sauver ma peau et partir pour l’Amérique. Mais échapper à la guerre constituait déjà une œuvre initiale qui me tint tout essoufflé pendant des mois et des mois.
« Des canons! des hommes! des munitions! » qu’ils exigeaient sans jamais en sembler las, les patriotes. Il paraît qu’on ne pouvait plus dormir tant que la pauvre Belgique et l’innocente petite Alsace n’auraient pas été arrachées au joug germanique. C’était une obsession qui empêchait, nous affirmait‐on, les meilleurs d’entre nous de respirer, de manger, de copuler. Ça n’avait pas l’air tout de même de les empêcher de faire des affaires les survivants. Le moral était bon à l’arrière, on pouvait le dire.
Il fallut réintégrer en vitesse nos régiments. Mais moi dès la première visite, on me trouva trop au-dessous de la moyenne encore, et juste bon pour être dirigé sur un autre hôpital, pour osseux et nerveux celui-là. Un matin nous sortîmes à six du Dépôt, trois artilleurs et trois dragons, blessés et malades à la recherche de cet endroit où se réparait la vaillance perdue, les réflexes abolis et les bras cassés. Nous passâmes d’abord, comme tous les blessés de l’époque, pour le contrôle, au Val‐de‐Grâce, citadelle ventrue, si noble et toute barbue d’arbres et qui sentait bien fort l’omnibus par ses couloirs, odeur aujourd’hui et sans doute à jamais disparue, mixture de pieds, de paille et de lampes à huile. Nous ne fîmes pas long feu au Val, à peine entrevus nous étions engueulés et comme il faut, par deux officiers gestionnaires, pelliculaires et surmenés, menacés par ceux-ci du Conseil et projetés à nouveau par d’autres Administrateurs dans la rue. Ils n’avaient pas de place pour nous, qu’ils disaient, en nous indiquant une destination vague: un bastion, quelque part, dans les zones autour de la ville.
De bistrots en bastions, de mominettes en cafés crème, nous partîmes donc à six au hasard des mauvaises directions, à la recherche de ce nouvel abri qui paraissait spécialisé dans la guérison des incapables héros dans notre genre.
Un seul d’entre nous six possédait un rudiment de bien, qui tenait tout entier, il faut le dire, dans une petite boîte en zinc de biscuits Pernot, marque célèbre alors et dont je n’entends plus parler. Là-dedans, il cachait, notre camarade, des cigarettes, et une brosse à dents, même qu’on en rigolait tous, de ce soin peu commun alors, qu’il prenait de ses dents, et que nous on le traitait, à cause de ce raffinement insolite, d’« homosexuel ».
Enfin, nous abordâmes, après bien des hésitations, vers le milieu de la nuit, aux remblais bouffis de ténèbres de ce bastion de Bicêtre, le « 43 » qu’il s’intitulait. C’était le bon.
On venait de le mettre à neuf pour recevoir des éclopés et des vieillards. Le jardin n’était même pas fini.
Quand nous arrivâmes, il n’y avait encore en fait d’habitants que la concierge, dans la partie militaire. Il pleuvait dru. Elle eut peur de nous la concierge en nous entendant, mais nous la fîmes rire en lui mettant la main tout de suite au bon endroit. « Je croyais que c’était des Allemands! fit‐elle. – Ils sont loin! lui répondit-on. – Où c’est que vous êtes malades? s’inquiétait-el-le. – Partout; mais pas au zizi! » fit un artilleur en réponse. Alors ça, on pouvait dire que c’était du vrai esprit et qu’elle appréciait en plus, la concierge. Dans ce même bastion séjournèrent par la suite avec nous des vieillards de l’Assistance publique. On avait construit pour eux, d’urgence, de nouveaux bâtiments garnis de kilomètres de vitrages, on les gardait là‐dedans jusqu’à la fin des hostilités, comme des insectes. Sur les buttes d’alentour, une éruption de lotissements étriqués se disputaient des tas de boue fuyante mal contenue entre des séries de cabanons précaires. À l’abri de ceux-ci poussent de temps à autre une laitue et trois radis, dont on ne sait jamais pourquoi, des limaces dégoûtées consentent à faire hommage au propriétaire.
Notre hôpital était propre, comme il faut se dépêcher de voir ces choses-là, quelques semaines, tout à leur début, car pour l’entretien des choses chez nous, on a aucun goût, on est même à cet égard de francs dégueulasses. On s’est couchés, je dis donc, au petit bonheur des lits métalliques et à la lumière lunaire, c’était si neuf ces locaux que l’électricité n’y venait pas encore.
Au réveil, notre nouveau médecin-chef est venu se faire connaître, tout content de nous voir, qu’il semblait, toute cordialité dehors. Il avait des raisons de son côté pour être heureux, il venait d’être nommé à quatre galons. Cet homme possédait en plus les plus beaux yeux du monde, veloutés et surnaturels, il s’en servait beaucoup pour l’émoi de quatre charmantes infirmières bénévoles qui l’entouraient de prévenances et de mimiques et qui n’en perdaient pas une miette de leur médecin-chef. Dès le premier contact, il se saisit de notre moral, comme il nous en prévint. Sans façon, empoignant familièrement l’épaule de l’un de nous, le secouant paternellement, la voix réconfortante, il nous traça les règles et le plus court chemin pour aller gaillardement et au plus tôt encore nous refaire casser la gueule.
D’où qu’ils provinssent décidément, ils ne pensaient qu’à cela. On aurait dit que ça leur faisait du bien. C’était le nouveau vice. « La France, mes amis, vous a fait confiance, c’est une femme, la plus belle des femmes la France! entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme la France! Victime de la plus lâche, de la plus abominable agression. Elle a le droit d’exiger de ses fils d’être vengée profondément la France! D’être rétablie dans l’intégrité de son territoire, même au prix du sacrifice le plus haut la France! Nous ferons tous ici, en ce qui nous concerne, notre devoir, mes amis, faites le vôtre! Notre science vous appartient! Elle est vôtre! Toutes ses ressources sont au service de votre guérison! Aidez-nous à votre tour dans la mesure de votre bonne volonté! Je le sais, elle nous est acquise votre bonne volonté! Et que bientôt vous puissiez tous reprendre votre place à côté de vos chers camarades des tranchées! Votre place sacrée! Pour la défense de notre sol chéri. Vive la France! En avant! » Il savait parler aux soldats.
Nous étions chacun au pied de notre lit, dans la position du garde-à-vous, l’écoutant. Derrière lui, une brune du groupe de ses jolies infirmières dominait mal l’émotion qui l’étreignait et que quelques larmes rendirent visible. Les autres infirmières, ses compagnes, s’empressèrent aussitôt: « Chérie! Chérie! Je vous assure… Il reviendra, voyons!.. »
C’était une de ses cousines, la blonde un peu boulotte, qui la consolait le mieux. En passant près de nous, la soutenant dans ses bras, elle me confia la boulotte qu’elle défaillait ainsi la cousine jolie, à cause du départ récent d’un fiancé mobilisé dans la marine. Le maître ardent, déconcerté, s’efforçait d’atténuer le bel et tragique émoi propagé par sa brève et vibrante allocution. Il en demeurait tout confus et peiné devant elle. Réveil d’une trop douloureuse inquiétude dans un cœur d’élite, évidemment pathétique, tout sensibilité et tendresse. « Si nous avions su, maître! chuchotait encore la blonde cousine, nous vous aurions prévenu… Ils s’aiment si tendrement si vous saviez!.. » Le groupe des infirmières et le Maître lui‐même disparurent parlotant toujours et bruissant à travers le couloir. On ne s’occupait plus de nous.
J’essayai de me rappeler et de comprendre le sens de cette allocution qu’il venait de prononcer, l’homme aux yeux splendides, mais loin, moi, de m’attrister elles me parurent en y réfléchissant, ces paroles, extraordinairement bien faites pour me dégoûter de mourir. C’était aussi l’avis des autres camarades, mais ils n’y trouvaient pas au surplus comme moi, une façon de défi et d’insulte. Eux ne cherchaient guère à comprendre ce qui se passait autour de nous dans la vie, ils discernaient seulement, et encore à peine, que le délire ordinaire du monde s’était accru depuis quelques mois, dans de telles proportions, qu’on ne pouvait décidément plus appuyer son existence sur rien de stable.
Ici à l’hôpital, tout comme dans la nuit des Flandres la mort nous tracassait; seulement ici, elle nous menaçait de plus loin la mort irrévocable tout comme là-bas, c’est vrai, une fois lancée sur votre tremblante carcasse par les soins de l’Administration.
Ici, on ne nous engueulait pas, certes, on nous parlait même avec douceur, on nous parlait tout le temps d’autre chose que de la mort, mais notre condamnation figurait toutefois, bien nette au coin de chaque papier qu’on nous demandait de signer, dans chaque précaution qu’on prenait à notre égard: Médailles… Bracelets… La moindre permission… N’importe quel conseil… On se sentait comptés, guettés, numérotés dans la grande réserve des partants de demain. Alors forcément, tout ce monde civil et sanitaire ambiant avait l’air plus léger que nous, par comparaison. Les infirmières, ces garces, ne le partageaient pas, elles, notre destin, elles ne pensaient par contraste, qu’à vivre longtemps, et plus longtemps encore et à aimer c’était clair, à se promener et à mille et dix mille fois faire et refaire l’amour. Chacune de ces angéliques tenait à son petit plan dans le périnée, comme les forçats, pour plus tard, le petit plan d’amour, quand nous serions, nous, crevés dans une boue quelconque et Dieu sait comment!
Elles vous auraient alors des soupirs remémoratifs spéciaux de tendresse qui les rendraient plus attrayantes encore, elles évoqueraient en silences émus, les tragiques temps de la guerre, les revenants… « Vous souvenez-vous du petit Bardamu, di-raient-elles à l’heure crépusculaire en pensant à moi, celui qu’on avait tant de mal à empêcher de tousser?.. Il en avait un mauvais moral celui-là, le pauvre petit… Qu’a-t-il pu devenir? »
Quelques regrets poétiques placés à propos siéent à une femme aussi bien que certains cheveux vaporeux sous les rayons de la lune.
À l’abri de chacun de leurs mots et de leur sollicitude, il fallait dès maintenant comprendre: « Tu vas crever gentil militaire… Tu vas crever… C’est la guerre… Chacun sa vie… Chacun son rôle… Chacun sa mort… Nous avons l’air de partager ta détresse… Mais on ne partage la mort de personne… Tout doit être aux âmes et aux corps bien portants, façon de distraction et rien de plus et rien de moins, et nous sommes nous des solides jeunes filles, belles, considérées, saines et bien élevées… Pour nous tout devient, biologie automatique, joyeux spectacle et se convertit en joie! Ainsi l’exige notre santé! Et les vilaines licences du chagrin nous sont impossibles… Il nous faut des excitants à nous, rien que des excitants… Vous serez vite oubliés, petits soldats… Soyez gentils, crevez bien vite… Et que la guerre finisse et qu’on puisse se marier avec un de vos aimables officiers… Un brun surtout!.. Vive la Patrie dont parle toujours papa!.. Comme l’amour doit être bon quand il revient de la guerre!.. Il sera décoré notre petit mari!.. Il sera distingué… Vous pourrez cirer ses jolies bottes le beau jour de notre mariage si vous existez encore à ce moment-là, petit soldat… Ne serez-vous pas alors heureux de notre bonheur, petit soldat?.. »
Chaque matin, nous le revîmes, et le revîmes encore le médecin‐chef, suivi de ses infirmières. C’était un savant, apprîmes-nous. Autour de nos salles réservées venaient trotter les vieillards de l’hospice d’à côté en bonds inutiles et disjoints. Ils s’en allaient crachoter leurs cancans avec leurs caries d’une salle à l’autre, porteurs de petits bouts de ragots et médisances éculées. Ici cloîtrés dans leur misère officielle comme au fond d’un enclos baveux, les vieux travailleurs broutaient toute la fiente qui dépose autour des âmes à l’issue des longues années de servitude. Haines impuissantes, rancies dans l’oisiveté pisseuse des salles communes. Ils ne se servaient de leurs ultimes et chevrotantes énergies que pour se nuire encore un petit peu et se détruire dans ce qui leur restait de plaisir et de souffle.
Suprême plaisir! Dans leur carcasse racornie il ne subsistait plus un seul atome qui ne fût strictement méchant.
Dès qu’il fut entendu que nous partagerions, soldats, les commodités relatives du bastion avec ces vieillards, ils se mirent à nous détester à l’unisson, non sans venir toutefois en même temps mendier et sans répit nos résidus de tabac à la traîne le long des croisées et les bouts de pain rassis tombés dessous les bancs. Leurs faces parcheminées s’écrasaient à l’heure des repas contre les vitres de notre réfectoire. Il passait entre les plis chassieux de leurs nez des petits regards de vieux rats convoiteux. L’un de ces infirmes paraissait plus astucieux et coquin que les autres, il venait nous chanter des chansonnettes de son temps pour nous distraire, le père Birouette qu’on l’appelait. Il voulait bien faire tout ce qu’on voulait pourvu qu’on lui donnât du tabac, tout ce qu’on voulait sauf passer devant la morgue du bastion qui d’ailleurs ne chômait guère. L’une des blagues consistait à l’emmener de ce côté-là, soi-disant en promenade. « Tu veux pas entrer? » qu’on lui demandait quand on était en plein devant la porte. Il se sauvait alors bien râleux mais si vite et si loin qu’on ne le revoyait plus de deux jours au moins, le père Birouette. Il avait entrevu la mort.
Notre médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bestombes, avait fait installer pour nous redonner de l’âme, tout un appareillage très compliqué d’engins électriques étincelants dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu’il prétendait toniques et qu’il fallait accepter sous peine d’expulsion. Il était fort riche, semblait-il, Bestombes, il fallait l’être pour acheter tout ce coûteux bazar électrocuteur. Son beau-père, grand politique, ayant puissamment tripoté au cours d’achats gouvernementaux de terrains, lui permettait ces largesses.
Il fallait en profiter. Tout s’arrange. Crimes et châtiments. Tel qu’il était, nous ne le détestions pas. Il examinait notre système nerveux avec un soin extraordinaire, et nous interrogeait sur le ton d’une courtoise familiarité. Cette bonhomie soigneusement mise au point divertissait délicieusement les infirmières, toutes distinguées, de son service. Elles attendaient chaque matin, ces mignonnes, le moment de se réjouir des manifestations de sa haute gentillesse, c’était du nanan. Nous jouions tous en somme dans une pièce où il avait choisi lui Bestombes le rôle du savant bienfaisant et profondément, aimablement humain, le tout était de s’entendre.
Dans ce nouvel hôpital, je faisais chambre commune avec le sergent Branledore, rengagé; c’était un ancien convive des hôpitaux, lui, Branledore. Il avait traîné son intestin perforé depuis des mois, dans quatre différents services.
Il avait appris au cours de ces séjours à attirer et puis à retenir la sympathie active des infirmières. Il rendait, urinait et coliquait du sang assez souvent Branledore, il avait aussi bien du mal à respirer, mais cela n’aurait pas entièrement suffi à lui concilier les bonnes grâces toutes spéciales du personnel traitant qui en voyait bien d’autres. Alors entre deux étouffements s’il y avait un médecin ou une infirmière à passer par là: « Victoire! Victoire! Nous aurons la Victoire! » criait Branledore, ou le murmurait du bout ou de la totalité de ses poumons selon le cas. Ainsi rendu conforme à l’ardente littérature agressive, par un effet d’opportune mise en scène, il jouissait de la plus haute cote morale. Il le possédait, le truc, lui.
Comme le Théâtre était partout il fallait jouer et il avait bien raison Branledore; rien aussi n’a l’air plus idiot et n’irrite davantage, c’est vrai, qu’un spectateur inerte monté par hasard sur les planches. Quand on est là-dessus, n’est-ce pas, il faut prendre le ton, s’animer, jouer, se décider ou bien disparaître. Les femmes surtout demandaient du spectacle et elles étaient impitoyables, les garces, pour les amateurs déconcertés. La guerre, sans conteste, porte aux ovaires, elles en exigeaient des héros, et ceux qui ne l’étaient pas du tout devaient se présenter comme tels ou bien s’apprêter à subir le plus ignominieux des destins.
Après huit jours passés dans ce nouveau service, nous avions compris l’urgence d’avoir à changer de dégaine et, grâce à Branledore (dans le civil placier en dentelles), ces mêmes hommes apeurés et recherchant l’ombre, possédés par des souvenirs honteux d’abattoirs que nous étions en arrivant, se muèrent en une satanée bande de gaillards, tous résolus à la victoire et je vous le garantis armés d’abattage et de formidables propos. Un dru langage était devenu en effet le nôtre, et si salé que ces dames en rougissaient parfois, elles ne s’en plaignaient jamais cependant parce qu’il est bien entendu qu’un soldat est aussi brave qu’insouciant, et grossier plus souvent qu’à son tour, et que plus il est grossier et que plus il est brave.
Au début, tout en copiant Branledore de notre mieux, nos petites allures patriotiques n’étaient pas encore tout à fait au point, pas très convaincantes. Il fallut une bonne semaine et même deux de répétitions intensives pour nous placer absolument dans le ton, le bon.
Dès que notre médecin, professeur agrégé Bestombes, eut noté, ce savant, la brillante amélioration de nos qualités morales, il résolut, à titre d’encouragement, de nous autoriser quelques visites, à commencer par celles de nos parents.
Certains soldats bien doués, à ce que j’avais entendu conter, éprouvaient quand ils se mêlaient aux combats, une sorte de griserie et même une vive volupté. Dès que pour ma part j’essayais d’imaginer une volupté de cet ordre bien spécial, je m’en rendais malade pendant huit jours au moins. Je me sentais si incapable de tuer quelqu’un, qu’il valait décidément mieux que j’y renonce et que j’en finisse tout de suite. Non que l’expérience m’eût manqué, on avait même fait tout pour me donner le goût, mais le don me faisait défaut. Il m’aurait fallu peut-être une plus lente initiation.
Je résolus certain jour de faire part au professeur Bestombes des difficultés que j’éprouvais corps et âme à être aussi brave que je l’aurais voulu et que les circonstances, sublimes certes, l’exigeaient. Je redoutais un peu qu’il se prît à me considérer comme un effronté, un bavard impertinent… Mais point du tout. Au contraire! Le Maître se déclara tout à fait heureux que dans cet accès de franchise je vienne m’ouvrir à lui du trouble d’âme que je ressentais.
« Vous allez mieux Bardamu, mon ami! Vous allez mieux, tout simplement! » Voici ce qu’il concluait. « Cette confidence que vous venez me faire, absolument spontanément, je la considère, Bardamu, comme l’indice très encourageant d’une amélioration notable de votre état mental… Vaudesquin, d’ailleurs, cet observateur modeste, mais combien sagace, des défaillances morales chez les soldats de l’Empire, avait résumé, dès 1802, des observations de ce genre dans un mémoire à présent classique, bien qu’injustement négligé par nos étudiants actuels, où il notait, dis-je, avec beaucoup de justesse et de précision des crises dites d’“aveux”, qui surviennent, signe entre tous excellent, chez le convalescent moral… Notre grand Dupré, près d’un siècle plus tard, sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre où cette crise identique figure sous le titre de crise du “rassemblement des souvenirs”, crise qui doit, selon le même auteur, précéder de peu, lorsque la cure est bien conduite, la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience, phénomène second en somme dans le cours du rétablissement psychique. Dupré donne d’autre part, dans sa terminologie si imagée et dont il avait l’apanage, le nom de “diarrhée cogitive de libération à cette crise qui s’accompagne chez le sujet d’une sensation d’euphorie très active, d’une reprise très marquée de l’activité de relations, reprise, entre autres, très notable du sommeil, qu’on voit se prolonger soudain pendant des journées entières, enfin autre stade: suractivité très marquée des fonctions génitales, à tel point qu’il n’est pas rare d’observer chez les mêmes malades auparavant frigides, de véritables “fringales érotiques”. D’où cette formule: “Le malade n’entre pas dans la guérison, il s’y rue!” Tel est le terme magnifiquement descriptif, n’est-ce pas, de ces triomphes récupératifs, par lequel un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier, Philibert Margeton, caractérisait la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un sujet convalescent de la maladie de la peur… Pour ce qui vous concerne, Bardamu, je vous considère donc et dès à présent, comme un véritable convalescent… Vous intéressera-t-il, Bardamu, puisque nous en sommes à cette satisfaisante conclusion, de savoir que demain, précisément, je présente à la Société de Psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l’esprit humain?.. Ce mémoire est de qualité, je le crois.
– Certes, Maître, ces questions me passionnent…
– Eh bien, sachez, en résumé, Bardamu, que j’y défends cette thèse: qu’avant la guerre, l’homme restait pour le psychiatre un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme…
– C’est bien aussi mon très modeste avis, Maître…
– La guerre, voyez-vous, Bardamu, par les moyens incomparables qu’elle nous donne pour éprouver les systèmes nerveux, agit à la manière d’un formidable révélateur de l’Esprit humain! Nous en avons pour des siècles à nous pencher, méditatifs, sur ces révélations pathologiques récentes, des siècles d’études passionnées… Avouons-le franchement… Nous ne faisions que soupçonner jusqu’ici les richesses émotives et spirituelles de l’homme! Mais à présent, grâce à la guerre, c’est fait… Nous pénétrons, par suite d’une effraction, douloureuse certes, mais pour la science, décisive et providentielle, dans leur intimité! Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste modernes ne fit, pour moi Bestombes, plus aucun doute! Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s’imposait! »
C’était bien mon avis aussi, à moi, Bardamu. « Je crois, en effet, Maître, qu’on ferait bien…
– Ah! vous le pensez aussi, Bardamu, je ne vous le fais pas dire! Chez l’homme, voyez-vous, le bon et le mauvais s’équili-brent, égoïsme d’une part, altruisme de l’autre… Chez les sujets d’élite, plus d’altruisme que d’égoïsme. Est‐ce exact? Est‐ce bien cela?
– C’est exact, Maître, c’est cela même…
– Et chez le sujet d’élite quel peut être, je vous le demande Bardamu, la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l’obliger à se manifester incontestablement, cet altruisme?
– Le patriotisme, Maître!
– Ah! Voyez-vous, je ne vous le fais pas dire! Vous me comprenez tout à fait bien… Bardamu! Le patriotisme et son corollaire, la gloire, tout simplement, sa preuve!
– C’est vrai!
– Ah! nos petits soldats, remarquez-le, et dès les premières épreuves du feu ont su se libérer spontanément de tous les sophismes et concepts accessoires, et particulièrement des sophismes de la conservation. Ils sont allés d’instinct et d’emblée se fondre avec notre véritable raison d’être, notre Patrie. Pour accéder à cette vérité, non seulement l’intelligence est superflue, Bardamu, mais elle gêne! C’est une vérité du cœur, la Patrie, comme toutes les vérités essentielles, le peuple ne s’y trompe pas! Là précisément où le mauvais savant s’égare…
– Cela est beau, Maître! Trop beau! C’est de l’Antique! »
Il me serra les deux mains presque affectueusement, Bestombes.
D’une voix devenue paternelle, il voulut bien ajouter encore à mon profit: « C’est ainsi que j’entends traiter mes malades, Bardamu, par l’électricité pour le corps et pour l’esprit, par de vigoureuses doses d’éthique patriotique, par les véritables injections de la morale reconstituante!
– Je vous comprends, Maître! »
Je comprenais en effet de mieux en mieux.
En le quittant, je me rendis sans tarder à la messe avec mes compagnons reconstitués dans la chapelle battant neuf, j’aperçus Branledore qui manifestait de son haut moral derrière la grande porte où il donnait justement des leçons d’entrain à la petite fille de la concierge. J’allai de suite l’y rejoindre, comme il m’y conviait.
L’après-midi, des parents vinrent de Paris pour la première fois depuis que nous étions là et puis ensuite chaque semaine.
J’avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m’aider beaucoup en m’embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne parce qu’elle croyait aux mots elle qu’on lui disait pour m’enlever. La chienne au moins, ne croit que ce qu’elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l’hôpital, une après-midi, à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu’il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des cent petits chiffons pendants, les chemises des pauvres, à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîtes à ordures. Il y a des usines qu’on évite en promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables et où l’air d’alentour se refuse à puer davantage. Tout près, moisit la petite fête foraine, entre deux hautes cheminées inégales, ses chevaux de bois dépeint sont trop coûteux pour ceux qui les désirent, pendant des semaines entières souvent, petits morveux rachitiques, attirés, repoussés et retenus à la fois, tous les doigts dans le nez, par leur abandon, la pauvreté et la musique.
Tout se passe en efforts pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde; on a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l’encre, le ciel reste ce qu’il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue.
Par terre, la boue vous tire sur la fatigue et les côtés de l’existence sont fermés aussi, bien clos par des hôtels et des usines encore. C’est déjà des cercueils les murs de ce côté-là. Lola, bien partie, Musyne aussi, je n’avais plus personne. C’est pour ça que j’avais fini par écrire à ma mère, question de voir quelqu’un. À vingt ans je n’avais déjà plus que du passé. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, ce qu’on disait autour d’elle de la guerre, en ville, que c’était triste, la guerre, « épouvantable » même, mais qu’avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir, les tués pour elle c’était rien que des accidents, comme aux courses, y n’ont qu’à bien se tenir, on ne tombait pas. En ce qui la concernait, elle n’y découvrait dans la guerre qu’un grand chagrin nouveau qu’elle essayait de ne pas trop remuer; il lui faisait comme peur ce chagrin; il était comblé de choses redoutables qu’elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c’était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore, en grande partie à ce qu’ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens… Ils avaient dû faire des sottises, sans s’en rendre compte, bien sûr, mais tout de même ils étaient coupables et c’était déjà bien gentil qu’on leur donne ainsi en souffrant l’occasion d’expier leurs indignités… C’était une « intouchable » ma mère.
Cet optimisme résigné et tragique lui servait de foi et formait le fond de sa nature.
Nous suivions tous les deux les rues à lotir, sous la pluie;
les trottoirs par là enfoncent et se dérobent, les petits frênes en bordure gardent longtemps leurs gouttes aux branches, en hiver, tremblantes dans le vent, mince féerie. Le chemin de l’hôpital passait devant de nombreux hôtels récents, certains avaient des noms, d’autres n’avaient même pas pris ce mal. « À la semaine » qu’ils étaient, tout simplement. La guerre les avait vidés brutalement de leur contenu de tâcherons et d’ouvriers. Ils n’y rentreraient même plus pour mourir les locataires. C’est un travail aussi ça mourir, mais ils s’en acquitteraient dehors.
Ma mère me reconduisait à l’hôpital en pleurnichant, elle acceptait l’accident de ma mort, non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j’avais autant de résignation qu’ele-même. Elle croyait à la fatalité autant qu’au beau mètre des Arts et Métiers, dont elle m’avait toujours parlé avec respect, parce qu’elle avait appris étant jeune, que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel.
Entre les lotissements de cette campagne déchue existaient encore quelques champs et cultures de-ci de-là, et même accrochés à ces bribes quelques vieux paysans coincés entre les maisons nouvelles. Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans s’acharner à fouiller avec du fer cette chose molle et grenue qu’est la terre, où on met à pourrir les morts et d’où vient le pain quand même. « Ça doit être bien dur la terre! » qu’elle remarquait chaque fois en les regardant ma mère bien perplexe. Elle ne connaissait en fait de misères que celles qui ressemblaient à la sienne, celles des villes, elle essayait de s’imaginer ce que pouvaient être celles de la campagne. C’est la seule curiosité que je lui aie jamais connue, à ma mère, et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Elle rentrait avec ça en ville.
Je ne recevais plus du tout de nouvelles de Lola, ni de Musyne non plus. Elles demeuraient décidément les garces du bon côté de la situation où régnait une consigne souriante mais implacable d’élimination envers nous autres, nous les viandes destinées aux sacrifices. À deux reprises ainsi on m’avait déjà reconduit vers les endroits où se parquent les otages. Question de temps et d’attente seulement. Les jeux étaient faits.
Branledore mon voisin d’hôpital, le sergent, jouissait, je l’ai raconté, d’une persistante popularité parmi les infirmières, il était recouvert de pansements et ruisselait d’optimisme. Tout le monde à l’hôpital l’enviait et copiait ses manières. Devenus présentables et pas dégoûtants du tout moralement nous nous mîmes à notre tour à recevoir les visites de gens bien placés dans le monde et haut situés dans l’administration parisienne. On se le répéta dans les salons, que le centre neuro-médical du professeur Bestombes devenait le véritable lieu de l’intense ferveur patriotique, le foyer, pour ainsi dire. Nous eûmes désormais à nos jours non seulement des évêques, mais une duchesse italienne, un grand munitionnaire, et bientôt l’Opéra lui-même et les pensionnaires du Théâtre‐Français. On venait nous admirer sur place. Une belle subventionnée de la Comédie qui récitait les vers comme pas une revint même à mon chevet pour m’en déclamer de particulièrement héroïques. Sa rousse et perverse chevelure (la peau allant avec) était parcourue pendant ce temps-là d’ondes étonnantes qui m’arrivaient droit par vibrations jusqu’au périnée. Comme elle m’interrogeait cette divine sur mes actions de guerre, je lui donnai tant de détails et des si excités et des si poignants, qu’elle ne me quitta désormais plus des yeux. Émue durablement, elle manda licence de faire frapper en vers, par un poète de ses admirateurs, les plus intenses passages de mes récits. J’y consentis d’emblée. Le professeur Bestombes, mis au courant de ce projet, s’y déclara particulièrement favorable. Il donna même une interview à cette occasion et le même jour aux envoyés d’un grand « Illustré national » qui nous photographia tous ensemble sur le perron de! hôpital aux côtés de la belle sociétaire. « C’est le plus haut devoir des poètes, pendant les heures tragiques que nous traversons, déclara le professeur Bestombes, qui n’en ratait pas une, de nous redonner le goût de l’Épopée! Les temps ne sont plus aux petites combinaisons mesquines! Sus aux littératures racornies! Une âme nouvelle nous est éclose au milieu du grand et noble fracas des batailles! L’essor du grand renouveau patriotique l’exige désormais! Les hautes cimes promises à notre Gloire!.. Nous exigeons le souffle grandiose du poème épique!.. Pour ma part, je déclare admirable que dans cet hôpital que je dirige, il vienne à se former sous nos yeux, inoubliablement, une de ces sublimes collaborations créatrices entre le Poète et l’un de nos héros! »
Branledore, mon compagnon de chambre, dont l’imagination avait un peu de retard sur la mienne dans la circonstance et qui ne figurait pas non plus sur la photo en conçut une vive et tenace jalousie. Il se mit dès lors à me disputer sauvagement la palme de l’héroïsme. Il inventait de nouvelles histoires, il se surpassait, on ne pouvait plus l’arrêter, ses exploits tenaient du délire.
Il m’était difficile de trouver plus fort, d’ajouter quelque chose encore à de telles outrances, et cependant personne à l’hôpital ne se résignait, c’était à qui parmi nous, saisi d’émulation, inventerait à qui mieux mieux d’autres « belles pages guerrières » où figurer sublimement. Nous vivions un grand roman de geste, dans la peau de personnages fantastiques, au fond desquels, dérisoires, nous tremblions de tout le contenu de nos viandes et de nos âmes. On en aurait bavé si on nous avait surpris au vrai. La guerre était mûre.
Notre grand Bestombes recevait encore les visites de nombreux notables étrangers, messieurs scientifiques, neutres, sceptiques et curieux. Les Inspecteurs généraux du Ministère passaient sabrés et pimpants à travers nos salles, leur vie militaire prolongée à ceux‐là, rajeunis donc c’est‐à‐dire, et gonflés d’indemnités nouvelles. Aussi n’étaient-ils point chiches de distinctions et d’éloges les Inspecteurs. Tout allait bien. Bestombes et ses blessés superbes devinrent l’honneur du service de Santé.
Ma belle protectrice du « Français » revint elle-même bientôt une fois encore pour me rendre visite, en particulier, cependant que son poète familier achevait, rimé, le récit de mes exploits. Ce jeune homme, je le rencontrai finalement, pâle, anxieux, quelque part au détour d’un couloir. La fragilité des fibres de son cœur, me confia‐t‐il, de l’avis même des médecins, tenait du miracle. Aussi le retenaient-ils, ces médecins soucieux des êtres fragiles, loin des armées. En compensation, il avait entrepris, ce petit barde, au péril de sa santé même et de toutes ses suprêmes forces spirituelles, de forger, pour nous, l’« Airain Moral de notre Victoire ». Un bel outil par conséquent, en vers inoubliables, bien entendu, comme tout le reste.
Je n’allais pas m’en plaindre, puisqu’il m’avait choisi entre tant d’autres braves indéniables pour être son héros! Je fus d’ailleurs, avouons‐le, royalement servi. Ce fut magnifique à vrai dire. L’événement du récital eut lieu à la Comédie-Française même, au cours d’une après-midi, dite poétique. Tout l’hôpital fut invité. Lorsque sur la scène apparut ma rousse, frémissante récitante, le geste grandiose, la taille longuement moulée dans les plis devenus enfin voluptueux du tricolore, ce fut le signal dans la salle entière, debout, désireuse, d’une de ces ovations qui n’en finissent plus. J’étais préparé certes, mais mon étonnement fut réel néanmoins, je ne pus celer ma stupéfaction à mes voisins en l’entendant vibrer, exhorter de la sorte, cette superbe amie, gémir même, pour rendre mieux sensible tout le drame inclus dans l’épisode que j’avais inventé à son usage. Son poète décidément me rendait des points pour l’imaginative, il avait encore monstrueusement magnifié la mienne, aidé de ses rimes flamboyantes, d’adjectifs formidables qui venaient retomber solennels dans l’admiratif et capital silence. Parvenue dans l’essor d’une période, la plus chaleureuse du morceau, s’adressant à la loge où nous étions placés, Branledore et moi-même, et quelques autres blessés, l’artiste, ses deux bras splendides tendus, sembla s’offrir au plus héroïque d’entre nous. Le poète illustrait pieusement à ce moment-là un fantastique trait de bravoure que je m’étais attribué. Je ne sais plus très bien ce qui se passait, mais ça n’était pas de la piquette. Heureusement, rien n’est incroyable en matière d’héroïsme. Le public devina le sens de l’offrande artistique et la salle entière tournée alors vers nous, hurlante de joie, transportée, trépignante, réclamait le héros.
Branledore accaparait tout le devant de la loge et nous dépassait tous, puisqu’il pouvait nous dissimuler presque complètement derrière ses pansements. Il le faisait exprès le salaud.
Mais deux de nos camarades, eux grimpés sur des chaises derrière lui, se firent quand même admirer par la foule par‐dessus ses épaules et sa tête. On les applaudit à tout rompre.
« Mais, c’est de moi qu’il s’agit! ai-je failli crier à ce moment. De moi seul! » Je connaissais mon Branledore, on se serait engueulés devant tout le monde et peut-être même battus. Finalement ce fut lui qui gagna la soucoupe. Il s’imposa. Triomphant, il demeura seul, comme il le désirait, pour recueillir l’énorme hommage. Vaincus, il ne nous restait plus qu’à nous ruer, nous, vers les coulisses, ce que nous fîmes et là nous fûmes heureusement refêtés. Consolation. Cependant notre actrice-inspiratrice n’était point seule dans sa loge. À ses côtés se tenait le poète, son poète, notre poète. Il aimait aussi comme elle, les jeunes soldats, bien gentiment. Ils me le firent comprendre artistement. Une affaire. On me le répéta, mais je n’en tins aucun compte de leurs gentilles indications. Tant pis pour moi, parce que les choses auraient pu très bien s’arranger. Ils avaient beaucoup d’influence. Je pris congé brusquement, et sottement vexé. J’étais jeune.
Récapitulons: les aviateurs m’avaient ravi Lola, les Argentins pris Musyne et cet harmonieux inverti, enfin, venait de me souffler ma superbe comédienne. Désemparé, je quittai la Comédie pendant qu’on éteignait les derniers flambeaux des couloirs et rejoignis seul, par la nuit, sans tramway, notre hôpital, souricière au fond des boues tenaces et des banlieues insoumises.
Sans chiqué, je dois bien convenir que ma tête n’a jamais été très solide. Mais pour un oui, pour un non, à présent, des étourdissements me prenaient, à en passer sous les voitures. Je titubais dans la guerre. En fait d’argent de poche, je ne pouvais compter pendant mon séjour à l’hôpital, que sur les quelques francs donnés par ma mère chaque semaine bien péniblement. Aussi, me mis-je dès que cela me fut possible à la recherche de petits suppléments, par-ci par-là, où je pouvais en escompter. L’un de mes anciens patrons, d’abord, me sembla propice à cet égard et reçut ma visite aussitôt.
Il me souvenait bien opportunément d’avoir besogné quelques temps obscurs chez ce Roger Puta, le bijoutier de la Madeleine, en qualité d’employé supplémentaire, un peu avant la déclaration de la guerre. Mon ouvrage chez ce dégueulasse bijoutier consistait en « extras », à nettoyer son argenterie du magasin, nombreuse, variée, et pendant les fêtes à cadeaux, à cause des tripotages continuels, d’entretien difficile.
Dès la fermeture de la Faculté, où je poursuivais de rigoureuses et interminables études (à cause des examens que je ratais), je rejoignais au galop l’arrière-boutique de M. Puta et m’escrimais pendant deux ou trois heures sur ses chocolatières, « au blanc d’Espagne » jusqu’au moment du dîner.
Pour prix de mon travail j’étais nourri, abondamment d’ailleurs, à la cuisine. Mon boulot consistait encore, d’autre part, avant l’heure des cours, à faire promener et pisser les chiens de garde du magasin.
Le tout ensemble pour 40 francs par mois. La bijouterie Puta scintillait de mille diamants à l’angle de la rue Vignon, et chacun de ces diamants coûtait autant que plusieurs décades de mon salaire. Ils y scintillent d’ailleurs toujours ces joyaux. Versé dans l’auxiliaire à la mobilisation, ce patron Puta se mit à servir particulièrement un Ministre, dont il conduisait de temps à autre l’automobile. Mais d’autre part, et cette fois de façon tout à fait officieuse, il se rendait Puta, des plus utiles, en fournissant les bijoux du Ministère. Le haut personnel spéculait fort heureusement sur les marchés conclus et à conclure. Plus on avançait dans la guerre et plus on avait besoin de bijoux. M. Puta avait même quelquefois de la peine à faire face aux commandes tellement il en recevait.
Quand il était surmené, M. Puta arrivait à prendre un petit air d’intelligence, à cause de la fatigue qui le tourmentait, et uniquement dans ces moments-là. Mais reposé, son visage, malgré la finesse incontestable de ses traits, formait une harmonie de placidité sotte dont il est difficile de ne pas garder pour toujours un souvenir désespérant.
Sa femme Mme Puta, ne faisait qu’un avec la caisse de la maison, qu’elle ne quittait pour ainsi dire jamais. On l’avait élevée pour qu’elle devienne la femme d’un bijoutier. Ambition de parents. Elle connaissait son devoir, tout son devoir. Le ménage était heureux en même temps que la caisse était prospère. Ce n’est point qu’elle fût laide, Mme Puta, non, elle aurait même pu être assez jolie, comme tant d’autres, seulement elle était si prudente, si méfiante qu’elle s’arrêtait au bord de la beauté, comme au bord de la vie, avec ses cheveux un peu trop peignés, son sourire un peu trop facile et soudain, des gestes un peu trop rapides ou un peu trop furtifs. On s’agaçait à démêler ce qu’il y avait de trop calculé dans cet être et les raisons de la gêne qu’on éprouvait en dépit de tout, à son approche. Cette répulsion instinctive qu’inspirent les commerçants à ceux qui les approchent et qui savent, est une des très rares consolations qu’éprouvent d’être aussi miteux qu’ils le sont ceux qui ne vendent tien à personne.
Les soucis étriqués du commerce la possédaient donc tout entière Mme Puta, tout comme Mme Herote, mais dans un autre genre et comme Dieu possède ses religieuses, corps et âme.
De temps en temps, cependant, elle éprouvait, notre patronne, comme un petit souci de circonstance. Ainsi lui arrivait-il de se laisser aller à penser aux parents de la guerre. « Quel malheur cette guerre tout de même pour les gens qui ont de grands enfants!
– Réfléchis donc avant de parler! la reprenait aussitôt son mari, que ces sensibleries trouvaient, lui, prêt et résolu. Ne faut-il pas que la France soit défendue? »
Ainsi bons cœurs. mais bons patriotes par-dessus tout, stoïques en somme, ils s’endormaient chaque soir de la guerre au-dessus des millions de leur boutique, fortune française.
Dans les bordels qu’il fréquentait de temps en temps, M. Puta se montrait exigeant et désireux de n’être point pris pour un prodigue. « Je ne suis pas un Anglais moi, mignonne, prévenait-il dès l’abord. Je connais le travail! Je suis un petit soldat français pas pressé! » Telle était sa déclaration préambulaire. Les femmes l’estimaient beaucoup pour cette façon sage de prendre son plaisir. Jouisseur mais pas dupe, un homme. Il profitait de ce qu’il connaissait son monde pour effectuer quelques transactions de bijoux avec la sous-maîtresse, qui elle ne croyait pas aux placements en Bourse. M. Puta progressait de façon surprenante au point de vue militaire, de réformes temporaires en sursis définitifs. Bientôt il fut tout à fait libéré après on ne sait combien de visites médicales opportunes. Il comptait pour l’une des plus hautes joies de son existence la contemplation et si possible la palpation de beaux mollets. C’était au moins un plaisir par lequel il dépassait sa femme, elle uniquement vouée au commerce. À qualités égales, on trouve toujours, semble-t-il, un peu plus d’inquiétude chez l’homme que chez la femme, si borné, si croupissant qu’il puisse être. C’était un petit début d’artiste en somme ce Puta. Beaucoup d’hommes, en fait d’art, s’en tiennent toujours comme lui à la manie des beaux mollets. Mme Puta était bien heureuse de ne pas avoir d’enfants. Elle manifestait si souvent sa satisfaction d’être stérile que son mari à son tour, finit par communiquer leur contentement à la sous‐maîtresse. « Il faut cependant bien que les enfants de quelqu’un y aillent, répondait celle-ci à son tour, puisque c’est un devoir! » C’est vrai que la guerre comportait des devoirs.
Le Ministre que servait Puta en automobile n’avait pas non plus d’enfants, les Ministres n’ont pas d’enfants.
Un autre employé accessoire travaillait en même temps que moi aux petites besognes du magasin vers 1913: c’était Jean Voireuse, un peu « figurant » pendant la soirée dans les petits théâtres et l’après‐midi livreur chez Puta. Il se contentait lui aussi de très minimes appointements. Mais il se débrouillait grâce au métro. Il allait presque aussi vite à pied qu’en métro, pour faire ses courses. Alors il mettait le prix du billet dans sa poche. Tout rabiot. Il sentait un peu des pieds, c’est vrai, et même beaucoup, mais il le savait et me demandait de l’avertir quand il n’y avait pas de clients au magasin pour qu’il puisse y pénétrer sans dommage et faire ses comptes en douce avec Mme Puta. Une fois l’argent encaissé, on le renvoyait instantanément me rejoindre dans l’arrière-boutique. Ses pieds lui servirent encore beaucoup pendant la guerre. Il passait pour l’agent de liaison le plus rapide de son régiment. En convalescence il vint me voir au fort de Bicêtre et c’est même à l’occasion de cette visite que nous décidâmes d’aller ensemble taper notre ancien patron. Qui fut dit, fut fait. Au moment où nous arrivions boulevard de la Madeleine, on finissait l’étalage…
« Tiens! Ah! vous voilà vous autres! s’étonna un peu de nous voir M. Puta. Je suis bien content quand même! Entrez! Vous, Voireuse, vous avez bonne mine! Ça va bien! Mais vous, Bardamu, vous avez l’air malade, mon garçon! Enfin! vous êtes jeune! Ça reviendra! Vous en avez de la veine, malgré tout, vous autres! on peut dire ce que l’on voudra, vous vivez des heures magnifiques, hein? là‐haut? Et à l’air! C’est de l’Histoire ça mes amis, ou je m’y connais pas! Et quelle Histoire! »
On ne répondait rien à M. Puta, on le laissait dire tout ce qu’il voulait avant de le taper… Alors, il continuait:
« Ah! c’est dur, j’en conviens, les tranchées!.. C’est vrai! Mais c’est joliment dur ici aussi, vous savez!.. Vous avez été blessés, hein vous autres? Moi, je suis éreinté! J’en ai fait du service de nuit en ville depuis deux ans! Vous vous rendez compte? Pensez donc! Absolument éreinté! Crevé! Ah! les rues de Paris pendant la nuit! Sans lumière, mes petits amis… Y conduire une auto et souvent avec le Ministre dedans! Et en vitesse encore! Vous pouvez pas vous imaginer!.. C’est à se tuer dix fois par nuit!..
– Oui, ponctua Mme Puta, et quelquefois il conduit la femme du Ministre aussi…
– Ah oui! et c’est pas fini…
– C’est terrible! reprîmes-nous ensemble.
– Et les chiens? demanda Voireuse pour être poli. Qu’en a-t-on fait? Va-t-on encore les promener aux Tuileries?
– Je les ai fait abattre! Ils me faisaient du tort! Ça ne faisait pas bien au magasin!.. Des bergers allemands!
– C’est malheureux! regretta sa femme. Mais les nouveaux chiens qu’on a maintenant sont bien gentils, c’est des écossais… Ils sentent un peu… Tandis que nos bergers allemands, vous vous souvenez Voireuse?.. Ils ne sentaient jamais pour ainsi dire. On pouvait les garder dans le magasin enfermés, même après la pluie…
– Ah oui! ajouta M. Puta. C’est pas comme ce sacré Voireuse, avec ses pieds! Est-ce qu’ils sentent toujours, vos pieds, Jean? Sacré Voireuse va!
– Je crois encore un peu », qu’il a répondu Voireuse.
À ce moment des clients entrèrent.
« Je ne vous retiens plus, mes amis, nous fit M. Puta soucieux d’éliminer Jean au plus tôt du magasin. Et bonne santé surtout! Je ne vous demande pas d’où vous venez! Eh non! Défense Nationale avant tout, c’est mon avis! »
À ces mots de Défense Nationale, il se fit tout à fait sérieux, Puta, comme lorsqu’il rendait la monnaie… Ainsi on nous congédiait.
Mme Puta nous remit vingt francs à chacun en partant. Le magasin astiqué et luisant comme un yacht, on n’osait plus le retraverser à cause de nos chaussures qui sur le fin tapis paraissaient monstrueuses.
« Ah! regarde-les donc, Roger, tous les deux! Comme ils sont drôles!.. Ils n’ont plus l’habitude! On dirait qu’ils ont marché dans quelque chose! s’exclamait Mme Puta.
– Ça leur reviendra! » fit M. Puta, cordial et bonhomme, et bien content d’être débarrassé aussi promptement à si peu de frais.
Une fois dans la rue, nous réfléchîmes qu’on irait pas très loin avec nos vingt francs chacun, mais Voireuse lui, avait une idée supplémentaire.
« Viens, qu’il me dit, chez la mère d’un copain qui est mort pendant qu’on était dans la Meuse, j’y vais moi tous les huit jours, chez ses parents, pour leur raconter comment qu’il est mort leur fieu… C’est des gens riches… Elle me donne dans les cent francs à chaque fois, sa mère… Ça leur fait plaisir qu’ils disent… Alors tu comprends…
– Qu’est-ce que j’irai y faire moi, chez eux? Qu’est-ce que je dirai moi à la mère?
– Eh bien tu lui diras que tu l’as vu, toi aussi… Elle te donnera cent francs à toi aussi… C’est des vrais gens riches ça! Je te dis! Et qui sont pas comme ce mufle de Puta… Y regardent pas eux…
– Je veux bien, mais elle va pas me demander des détails, t’es sûr?.. Parce que je l’ai pas connu moi, son fils hein… Je nagerais moi si elle en demandait…
– Non, non, ça fait rien, tu diras tout comme moi… Tu feras: Oui, oui… T’en fais pas! Elle a du chagrin, tu comprends, cette femme‐là, et du moment alors qu’on lui parle de son fils, elle est contente… C’est rien que ça qu’elle demande… N’importe quoi… C’est pas durillon… »
Je parvenais mal à me décider, mais j’avais bien envie des cent francs qui me paraissaient exceptionnellement faciles à obtenir et comme providentiels.
« Bon, que je me décidai à la fin… Mais alors faut que j’invente rien, hein je te préviens! Tu me promets? Je dirai comme toi, c’est tout… Comment qu’il est mort d’abord le gars?
– Il a pris un obus en pleine poire, mon vieux, et puis pas un petit, à Garance que ça s’appelait… dans la Meuse sur le bord d’une rivière… On en a pas retrouvé “ça” du gars, mon vieux! C’était plus qu’un souvenir, quoi… Et pourtant, tu sais, il était grand, et bien balancé, le gars, et fort, et sportif, mais contre un obus hein? Pas de résistance!
– C’est vrai!
– Nettoyé, je te dis qu’il a été… Sa mère, elle a encore du mal à croire ça au jour d’aujourd’hui! J’ai beau y dire et y redire… Elle veut qu’il soye seulement disparu… C’est idiot une idée comme ça… Disparu!.. C’est pas de sa faute, elle en a jamais vu, elle, d’obus, elle peut pas comprendre qu’on foute le camp dans l’air comme ça, comme un pet, et puis que ça soye fini, surtout que c’est son fils…
– Évidemment!
– D’abord, je n’y ai pas été depuis quinze jours, chez eux… Mais tu vas voir quand j’y arrive, elle me reçoit tout de suite sa mère, dans le salon, et puis tu sais, c’est beau chez eux, on dirait un théâtre, tellement qu’y en a des rideaux, des tapis, des glaces partout… Cent francs, tu comprends, ça doit pas les gêner beaucoup… C’est comme moi cent sous, qui dirait-on à peu près… Aujourd’hui elle est même bonne pour deux cents… Depuis quinze jours qu’elle m’a pas vu… Tu verras les domestiques avec les boutons en doré, mon ami… »
À l’avenue Henri-Martin, on tournait sur la gauche et puis on avançait encore un peu, enfin, on arrivait devant une grille au milieu des arbres d’une petite allée privée.
« Tu vois! que remarqua Voireuse, quand on fut bien devant, c’est comme une espèce de château… Je te l’avais bien dit… Le père est un grand manitou dans les chemins de fer, qu’on m’a raconté… C’est une huile…
– Il est pas chef de gare? que je fais moi pour plaisanter.
– Rigole pas… Le voilà là-bas qui descend. Il vient sur nous… »
Mais l’homme âgé qu’il me désignait ne vint pas tout de suite, il marchait voûté autour de la pelouse, en parlant avec un soldat. Nous approchâmes. Je reconnus le soldat, c’était le même réserviste que j’avais rencontré la nuit à Noirceur-sur-la-Lys, où j’étais en reconnaissance. Je me souvins même à l’instant du nom qu’il m’avait dit: Robinson.
« Tu le connais toi ce biffin‐là? qu’il me demanda Voireuse.
– Oui, je le connais.
– C’est peut-être un ami à eux… Ils doivent se parler de la mère; je voudrais pas qu’ils nous empêchent d’aller la voir… Parce que c’est elle plutôt qui donne le pognon… »
Le vieux monsieur se rapprocha de nous. Il chevrotait.
« Mon cher ami, dit-il à Voireuse, j’ai la grande douleur de vous apprendre que depuis votre dernière visite, ma pauvre femme a succombé à notre immense chagrin… Jeudi nous l’avions laissée seule un moment, elle nous l’avait demandé… Elle pleurait… »
Il ne sut finir sa phrase. Il se détourna brusquement et nous quitta.
« J’ te reconnais bien, fis‐je alors à Robinson, dès que le vieux monsieur se fut suffisamment éloigné de nous.
– Moi aussi, que je te reconnais…
– Qu’est-ce qui lui est arrivé à la vieille? que je lui ai alors demandé.
– Eh bien, elle s’est pendue avant-hier, voilà tout! qu’il a répondu. Tu parles alors d’une noix, dis donc! qu’il a même ajouté à ce propos… Moi qui l’avais comme marraine!.. C’est bien ma veine hein! Tu parles d’un lot! Pour la première fois que je venais en permission!.. Et y a six mois que je l’attendais ce jour-là!.. »
On a pas pu s’empêcher de rigoler, Voireuse et moi, de ce malheur-là qui lui arrivait à lui Robinson. En fait de sale surprise, c’en était une, seulement ça nous rendait pas nos deux cents balles à nous non plus qu’elle soye morte, nous qu’on allait monter un nouveau bobard pour la circonstance. Du coup nous n’étions pas contents, ni les uns ni les autres.
« Tu l’avais ta gueule enfarinée, hein, grand saligaud? qu’on l’asticotait nous Robinson, histoire de le faire grimper et de le mettre en boîte. Tu croyais que t’allais te l’envoyer hein? le gueuleton pépère avec les vieux? Tu croyais peut-être aussi que t’allais l’enfiler la marraine?.. T’es servi dis donc!.. »
Comme on pouvait pas rester là tout de même à regarder la pelouse en se bidonnant, on est partis tous les trois ensemble du côté de Grenelle. On a compté notre argent à tous les trois, ça faisait pas beaucoup. Comme il fallait rentrer le soir même dans nos hôpitaux et dépôts respectifs, y avait juste assez pour un dîner au bistrot à trois, et puis il restait peut-être encore un petit quelque chose, mais pas assez pour « monter » au bobinard. Cependant, on y a été quand même au claque mais pour prendre un verre seulement et en bas.
« Toi, je suis content de te revoir, qu’il m’a annoncé, Robinson, mais tu parles d’un colis quand même la mère du gars!.. Tout de même quand j’y repense, et qui va se pendre le jour même où j’arrive dis donc!.. J’la retiens celle-là!.. Est-ce que je me pends moi dis?.. Du chagrin?.. J’ passerais mon temps à me pendre moi alors!.. Et toi?
– Les gens riches, fit Voireuse, c’est plus sensible que les autres… »
Il avait bon cœur Voireuse. Il ajouta encore: « Si j’avais six francs j’ monterais avec la petite brune que tu vois là-bas, près de la machine à sous…
– Vas-y, qu’on lui a dit nous alors, tu nous raconteras si elle suce bien… »
Seulement, on a eu beau chercher, on n’avait pas assez avec le pourboire pour qu’il puisse se l’envoyer. On avait juste assez pour encore un café chacun et deux cassis. Une fois lichés, on est repartis se promener!
Place Vendôme, qu’on a fini par se quitter. Chacun partait de son côté. On ne se voyait plus en se quittant et on parlait bas, tellement il y avait des échos. Pas de lumière, c’était défendu.
Lui, Jean Voireuse, je l’ai jamais revu. Robinson, je l’ai retrouvé souvent par la suite. Jean Voireuse, c’est les gaz qui l’ont possédé, dans la Somme. Il est allé finir au bord de la mer, en Bretagne, deux ans plus tard, dans un sanatorium marin. Il m’a écrit deux fois dans les débuts puis plus du tout. Il n’y avait jamais été à la mer. « T’as pas idée comme c’est beau, qu’il m’écrivait, je prends un peu des bains, c’est bon pour mes pieds, mais ma voix je crois qu’elle est bien foutue. » Ça le gênait parce que son ambition, au fond, à lui, c’était de pouvoir un jour rentrer dans les chœurs au théâtre.
C’est bien mieux payé et plus artiste les chœurs que la figuration simple.
Les huiles ont fini par me laisser tomber et j’ai pu sauver mes tripes, mais j’étais marqué à la tête et pour toujours. Rien à dire. « Va-t’en!.. qu’ils m’ont fait. T’es plus bon à rien!..
– En Afrique! que j’ai dit moi. Plus que ça sera loin, mieux ça vaudra! » C’était un bateau comme les autres de la Compagnie des Corsaires Réunis qui m’a embarqué. Il s’en allait vers les Tropiques, avec son fret de cotonnades, d’officiers et de fonctionnaires.
Il était si vieux ce bateau qu’on lui avait enlevé jusqu’à sa plaque en cuivre, sur le pont supérieur, où se trouvait autrefois inscrite l’année de sa naissance; elle remontait si loin sa naissance qu’elle aurait incité les passagers à la crainte et aussi à la rigolade.
On m’avait donc embarqué là-dessus, pour que j’essaye de me refaire aux Colonies. Ils y tenaient ceux qui me voulaient du bien, à ce que je fasse fortune. Je n’avais envie moi que de m’en aller, mais comme on doit toujours avoir l’air utile quand on est pas riche et comme d’autre part je n’en finissais pas avec mes études, ça ne pouvait pas durer. Je n’avais pas assez d’argent non plus pour aller en Amérique. « Va pour l’Afrique! » que j’ai dit alors et je me suis laissé pousser vers les Tropiques, où, m’assurait‐on, il suffisait de quelque tempérance et d’une bonne conduite pour se faire tout de suite une situation.
Ces pronostics me laissaient rêveur. Je n’avais pas beaucoup de choses pour moi, mais j’avais certes de la bonne tenue, on pouvait le dire, le maintien modeste, la déférence facile et la peur toujours de n’être pas à l’heure et encore le souci de ne jamais passer avant une autre personne dans la vie, de la délicatesse enfin…
Quand on a pu s’échapper vivant d’un abattoir international en folie, c’est tout de même une référence sous le rapport du tact et de la discrétion. Mais revenons à ce voyage. Tant que nous restâmes dans les eaux d’Europe, ça ne s’annonçait pas mal. Les passagers croupissaient, répartis dans l’ombre des entreponts, dans les w.-c., au fumoir, par petits groupes soupçonneux et nasillards. Tout ça, bien imbibé de picons et cancans, du matin au soir. On en rotait, sommeillait et vociférait tour à tour et semblait-il sans jamais regretter rien de l’Europe.
Notre navire avait nom: l’Amiral-Bragueton. Il ne devait tenir sur ces eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelures avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l’Amiral-Bragueton à la manière d’un oignon. Nous voguions vers l’Afrique, la vraie, la grande; celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux croisements de fleuves qui n’en finissent plus. Pour un paquet de lames « Pilett » j’allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves mineures. C’était promis. La vie quoi! Rien de commun avec cette Afrique décortiquée des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah non! Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique! Nous les passagers boissonnants de l’Amiral-Bragueton!
Mais, dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certain matin au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d’étuve infiniment tiède, inquiétante. L’eau dans les verres, la mer, l’air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d’avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s’est abattu sur les passagers de l’Amiral-Bragueton condamnés à ne plus s’éloigner du bar, envoûtés, rivés aux ventilateurs, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadences incohérentes.
Ça n’a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur tout le contenu humain du navire s’est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d’une baignoire d’eau fadasse. C’est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s’étaler l’angoissante nature des Blancs, provoquée, libérée, bien débraillée enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instincts tels crapauds et vipères qui viennent enfin s’épanouir au mois d’août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d’Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des Tropiques. C’est alors qu’on se déboutonne éperdument et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C’est l’aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent un moment leur étau, on peut apercevoir des Blancs, ce qu’on découvre du gai rivage, une fois que la mer s’en retire: la vérité, mares lourdement puantes, les crabes, la charogne et l’étron.
Ainsi, le Portugal passé, tout le monde se mit, sur le navire, à se libérer les instincts avec rage, l’alcool aidant, et aussi ce sentiment d’agrément intime que procure une gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché, abreuvé pour rien pendant quatre semaines consécutives, qu’on y songe, c’est assez, n’est-ce pas, en soi, pour délirer d’économie? Moi, seul payant du voyage, je fus trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut connue, singulièrement effronté, nettement insupportable.
Si j’avais eu quelque expérience des milieux coloniaux, au départ de Marseille, j’aurais été, compagnon indigne, à genoux, solliciter le pardon, la mansuétude de cet officier d’infanterie coloniale, que je rencontrais partout, le plus élevé en grade, et m’humilier peut-être au surplus, pour plus de sécurité, aux pieds du fonctionnaire le plus ancien. Peut-être alors, ces passagers fantastiques m’auraient-ils toléré au milieu d’eux sans dommage? Mais, ignorant, mon inconsciente prétention de respirer autour d’eux faillit bien me coûter la vie.
On n’est jamais assez craintif. Grâce à certaine habileté, je ne perdis que ce qu’il me restait d’amour-propre. Et voici comment les choses se passèrent. Quelque temps après les îles Canaries, j’appris d’un garçon de cabine qu’on s’accordait à me trouver poseur, voire insolent?.. Qu’on me soupçonnait de maquereautage en même temps que de pédérastie… D’être même un peu cocaïnomane… Mais cela à titre accessoire… Puis l’Idée fit son chemin que je devais fuir la France devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves. Je n’étais cependant qu’aux débuts de mes épreuves. C’est alors que j’appris l’usage imposé sur cette ligne, de n’accepter qu’avec une extrême circonspection, d’ailleurs accompagnée de brimades, les passagers payants; c’est-à-dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des arrangements bureaucratiques, les colonies françaises appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des « Annuaires ».
Il n’existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s’aventurer de ces côtés… Espion, suspect, on trouva mille raisons pour me toiser de travers, les officiers dans le blanc des yeux, les femmes en souriant d’une manière entendue. Bientôt, les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos, des remarques lourdement caustiques. On en vint à ne plus douter que c’était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord et pour ainsi dire le seul. Voilà qui promettait.
Je voisinais à table avec quatre agents des postes du Gabon, hépatiques, édentés. Familiers et cordiaux dans le début de la traversée, ils ne m’adressèrent ensuite plus un traître mot. C’est-à-dire que je fus placé, d’un tacite accord, au régime de la surveillance commune. Je ne sortais plus de ma cabine qu’avec d’infinies précautions. L’air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d’un solide. À poil, verrou tiré, je ne bougeais plus et j’essayais d’imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre. Je ne connaissais personne à bord et cependant chacun semblait me reconnaître. Mon signalement devait être devenu précis, instantané dans leur esprit, comme celui du criminel célèbre qu’on publie dans les journaux.
Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l’indispensable « infâme et répugnant saligaud » honte du genre humain qu’on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du Diable et du Bon Dieu, mais qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand à terre et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu pour l’isoler enfin, le « saligaud », l’identifier, le tenir, les circonstances exceptionnelles qu’on ne rencontrait que sur ce bord étroit.
Une véritable réjouissance générale et morale s’annonçait à bord de l’Amiral-Bragueton. « L’immonde » n’échapperait pas à son sort. C’était moi.
À lui seul cet événement valait tout le voyage. Reclus parmi ces ennemis spontanés, je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu’ils s’en aperçussent. Pour y parvenir je les épiais impunément, le matin surtout, par le hublot de ma cabine. Avant le petit déjeuner, prenant le frais, poilus du pubis aux sourcils et du rectum à la plante des pieds, en pyjamas, transparents au soleil; vautrés le long du bastingage, le verre en main, ils venaient roter là, mes ennemis, et menaçaient déjà de vomir alentour, surtout le capitaine aux yeux saillants et injectés que son foie travaillait ferme, dès l’aurore. Régulièrement au réveil, il s’enquérait de mes nouvelles auprès des autres lurons, si « l’on » ne m’avait pas encore « balancé par-dessus bord » qu’il demandait. « Comme un glaviot! » Pour faire i, en même temps il crachait dans la mer mousseuse. Quelle rigolade!
L’Amiral n’avançait guère, il se traînait plutôt, en ronronnant, d’un roulis vers l’autre. Ce n’était plus un voyage, c’était une espèce de maladie. Les membres de ce concile matinal, à les examiner de mon coin, me semblaient tous assez profondément malades, paludéens, alcooliques, syphilitiques sans doute, leur déchéance visible à dix mètres me consolait un peu de mes tracas personnels. Après tout, c’étaient des vaincus, tout de même que moi ces Matamores!.. Ils crânaient encore voilà tout! Seule différence! Les moustiques s’étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à pleines veines ces poisons qui ne s’en vont plus… Le tréponème à l’heure qu’il était leur limaillait déjà les artères… L’alcool leur bouffait les foies… Le soleil leur fendillait les rognons… Les morpions leur collaient aux poils et l’eczéma à la peau du ventre… La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine!.. Dans pas longtemps que leur resterait-il? Un bout du cerveau… Pour en faire quoi avec? Je vous le demande?.. Là où ils allaient? Pour se suicider? Ça ne pouvait leur servir qu’à ça, un cerveau là où ils allaient… On a beau dire, c’est pas drôle de vieillir dans les pays où y a pas de distractions… Où on est forcé de se regarder dans la glace dont le tain verdit devenir de plus en plus déchu, de plus en plus moche… On va vite à pourrir, dans les verdures, surtout quand il fait chaud atrocement.
Le Nord au moins ça vous conserve les viandes; ils sont pâles une fois pour toutes les gens du Nord. Entre un Suédois mort et un jeune homme qui a mal dormi, peu de différence. Mais le colonial il est déjà tout rempli d’asticots un jour après son débarquement. Elles n’attendaient qu’eux ces infiniment laborieuses vermicelles et ne les lâcheraient plus que bien au‐delà de la vie. Sacs à larves.
Nous en avions encore pour huit jours de mer avant de faire escale devant la Bragamance, première terre promise. J’avais le sentiment de demeurer dans une boîte d’explosifs. Je ne mangeais presque plus pour éviter de me rendre à leur table et de traverser leurs entreponts en plein jour. Je ne disais plus un mot. Jamais on ne me voyait en promenade. Il était difficile d’être aussi peu que moi sur le navire tout en y demeurant.
Mon garçon de cabine, un père de famille, voulut bien me confier que les brillants officiers de la coloniale avaient fait le serment, verre en main, de me gifler à la première occasion et de me balancer par-dessus bord ensuite. Quand je lui demandais pourquoi, il n’en savait rien et il me demandait à son tour ce que j’avais bien pu faire pour en arriver là. Nous en demeurions à ce doute. Ça pouvait durer longtemps. J’avais une sale gueule, voilà tout.
On ne m’y reprendrait plus à voyager avec des gens aussi difficiles à contenter. Ils étaient tellement désœuvrés aussi, enfermés trente jours durant avec eux-mêmes qu’il en fallait très peu pour les passionner. D’ailleurs, dans la vie courante, réfléchissons que cent individus au moins dans le cours d’une seule journée bien ordinaire désirent votre pauvre mort, par exemple tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro, tous ceux encore qui passent devant votre appartement et qui n’en ont pas, tous ceux qui voudraient que vous ayez achevé de faire pipi pour en faire autant, enfin, vos enfants et bien d’autres. C’est incessant. On s’y fait. Sur le bateau ça se discerne mieux cette presse, alors c’est plus gênant.
Dans cette étuve mijotante, le suint de ces êtres ébouillantés se concentre, les pressentiments de la solitude coloniale énorme qui va les ensevelir bientôt eux et leur destin, les faire gémir déjà comme des agonisants. Ils s’accrochent, ils mordent, ils lacèrent, ils en bavent. Mon importance à bord croissait prodigieusement de jour en jour. Mes rares arrivées à table aussi furtives et silencieuses que je m’appliquasse à les rendre prenaient l’ampleur de réels événements. Dès que j’entrais dans la salle à manger, les cent vingt passagers tressautaient, chuchotaient…
Les officiers de la coloniale bien tassés d’apéritifs en apéritifs autour de la table du commandant, les receveurs buralistes, les institutrices congolaises surtout, dont l’Amiral-Bragueton emportait tout un choix, avaient fini de suppositions malveillantes en déductions diffamatoires par me magnifier jusqu’à l’infernale importance.
À l’embarquement de Marseille, je n’étais guère qu’un insignifiant rêvasseur, mais à présent, par l’effet de cette concentration agacée d’alcooliques et de vagins impatients, je me trouvais doté, méconnaissable, d’un troublant prestige.
Le Commandant du navire, gros malin trafiqueur et verruqueux, qui me serrait volontiers la main dans les débuts de la traversée, chaque fois qu’on se rencontrait à présent, ne semblait même plus me reconnaître, ainsi qu’on évite un homme recherché pour une sale affaire, coupable déjà… De quoi? Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout seuls.
D’après ce que je croyais discerner dans la malveillance compacte où je me débattais, une des demoiselles institutrices animait l’élément féminin de la cabale. Elle retournait au Congo, crever, du moins je l’espérais, cette garce. Elle quittait peu les officiers coloniaux aux torses moulés dans la toile éclatante et parés au surplus du serment qu’ils avaient prononcé de m’écraser ni plus ni moins qu’une infecte limace, bien avant la prochaine escale. On se demandait à la ronde si je serais aussi répugnant aplati qu’en forme. Bref, on s’amusait. Cette demoiselle attisait leur verve, appelait l’orage sur le pont de l’Amiral-Bragueton, ne voulait connaître de repos qu’après qu’on m’eût enfin ramassé pantelant, corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d’oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié sous la botte et le poing d’un de ces gaillards dont elle brûlait d’admirer l’action musculaire, le courroux splendide. Scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés pressentaient un réveil. Ça valait un viol par gorille. Le temps passait et il est périlleux de faire attendre longtemps les corridas. J’étais la bête. Le bord entier l’exigeait, frémissant jusqu’aux soutes.
La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. Et comme il ne nous restait plus que trois journées avant l’escale, journées décisives, plusieurs toreros s’offrirent. Et plus je fuyais l’esclandre et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main les sacrificateurs. On me coinça ainsi entre deux cabines, au revers d’une courtine. Je m’échappai de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre aux cabinets. Quand nous n’eûmes donc plus que ces trois jours de mer devant nous j’en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi tout était accablant de haine et d’ennui. Il faut dire aussi qu’il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Il recouvre la mer, et le bateau, et les cieux. Des gens solides en deviendraient bizarres, à plus forte raison ces abrutis chimériques.
Un sacrifice! J’allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après le dîner où je m’étais quand même rendu, tracassé par la faim. J’avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n’osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m’éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montait, assis, sous le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu’on avait décidé à mon égard, car ils se mirent, à ma surprise, à me parler librement et complaisamment de duels et d’estocades, à me poser des questions… À ce moment aussi, l’institutrice du Congo, celle qui avait l’haleine si forte, se dirigea vers le salon. J’eus le temps de remarquer qu’elle portait une robe en guipure de grand apparat et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée, pour jouer, si l’on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L’ambiance devint intensément nerveuse et furtive.
Je ne fis qu’un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l’avais presque atteinte quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m’enjoignit-il. Nous y fûmes en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré, il s’était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu’il n’avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n’en menais pas large, le cœur battant à hauteur du nombril.
Ce préambule, cette impeccabilité anormale me fit présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l’effet d’un morceau de la guerre qu’on aurait remis brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin.
Derrière lui, me bouclant la porte de l’entrepont, se dressaient en même temps quatre officiers subalternes, attentifs à l’extrême, escorte de la Fatalité.
Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémizon des troupes coloniales! Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau justement indignés par votre inqualifiable conduite, j’ai l’honneur de vous demander raison!.. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables!.. Voici le moment, monsieur, d’articuler bien haut vos griefs!.. De proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis vingt et un jours! De nous dire enfin ce que vous pensez… »
Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J’avais redouté quelque mise à mort imparable, mais ils m’offraient, puisqu’il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté devient une magnifique espérance à qui s’y connaît. C’est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l’étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d’une persécution dont on est l’objet. Y échapper suffit au sage.
« Capitaine! lui répondis-je avec toute la voix convaincue dont j’étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre! Vous! Moi! Comment me prêter à moi, les sentiments d’une semblable perfidie? C’est trop d’injustice en vérité! J’en ferais capitaine une maladie! Comment? Moi hier encore défenseur de notre chère patrie! Moi, dont le sang s’est mêlé au vôtre pendant des années au cours d’inoubliables batailles! De quelle injustice alliez-vous m’accabler capitaine! »
Puis, m’adressant au groupe entier:
« De quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Aller jusqu’à penser que moi, votre frère en somme, je m’entêtais à répandre d’immondes calomnies sur le compte d’héroïques officiers! C’est trop! vraiment c’est trop! Et cela au moment même où ils s’apprêtent ces braves, ces incomparables braves à reprendre, avec quel courage, la garde sacrée de notre immortel empire colonial! poursuivis-je. Là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d’une gloire éternelle. Les Mangin! les Faidherbe, les Gallieni!.. Ah! capitaine! Moi? Ça? »
Je me tins en suspens. J’espérais être émouvant. Bienheureusement je le fus un petit instant. Sans traîner, alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j’allai droit à lui et lui serrai les deux mains dans une étreinte d’émotion.
J’étais un peu tranquille ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuais à m’expliquer avec volubilité et tout en lui donnant mille fois raison, je l’assurais que tout était à reprendre entre nous et par le bon bout cette fois! Que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l’origine de cette fantastique méprise! Que ma conduite certes aurait pu être interprétée comme un inconcevable dédain par ce groupe de passagers et de passagères « héros et charmeurs mélangés… Providentielle réunion de grands caractères et de talents… Sans oublier les dames incomparables musiciennes, ces ornements du bord!.. » Tout en faisant largement amende honorable, je sollicitai pour conclure qu’on m’admisse sans y surseoir et sans restriction aucune, au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel… Où je tenais, dès ce moment, et pour toujours, à faire très aimable figure… Sans lui lâcher les mains, bien entendu, je redoublai d’éloquence.
Tant que le militaire ne tue pas, c’est un enfant. On l’amuse aisément. N’ayant pas l’habitude de penser, dès qu’on lui parle il est forcé pour essayer de vous comprendre de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémizon ne me tuait pas, il n’était pas en train de boire non plus, il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds, il essayait seulement de penser. C’était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête.
Graduellement, pendant que durait cette épreuve d’humiliation, je sentais mon amour-propre déjà prêt à me quitter, s’estomper encore davantage, et puis me lâcher, m’abandonner tout à fait, pour ainsi dire officiellement. On a beau dire, c’est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement s’entend. C’est peut-être de la peur qu’on a le plus souvent besoin pour se tirer d’affaire dans la vie. Je n’ai jamais voulu quant à moi d’autres armes depuis ce jour, ou d’autres vertus.
Les camarades du militaire indécis, à présent eux aussi venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, devaient pour tout triomphe se contenter d’attraper des mots dans l’air. Les civils accourus frémissants à l’annonce d’une mise à mort arboraient de sales figures. Comme je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique, tout en tenant les mains du capitaine, je fixais un point idéal dans le brouillard moelleux, à travers lequel l’Amiral-Bragueton avançait en soufflant et crachant d’un coup d’hélice à l’autre. Enfin, je me risquai pour terminer à faire tournoyer un de mes bras au-dessus de ma tête et lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançai dans la péroraison: « Entre braves, messieurs les Officiers, doit‐on pas toujours finir par s’entendre? Vive la France alors, nom de Dieu! Vive la France! » C’était le truc du sergent Branledore. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie, jusque-là c’était plutôt le contraire. J’observai parmi les auditeurs un petit moment d’hésitation, mais tout de même il est bien difficile à un officier aussi mal disposé qu’il puisse être, de gifler un civil, publiquement, au moment où celui‐ci crie si fortement que je venais de le faire: « Vive la France! » Cette hésitation me sauva.
J’empoignai deux bras au hasard dans le groupe des officiers et invitai tout le monde à venir se régaler au Bar à ma santé et à notre réconciliation. Ces vaillants ne résistèrent qu’une minute et nous bûmes ensuite pendant deux heures. Seulement les femelles du bord nous suivaient des yeux, silencieuses et graduellement déçues. Par les hublots du Bar, j’apercevais entre autres la pianiste institutrice entêtée qui passait et revenait au milieu d’un cercle de passagères, la hyène. Elles soupçonnaient bien ces garces que je m’étais tiré du guet-apens par ruse et se promettaient de me rattraper au détour. Pendant ce temps, nous buvions indéfiniment entre hommes sous l’inutile mais abrutissant ventilateur, qui se perdait à moudre depuis les Canaries le coton tiède atmosphérique. Il me fallait cependant encore retrouver de la verve, de la faconde qui puisse plaire à mes nouveaux amis, de la facile. Je ne tarissais pas, peur de me tromper, en admiration patriotique et je demandais et redemandais à ces héros chacun son tour, des histoires et encore des histoires de bravoure coloniale. C’est comme les cochonneries, les histoires de bravoure, elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu’il faut au fond pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non, armistices fragiles il est vrai, mais précieux quand même, c’est leur permettre en toutes circonstances, de s’étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n’y a pas de vanité intelligente. C’est un instinct. Il n’y a pas d’homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d’humain à humain avec quelque plaisir. Avec ces soldats, je n’avais pas à me mettre en frais d’imagination. Il suffisait de ne pas cesser d’apparaître émerveillé. C’est facile de demander et de redemander des histoires de guerre. Ces compagnons-là en étaient bardés. Je pouvais me croire revenu aux plus beaux jours de l’hôpital. Après chacun de leurs récits, je n’oubliais pas de marquer mon appréciation comme je l’avais appris de Branledore, par une forte phrase: « Eh bien en voilà une belle page d’Histoire! » On ne fait pas mieux que cette formule. Le cercle auquel je venais de me rallier si furtivement, me jugea peu à peu devenu intéressant. Ces hommes se mirent à raconter à propos de guerre autant de balivernes qu’autrefois j’en avais entendues et plus tard racontées moi-même, alors que j’étais en concurrence imaginative avec les copains de l’hôpital. Seulement leur cadre à ceux‐ci était différent et leurs bobards s’agitaient à travers les forêts congolaises au lieu des Vosges ou des Flandres.
Mon capitaine Frémizon, celui qui l’instant auparavant se désignait encore pour purifier le bord de ma putride présence, depuis qu’il avait éprouvé ma façon d’écouter plus attentivement que personne, se mit à me découvrir mille gentilles qualités. Le flux de ses artères se trouvait comme assoupli par l’effet de mes originaux éloges, sa vision s’éclaircissait, ses yeux striés et sanglants d’alcoolique tenace finirent même par scintiller à travers son abrutissement et les quelques doutes en profondeur qu’il avait pu concevoir sur sa propre valeur et qui l’effleuraient encore dans les moments de grande dépression, s’estompèrent pour un temps, adorablement, par l’effet merveilleux de mes intelligents et pertinents commentaires.
Décidément, j’étais un créateur d’euphorie! On s’en tapait à tour de bras les cuisses! Il n’y avait que moi pour savoir rendre la vie agréable malgré toute cette moiteur d’agonie! N’écoutais-je pas d’ailleurs à ravir?
L’Amiral-Bragueton pendant que nous divaguions ainsi passait à plus petite allure encore, il ralentissait dans son jus;
plus un atome d’air mobile autour de nous, nous devions longer la côte et si lourdement, qu’on semblait progresser dans la mélasse.
Mélasse aussi le ciel au-dessus du bordage, rien qu’un emplâtre noir et fondu que je guignais avec envie. Retourner dans la nuit c’était ma grande préférence, même suant et geignant et puis d’ailleurs dans n’importe quel état! Frémizon n’en finissait pas de se raconter. La terre me paraissait toute proche, mais mon plan d’escapade m’inspirait mille inquiétudes… Peu à peu notre entretien cessa d’être militaire pour devenir égrillard et puis franchement cochon, enfin, si décousu, qu’on ne savait plus par où le prendre pour le continuer; l’un après l’autre mes convives y renoncèrent et s’endormirent et le ronflement les accabla, dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C’était le moment ou jamais de disparaître. Il ne faut pas laisser passer ces trêves de cruauté qu’impose malgré tout la nature aux organismes les plus vicieux et les plus agressifs de ce monde.
Nous étions ancrés à présent, à très petite distance de la côte. On n’en apercevait que quelques lanternes oscillantes le long du rivage.
Tout le long du bateau vinrent se presser très vite cent tremblantes pirogues chargées de nègres braillards. Ces Noirs assaillirent tous les ponts pour offrir leurs services. En peu de secondes, je portai à l’escalier de départ mes quelques paquets préparés furtivement et filai à la suite d’un de ces bateliers dont l’obscurité me cachait presque entièrement les traits et la démarche. Au bas de la passerelle, et au ras de l’eau clapotante, je m’inquiétai de notre destination.
« Où sommes-nous? demandai-je.
– À Bambola-Fort-Gono! » me répondit cette ombre.
Nous nous mîmes à flotter librement à grands coups de pagaie. Je l’aidai pour qu’on aille plus vite.
J’eus encore le temps d’apercevoir une fois encore en m’enfuyant mes dangereux compagnons du bord. À la lueur des falots d’entreponts, écrasés enfin d’hébétude et de gastrite ils continuaient à fermenter en grognant à travers leur sommeil. Repus, vautrés, ils se ressemblaient tous à présent, officiers, fonctionnaires, ingénieurs et traitants, boutonneux, bedonnants, olivâtres, mélangés, à peu près identiques. Les chiens ressemblent aux loups quand ils dorment.
Je retrouvai la terre peu d’instants plus tard et la nuit, plus épaisse encore sous les arbres, et puis derrière la nuit toutes les complicités du silence.
Dans cette colonie de la Bambola-Bragamance, au-dessus de tout le monde, triomphait le Gouverneur. Ses militaires et ses fonctionnaires osaient à peine respirer quand il daignait abaisser ses regards jusqu’à leurs personnes.
Bien au-dessous encore de ces notables les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus facilement qu’en Europe. Plus une noix de coco, plus une cacahuète, sur tout le territoire, qui échappât à leurs rapines. Les fonctionnaires comprenaient, à mesure qu’ils devenaient plus fatigués et plus malades, qu’on s’était bien foutu d’eux en les faisant venir ici, pour ne leur donner en somme que des galons et des formulaires à remplir et presque pas de pognon avec. Aussi louchaient-ils sur les commerçants. L’élément militaire encore plus abruti que les deux autres bouffait de la gloire coloniale et pour la faire passer beaucoup de quinine avec et des kilomètres de Règlements.
Tout le monde devenait, ça se comprend bien, à force d’attendre que le thermomètre baisse, de plus en plus vache. Et les hostilités particulières et collectives duraient interminables et saugrenues entre les militaires et l’administration, et puis entre cette dernière et les commerçants, et puis encore entre ceux-ci alliés temporaires contre ceux-là, et puis de tous contre le nègre et enfin des nègres entre eux. Ainsi, les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au soleil, se consumaient en haines si mordantes, si insistantes, que beaucoup de colons finissaient par en crever sur place, empoisonnés d’eux‐mêmes, comme des scorpions.
Toutefois, cette anarchie bien virulente se trouvait renfermée dans un cadre de police hermétique, comme les crabes dans leur panier. Ils bavaient en vain les fonctionnaires, et le Gouverneur trouvait d’ailleurs à recruter pour maintenir sa colonie en obédience, tous les miliciens miteux dont il avait besoin, autant de nègres endettés que la misère chassait par milliers vers la côte, vaincus du commerce, venus à la recherche d’une soupe. On leur apprenait à ces recrues le droit et la façon d’admirer le Gouverneur. Il avait l’air le Gouverneur de promener sur son uniforme tout l’or de ses finances, et avec du soleil dessus c’était à ne pas y croire, sans compter les plumes.